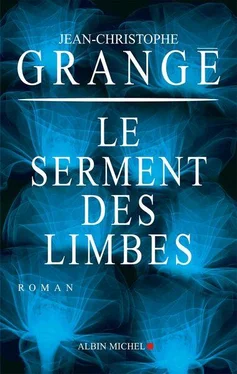— Vous pensez que les parents d’Agostina se sont laissé convaincre ?
— La mère, pas le père. Il ne croyait à rien. Elle, croyait à tout.
— Elle a payé pour une messe noire ?
— J’en suis sûr.
— Et l’appel a été cette fois entendu ?
Il ouvrit ses mains puis les referma, comme un rideau de théâtre.
— On peut imaginer, face à l’esprit d’amour, une antiforce, comme il existe une antimatière dans l’univers. C’est cette puissance à rebours qui a agi chez Agostina. Une superstructure de haine, de vice, de violence, a fait régresser sa maladie et l’a sauvée. On peut appeler ça le « diable ». On peut lui donner n’importe quel nom. L’ange déchu, mauvais, qui hante notre civilisation chrétienne, n’est que le symbole de cette énergie viciée.
— Quand Agostina s’est réveillée du coma, rien n’indiquait chez elle la possession.
— C’est vrai. Mais je savais que Lourdes et Notre Seigneur n’y étaient pour rien. Je flairais le complot. Je me méfiais de la personnalité de la mère, ignorante, superstitieuse. Il y avait aussi l’unital6, qui sentait le soufre…
— Vous avez interrogé l’enfant ?
— Non. Mais j’ai vu grandir Agostina. J’ai vu le serpent s’épanouir.
— De quelle façon ?
— Des détails de comportement. Des mots. Des regards. Agostina avait l’air d’un ange. Elle priait. Elle escortait les malades, à Lourdes. Tout cela était faux. Un rideau de fumée. Le diable était en elle. Il se développait comme un cancer.
Le docteur Bucholz me faisait surtout l’effet d’un sacré cinglé.
— Avez-vous déjà entendu parler des Sans-Lumière ?
Il laissa éclater un rire grave :
— Le secret le mieux gardé du Vatican !
— Mais vous en avez entendu parler.
— Vingt-cinq ans de Lourdes, ça vous dit quelque chose ? Je suis une vieille sentinelle. Les Sans-Lumière, le Serment des Limbes…
— Vous pensez qu’Agostina a conclu un pacte avec le démon ?
Il ouvrit de nouveau ses mains.
— Vous devez comprendre un principe de base. Le diable attend le dernier moment pour apparaître à ses victimes. Il attend la mort. À cet instant seulement, il les repêche. Tout se passe dans les limbes, quand la vie n’est plus là mais que la mort n’a pas encore rempli son office. Or, plus le sujet reste longtemps entre ces deux rives, plus son échange avec le diable est profond, intense. Dans le cas des NDE positives, c’est le même principe. Plus l’expérience est longue, plus les souvenirs sont précis. Et plus la vie, ensuite, s’en trouve bouleversée.
— Agostina a connu une mort clinique ?
— Oui. La dernière nuit, elle est passée de vie à trépas.
— Comment le savez-vous ?
— Sa mère m’a appelé.
— Vous, à mille kilomètres ?
— Elle avait confiance en moi. J’étais le seul médecin qui était venu les voir chez eux, à Paterno. Écoutez-moi. (Il joignit ses paumes.) Agostina meurt. D’après mes informations, son cœur a dû s’arrêter de battre durant trente minutes au moins. Ce qui est exceptionnel. Le diable l’a marquée à cet instant. En profondeur.
— Mais elle ne vous en a jamais parlé.
— Jamais.
J’étais venu pour faire la lumière sur le miracle maléfique d’Agostina. J’étais servi. Le bonhomme, à sa façon, suivait une logique implacable. Je demandai :
— Vous avez parlé de vos analyses à quelqu’un ?
— À tout le monde. La résurrection d’Agostina n’est pas un miracle. C’est un scandale, au sens étymologique du terme. Du grec skandalon : un obstacle. Une abomination. Agostina, à elle seule, est une entrave à l’amour. La preuve physique de l’existence du diable ! Je l’ai dit à qui voulait m’entendre. D’où ma retraite anticipée. Même chez les chrétiens, toute vérité n’est pas bonne à dire.
Son raisonnement était irréprochable, mais Bucholz était surtout un original qui avait fini par se convaincre de ses hypothèses. M’observant du coin de l’œil, il parut flairer mon scepticisme. Il ajouta :
— Je connais un autre cas. Une petite fille, restée plus longtemps encore au fond des limbes.
Je retins mon souffle.
— Une histoire terrifiante, continua-t-il. La petite est restée plus d’une heure sans le moindre signe de vie !
Je sortis mon carnet :
— Son nom ?
Pierre Bucholz ouvrit la bouche mais se tut. On venait de cogner à la vitre.
Il resta immobile durant une seconde puis s’effondra sur la table basse.
Le dos baigné de sang.
Je lançai un regard vers la porte-fenêtre. Une marque d’éclat, en forme de cible. Je me jetai à terre. Un nouveau « plop » claqua. Le crâne du chien explosa. Sa cervelle gicla sur le canapé. Au même instant, le corps de Bucholz s’affaissa au sol, entraînant la collection de chopes de Fatima posées sur la table basse.
Les alcools des moines giclèrent. Les statuettes de la Vierge et de Bernadette furent pulvérisées. Les bougies, les timbales, les vitrines éclatèrent. Plaqué au sol, je me glissai sous la table basse. La maison s’effondrait, sans l’ombre d’une déflagration. Les baies vitrées s’écroulèrent. Les fauteuils, le canapé, les coussins se soulevèrent puis retombèrent, en charpie. Commodes et armoires s’affaissèrent, éventrées.
Je pensai : « Sniper. Silencieux. Mon deuxième tueur. » On allait enfin pouvoir régler nos comptes. Cette idée me donna une énergie inattendue. Risquant un œil vers la baie fracassée, je déduisis l’angle de tir de l’agresseur. Posté au sommet de la colline qui surplombait la maison. Je me maudissais moi-même : une fois encore, je n’avais pas pris mon flingue. Et je ne pouvais plus me risquer à découvert jusqu’à la voiture.
Penché sous les balles, je sortis de ma planque et passai dans la cuisine, juste à ma gauche. J’attrapai le couteau le plus costaud que je pus trouver et repérai une porte arrière.
Je jaillis dehors, côté champs, prêt pour le duel.
Un duel risible.
Un tireur d’élite contre un équarisseur.
Un fusil d’assaut contre un couteau de cuisine.
Je rampai dans le jardin et observai le coteau. Pas question d’apercevoir l’homme camouflé, ni même le reflet de la lunette du fusil : aujourd’hui, les visées optiques sont en polymères et le verre de précision fumé. Je cherchai pourtant un signe, un indice, passant en revue chaque taillis, chaque buisson, en haut de la colline.
Rien.
Dans un ravin abrité, courbé parmi les herbes, j’attaquai mon ascension. Tous les cinquante pas, je remontais le flanc du fossé et plaçais ma main en visière. Toujours rien. Le tireur était sans doute abrité sous un tapis de branches et de feuilles, en tenue de camouflage. Peut-être même s’était-il concocté, comme les snipers de Sarajevo, un couloir de tir de plusieurs mètres…
Je grimpai encore. Au-dessus de moi, le vent frissonnait dans les cyprès. Soudain, alors que je jetais encore un regard, j’aperçus un éclair. Furtif, infime. Un déclic de métal, brillant au soleil. Une bague, une gourmette, un bijou. J’accélérai, levant les pieds pour amortir le bruit de ma course. Je ne pensais plus, n’analysais plus. Je montais au combat, c’était tout, concentré sur ma cible, située à deux cents mètres, selon une ligne oblique de trente degrés.
Enfin, le point culminant de la butte.
Un pas encore, et mon champ de vision s’ouvrit à 180 degrés.
Il était là, au pied d’un arbre.
Enorme, camouflé, invisible d’en bas.
Il portait un poncho kaki, capuche sur la tête. Un genou au sol, il était en train de démonter son arme — à moins qu’il ne la recharge. Un colosse. Sous la cape, plus de cent-cinquante kilos de chair bien pesés. L’obèse qui m’avait déjà bloqué le passage deux fois. Dans une impasse, à Catane. Dans l’escalier des musées du Vatican.
Читать дальше