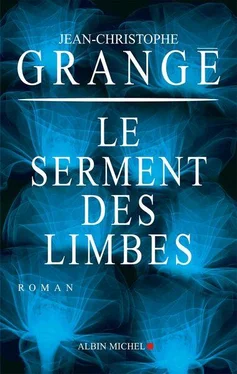Soudain, le sillon grenat d’une visée. Je relevai la tête : le tueur était là, arme au poing. De la buée sortait de sa cagoule, formant une auréole bleutée.
Je fermai les yeux et fis ce que tout homme fait en de telles circonstances, chrétien ou non : je priai. J’appelai, de toutes mes forces, le Seigneur à mon aide.
Une voix s’éleva :
— Wer da ?
Je tournai la tête. J’aperçus, les larmes aux yeux, les torches électriques, les galons argentés. Une patrouille de douaniers suisses ! Je regardai à nouveau devant moi : le tueur avait disparu.
J’entendis une galopade étouffée. Des mots en allemand. Des bruits de moteur. La poursuite reprenait — mais cette fois avec les chasseurs dans le rôle des proies. Les douaniers n’avaient pas repéré ma voiture sous les planches.
Je réussis à glisser mon automatique dans ma poche puis à me placer sur le ventre. Plantant mes coudes dans la neige, les jambes mortes, je rampai jusqu’à ma voiture. Je ne sentais plus ni mon corps ni le froid. Enfin, ma portière. Dos à l’encadrement, je me hissai à la manière d’un paralytique qui n’a plus l’usage de ses membres inférieurs. Installé sur le siège, je palpai l’espace sous mon volant à la recherche de la clé de contact. À deux mains, je la tournai et perçus un nouveau miracle : le ronflement du moteur. Le choc de la collision avait dû libérer la calandre de sa glace.
Le chauffage se remit en route. D’un coup de coude, je réglai la ventilation à fond. Recroquevillé près des grilles, les deux poings tendus, j’attendis que la chaleur vienne, réveillant le sang sous ma peau. Peu à peu, je prenais conscience du silence autour de moi. La forêt désertée. Et la frontière sans doute à quelques kilomètres.
Lorsque je pus enfin bouger les doigts et les pieds, je passai la marche arrière et m’arrachai à l’amas de bois. D’autres patrouilles n’allaient pas tarder. Je fis demi-tour, enclenchai la première et décollai du chantier.
Quelques minutes plus tard, je roulais vers l’Italie. Mon moteur n’avait plus le moindre dynamisme mais il fonctionnait. Et j’étais vivant, indemne !
En fait, dans une impasse.
Aucune chance que je passe la frontière avec une voiture dans cet état… Je traversai un village du nom de Gondo et aperçus un sentier qui descendait à l’oblique — sans doute vers une rivière ou un sous-bois, Je m’enfonçai sous les sapins et sentis que le vent s’apaisait — j’avais trouvé un abri. Je stoppai, laissai tourner le moteur, chauffage à fond. Je sortis, d’un pas maladroit, et attrapai dans mon coffre mon sac de voyage. J’ôtai mon trench-coat, enfilai deux pulls, un K-way, repassai pardessus le tout mon imper. Un bonnet, des gants — des vrais — et plusieurs paires de chaussettes. Je m’installai sur les sièges avant, au plus près des grilles de ventilation qui crachaient un souffle chaud puant l’huile de moteur.
Lorsque je fus réchauffé, je trouvai au fond de ma poche mon mobile et composai le numéro de Giovanni Callacciura. Je murmurai à son répondeur, en italien :
— Dès que tu as ce message, tu me rappelles. C’est urgent !
Puis je me pelotonnai sur les sièges, face au filet d’air chaud. Sans aucune pensée. Seulement une sensation : la vie. Elle me suffisait amplement. Je m’endormis, serrant mon portable tel un minuscule oreiller.
La lumière du jour me réveilla. Je me redressai, les yeux à demi fermés. La vue était éblouissante. Entre les montagnes, le disque solaire pointait comme une plaie sanglante. Au-dessus, des nuages s’écorchaient sur les crêtes. Autour de moi, la neige avait disparu. Remplacée par des pentes d’herbe jonchées de feuilles mortes.
Je regardai ma montre : 7 h 30. J’avais dormi quatre heures. Callacciura ne m’avait pas rappelé. Je composai à nouveau son numéro. Mon téléphone fonctionnait désormais sur un réseau italien.
— Pronto ?
— Mathieu. Je t’ai laissé un message, cette nuit.
— Je me réveille. Tu es déjà à Milan ?
Je lui racontai mon aventure et résumai ma situation : ma voiture criblée de balles, mon allure de clodo, l’impossibilité de franchir la frontière.
— Tu es où exactement ?
— À la sortie d’un village, Gondo. Il y a un sentier, sur la droite. Je suis au bout.
— Je te rappelle dans quelques minutes. Capito ?
Je trouvai au fond de ma poche mon paquet de Camel. J’en allumai une avec délectation. Ma lucidité revint, et avec elle, les questions qui tuaient. Qui étaient mes agresseurs ? Pourquoi s’en prendre à moi ? Je n’avais qu’une certitude : mes poursuivants n’avaient rien à voir avec l’assassin de Sylvie Simonis. D’un côté, deux professionnels. De l’autre, un meurtrier en série, prisonnier de sa folie.
Mon portable vibra.
— Suis bien mes instructions, dit Callacciura. Tu retournes sur la route principale, la E62, tu roules pendant un kilomètre. Là, tu vas voir une citerne, sur laquelle il y a marqué « Contozzo ». Tu te gares derrière et tu attends. Deux flics en civil vont venir te chercher d’ici une heure.
— Pourquoi des flics ?
— Ils vont t’escorter jusqu’à Milan. On maintient notre rendez-vous à onze heures.
— Et ma voiture ?
— On s’en occupe. Tu prends tes affaires, sans te retourner.
— Merci, Giovanni.
— Pas de quoi. J’ai reçu cette nuit d’autres éléments sur ton affaire. Il faut que je te parle.
Je raccrochai. Nouvelle cigarette. Malgré les bourrasques qui pénétraient dans l’habitacle, le moteur tournait toujours — et avec lui, le chauffage. Je sortis de la voiture pour pisser. Mon corps était perclus de courbatures mais la vie reprenait ses droits.
J’empruntai un chemin, sentant sang et muscles se réchauffer. J’éprouvai un vertige. La faim. J’aperçus une rivière, en contrebas. Je bus de longues gorgées glacées, dégustant le petit déjeuner le plus pur du monde.
Je démarrai à nouveau et partis en direction du lieu de rendez-vous. Je me postai au pied de la citerne et laissai ronfler le moteur, encore une fois. Près d’une heure et trois cigarettes brûlèrent ainsi. Pas de douaniers en vue, ni de fermiers curieux. Mais des réflexions, en pagaille.
Tout se bousculait dans ma tête. La culpabilité de Sylvie Simonis. La double identité de Sarrazin-Longhini. Le meurtre de Sylvie. L’apparition d’un crime identique, sur le sol italien, signé par une coupable qui avait avoué. Et maintenant, ces tueurs… Un pur chaos, où chaque réponse posait une nouvelle question.
Un détail m’accrocha l’esprit. Sur une impulsion, je composai le numéro de Marilyne Rosarias, directrice de la fondation de Bienfaisance. 7 h 45. La Philippine devait sortir de ses prières matinales.
— Qui est à l’appareil ?
Méfiance et hostilité, montées sur ressorts.
— Mathieu Durey, fis-je en me raclant la gorge. Le flic. Le spécialiste.
— Vous avez une drôle de voix. Vous êtes toujours dans la région ?
— J’ai dû partir. Vous ne m’avez pas tout dit la dernière fois.
— Vous m’accusez de mentir ?
— Par omission. Vous ne m’avez pas dit que Sylvie Simonis était venue se consoler à Bienfaisance, après la mort de sa fille, en 1988.
— Nous avons un devoir de confidentialité.
— Combien de temps est-elle restée à la fondation ?
— Trois mois. Elle venait le soir. Le matin, elle repartait au travail.
— En Suisse ?
— Qu’est-ce que vous cherchez encore ?
Soudain, une conviction : Marilyne était au courant de l’infanticide. Soit elle avait recueilli les confidences de Sylvie, soit elle avait deviné la vérité. Je balançai un coup de sonde :
Читать дальше