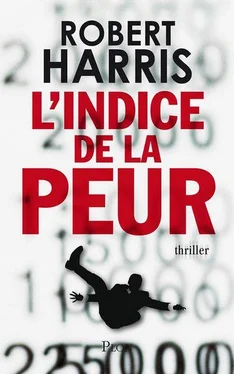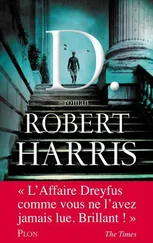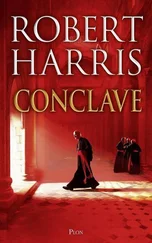Sa torche lui indiqua une autre porte tout au bout. Il percevait maintenant clairement le ronronnement sourd des unités centrales. Le plafond était bas et l’air glacial, comme dans une chambre froide. Il supposa qu’il devait y avoir un système de ventilation par le sol, comme dans la salle des ordinateurs au CERN. Il avança avec lassitude jusqu’au bout, pressa la paume contre le capteur, et la porte s’ouvrit sur le bruit et la lumière d’une ferme de processeurs. Dans le faisceau étroit de la lampe, les cartes mères étaient disposées sur des étagères en acier qui s’étendaient de tous côtés, exsudant une odeur familière et curieusement douceâtre de poussière brûlée. Une société d’informatique avait collé son étiquette de chaque côté des montants : en cas de problème, appeler ce numéro. Il avança lentement, faisant courir la lumière à droite et à gauche le long des allées, le faisceau se dissolvant dans l’obscurité. Il se demanda qui d’autre avait un droit d’accès. La société responsable de la sécurité, certainement — l’équipe de Genoud ; les services de maintenance et de nettoyage du bâtiment ; les techniciens des fournisseurs de hardware. Si chacun recevait instructions et paiements par mails, le site pouvait certainement fonctionner indépendamment de toute intervention extérieure, en s’appuyant uniquement sur du travail externalisé. Sans avoir besoin d’entretenir la moindre main-d’œuvre sur place. Le modèle par excellence du système nerveux numérique cher à Gates. Hoffmann se rappelait que, à ses débuts, Amazon se présentait comme « une entreprise réelle dans un monde virtuel ». Peut-être s’agissait-il ici d’une avancée logique dans la chaîne de l’évolution : une entreprise virtuelle dans un monde réel.
Il arriva à la porte suivante et répéta la procédure avec sa torche et le capteur de reconnaissance. Lorsque les verrous se furent ouverts, il examina le chambranle de la porte. Il s’aperçut que les murs n’étaient pas porteurs mais qu’il s’agissait de simples cloisons préfabriquées. Il s’était imaginé, en le regardant de l’extérieur, que le bâtiment consisterait en un vaste espace ouvert, mais il se rendait compte à présent qu’il était cloisonné à la façon d’une ruche. Pareil à une colonie d’insectes, il se divisait en multiples cellules. Le physicien franchit la nouvelle porte, entendit un mouvement sur le côté et se retourna au moment où une bandothèque IBM TS3500 fonçait sur lui en glissant sur son monorail. Le robot s’arrêta, sortit une cartouche et repartit. Hoffmann l’observa sans bouger pendant un moment, le temps que les battements de son cœur se calment un peu. Il lui sembla détecter une atmosphère d’urgence. Alors qu’il reprenait son chemin, il repéra quatre autres bandothèques qui s’activaient pour accomplir leurs tâches. Dans le coin opposé, sa torche lui indiqua un escalier métallique sans porte conduisant au niveau supérieur.
La pièce adjacente était plus réduite et semblait être le centre d’arrivée des tubes de communication. Il promena sa lampe sur deux gros câbles noirs, épais comme le poing, qui sortaient d’un boîtier métallique fermé et s’enfonçaient telles des racines tubéreuses dans un boyau qui passait sous ses pieds pour se relier à une sorte de tableau de commutateurs. Les deux côtés de l’allée étaient protégés par des sortes de lourdes cages en métal. Hoffmann savait déjà que les réseaux de fibre optique GVA-1 et GVA-2 passaient tous les deux près de l’aéroport de Genève sur leur parcours entre l’Allemagne et le site d’atterrage de Marseille. Grâce à ces réseaux, les données pouvaient circuler entre New York et Genève aussi rapidement que les particules expédiées dans le Grand Collisionneur de hadrons — soit juste en dessous de la vitesse de la lumière. Le VIXAL disposait donc du moyen de communication le plus rapide d’Europe.
Le faisceau de la lampe suivit d’autres câbles le long du mur, à hauteur d’épaule, en partie protégés par du métal galvanisé et qui surgissaient à côté d’une petite porte. Celle-ci était cadenassée. Il inséra l’extrémité du pied-de-biche dans l’arceau et s’en servit comme levier pour le déboîter. Le métal céda avec un cri perçant et la porte s’ouvrit. Hoffmann éclaira une sorte de réduit de contrôle de l’alimentation électrique — plusieurs compteurs, une boîte à fusibles grosse comme un petit placard et plusieurs disjoncteurs. Une autre caméra de surveillance suivait chacun de ses mouvements. Il coupa rapidement tous les compteurs. Pendant un instant, cela ne changea rien. Puis, quelque part dans le grand bâtiment, un générateur diesel se mit en route et, curieusement, toutes les lumières s’allumèrent. Incapable de contenir sa fureur, le physicien se servit de sa barre de fer comme d’un club de golf et atteignit son persécuteur en plein dans l’œil, le pulvérisant en un nombre satisfaisant de morceaux avant de s’en prendre au panneau de fusibles et de bousiller le boîtier de plastique. Il finit par abandonner quand il fut évident que cela ne servait à rien.
Il éteignit la torche et retourna dans la salle des communications. Tout au bout, il présenta son visage à la caméra, luttant pour conserver une expression neutre. Et la porte s’ouvrit… pas sur une autre antichambre, en fait, mais sur un immense espace, doté d’un haut plafond, d’horloges numériques pour indiquer les différents fuseaux horaires, et d’écrans de télé géants qui reproduisaient la salle des marchés des Eaux-Vives. Il y avait une unité centrale de contrôle consistant en une batterie de six écrans plus des moniteurs séparés qui affichaient sous forme de grilles les images enregistrées par les diverses caméras de surveillance. Devant chaque écran, au lieu d’avoir des gens, il y avait des rangées de cartes mères, qui travaillaient à plein régime à en croire la vitesse à laquelle clignotaient leurs voyants lumineux.
Ce doit être le cortex, songea Hoffmann. Il demeura un instant immobile, émerveillé. Il y avait quelque chose dans la détermination concentrée et indépendante de toute cette scène qu’il trouva curieusement émouvant — un peu, pensat-il, comme un parent peut être ému quand il voit pour la première fois un enfant se débrouiller très naturellement tout seul dans le monde. Que le VIXAL soit purement mécanique et ne soit doué ni de conscience ni d’émotions ; qu’il n’ait pas d’autre but que de continuer à survivre au détriment de tout le reste en accumulant de l’argent ; qu’une fois livré à lui-même, il ne cherche, conformément à la logique darwinienne, qu’à s’étendre au point de dominer la Terre entière… tout cela ne diminuait en rien pour Hoffmann le prodige même de son existence. Il lui pardonna même les épreuves que la machine lui avait fait subir : tout cela n’avait été en fait perpétré que pour servir les objectifs de la science. On ne pouvait pas plus porter sur lui de jugement moral qu’avec un requin. Le VIXAL se comportait tout simplement comme un fonds spéculatif.
Hoffmann en oublia fugitivement qu’il était venu ici pour le détruire et se pencha au-dessus des écrans pour examiner quelles opérations il effectuait. Tout se déroulait en ultra haute fréquence et sur des volumes gigantesques — des millions d’actions détenues pendant quelques fractions de seconde uniquement — une stratégie connue sous le nom de sniffing , technique du « renifleur », ou sniping , du « canardeur », et qui consiste à soumettre des ordres aussitôt annulés dans le simple but de sonder les marchés pour y découvrir des poches cachées de liquidités. Mais il ne l’avait jamais vue appliquer à une telle échelle. Cela ne pouvait dégager que des profits minimes, voire inexistants, et il se demanda ce que visait en réalité le VIXAL. Puis un message d’alerte apparut sur l’écran.
Читать дальше