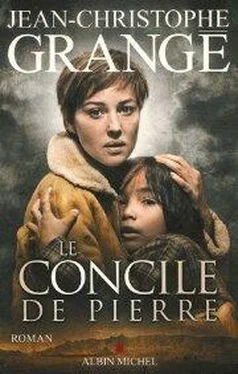— Les Mongols ont leur propre compagnie. Ils se couperaient un bras plutôt que de voyager sur Aeroflot. La haine : vous savez ce que ça veut dire ?
Elle sourit avec lassitude.
— Ça promet.
— Salut, Diane. Et bon courage.
Elle ne parvenait pas à se persuader que, dans une seconde, ce jeune chat aurait disparu, qu’elle serait de nouveau seule. Seule à un degré qu’elle ne parvenait pas à envisager. L’homme tourna les talons puis lança, pardessus sa capuche-tempête :
— Et souvenez-vous : les dieux n’aiment pas qu’on cherche à les imiter.
Le vieux Tupolev bringuebalait comme un train. Diane s’abandonnait à l’étrange torpeur du vol de nuit. Indifférente à l’inconfort de l’appareil, aux miettes de biscuits en guise de repas, aux lumières trop vives qui refusaient de s’éteindre, ou de s’allumer, selon les places, elle ne sentait pas non plus la froidure qui paraissait traverser la carlingue vibrante.
A Tomsk, on les fit sortir de l’appareil, puis on les guida dans l’obscurité jusqu’à un entrepôt, au bout de la piste. Le lieu ressemblait à un lazaret, où on les aurait isolés par peur d’une contamination. Ils s’installèrent, sans un mot, sur des bancs accolés aux murs. A la lueur d’une ampoule nue, Diane apercevait d’immenses photographies noir et blanc, suspendues aux murs. Des mineurs saisis dans une posture hiératique, pioche à la main. Des vallées minières aux allures de canyons. Des installations électriques, barrées de tours et de câbles. Tout un rêve de production et de planification, dont le grain photographique paraissait lui-même incrusté de crasse et de charbon.
Elle regarda sa montre : dix heures du soir à Moscou. Trois heures du matin à Ulan Bator. Mais ici, à Tomsk, quelle heure était-il ? Elle se tourna vers ses voisins et leur posa la question en anglais. Personne ne parlait cette langue. Elle interrogea d’autres passagers. Les Russes ne levaient même pas le visage de leur col. Enfin un vieillard lui répondit, dans un anglais approximatif
— Qui intéresser heure de Tomsk ?
— Moi, ça m’intéresse. J’aime savoir où j’en suis.
L’homme baissa les yeux et ne les releva plus. Diane aperçut sa propre ombre, distendue, filiforme, se détachant sur les photographies de mineurs. Elle alla s’asseoir et ressentit soudain une intense douleur à la poitrine, comme une pierre qui aurait percuté son torse.
L’image de Patrick Langlois venait de jaillir dans sa mémoire. Ses yeux de laque noire. Sa petite frange vif argent. Son odeur de vêtements trop propres. Le chagrin s’abattit sur Diane. Elle se sentait seule, perdue, paumée dans ce territoire sans limites. Mais, plus encore, perdue à l’intérieur d’elle-même…
Elle avait envie de pleurer. De pleurer comme on vomit. A l’idée que cet homme aurait pu l’aimer, elle, sa mort lui parut tout à coup deux fois absurde, deux fois inutile. Parce que si le policier avait vécu, il se serait vite aperçu que Diane était la femme de l’impossible. Ses avances auraient glissé sur elle comme de l’eau sur une nappe d’essence. Jamais elle n’aurait pu répondre à son désir. Jamais son propre désir à elle ne pourrait se fixer sur un objet. C’était comme une bête furieuse, un feu souterrain qui courait sous sa peau et ne trouverait jamais aucune issue.
Diane regarda les aiguilles de sa montre, qui tournaient au milieu de nulle part. " Ne jouez pas aux Alice détective ", lui avait dit le lieutenant. Un sourire remonta le courant de ses propres larmes. Elle n’était plus une Alice. Pas même une détective.
Seulement une jeune femme perdue dans une forêt de fuseaux horaires.
En route pour le continent-monstre.
CE fut la lumière qui la réveilla.
Elle se dressa sur son siège et plaqua sa main contre le hublot. Depuis combien de temps dormait-elle ? Aussitôt remontée dans l’appareil, elle s’était effondrée. Et elle était maintenant éblouie par l’aurore. Elle remit ses lunettes et tendit son regard vers la fenêtre. Elle aperçut alors, dans la lumière violente de l’aube, ce qui n’existait sans doute dans aucune autre région du monde, ce qui cinglait le cœur du voyageur lorsqu’il franchissait les derniers nuages au-dessus de la terre de Mongolie: la steppe.
Si la couleur verte avait pu flamber, elle aurait engendré une telle lumière. Une brûlure verdoyante, frémissante. Une lumière jaillie de la terre, ébouriffée de chiendent. Un brasier qui avait les contours de l’horizon mais possédait, dans ses moindres interstices, l’intimité d’un soupir.
Le soleil pouvait toujours frapper : il n’altérerait jamais une telle fraîcheur.
Diane chercha ses lunettes noires afin de mieux distinguer le relief de ces immensités. C’était étrange. Il lui semblait avoir toujours connu cette démesure d’herbes folles. Ces collines qui jouaient à saute-mouton dans leur solitude émerveillée. Cette liesse des plaines, comme ivres d’elles-mêmes, qui avançaient vers un éternel rendez-vous avec l’horizon.
Elle s’approcha du hublot jusqu’à le toucher de son front. Malgré la distance, malgré le vacarme des réacteurs, sa pensée pouvait s’élancer jusqu’au ras du sol pour percevoir le bruissement des pâturages, le bourdonnement des insectes, le grésillement infime de la nature lorsque les rafales de vent s’apaisaient. Oui, c’était une terre à écouter. Comme un coquillage. Une terre dont on pouvait saisir toutes les subtilités, à la surface, puis discerner, dessous, l’écho lointain du galop des chevaux à crinière courte. Et peut-être, plus profondément, le cœur sourd du monde…
L’aéroport d’Ulan Bator était une salle de ciment brut, où on marquait les bagages à la craie et où les comptoirs des départs et des arrivées se résumaient à un seul pupitre de bois, sur lequel trônait le computeur du bâtiment. A travers les vitres, Diane distinguait, parmi quelques voitures, les premiers cavaliers sur leurs montures. Tous portaient une robe traditionnelle, vibrante de couleur et ceinturée de soie.
Diane n’avait pas la moindre idée de ce qu’elle devait faire maintenant. Pour gagner du temps, elle imita les autres voyageurs et s’empara d’une fiche de renseignements. Elle se mit en devoir de la remplir, debout, en appui contre un mur. C’est alors qu’elle lut, en haut du document, quelques lignes en anglais qui lui rappelèrent une évidence à laquelle, à aucun moment, elle n’avait songé.
Dans son dos une voix demanda :
— Vous êtes Diane Thiberge ?
Elle sursauta. Un jeune Occidental lui souriait. Il portait une parka de marque anglaise, un pantalon de velours chasseur et des chaussures montantes. Diane pensa : " Ça ne peut pas être un flic. Pas ici. "
Elle se recula pour mieux le détailler. Il avait un visage poupin, des cheveux châtains bouclés, des lunettes à la monture d’or très fine et une barbe de trois jours qui accentuait son teint hâlé. Malgré la barbe, il se dégageait de ces traits, de cette peau brune, de ces vêtements impeccables, une netteté, une régularité dont Diane se sentit aussitôt jalouse — elle avait toujours l’impression d’être blafarde et fringuée de travers.
L’homme se présenta avec un léger accent qui roucoulait sous sa langue :
— Giovanni Santis. Je suis attaché à l’ambassade italienne. J’ai pris l’habitude d’accueillir tous les ressortissants d’Europe. J’ai repéré votre nom sur l’ordinateur des arrivées et…
— Qu’est-ce que vous voulez ?
Il parut étonné par son agressivité.
— Mais… vous aider, vous conseiller, vous guider, répondit-il. Nous ne sommes pas dans un pays facile et…
— Merci. Ça ira très bien.
Читать дальше