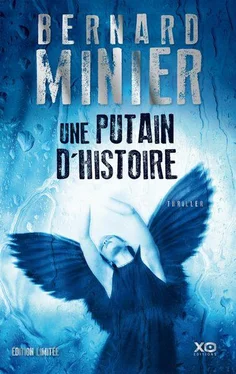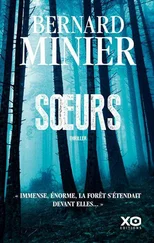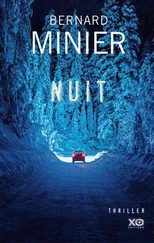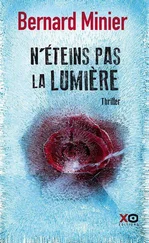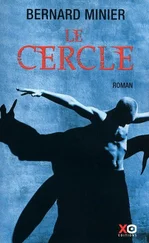Bernard Minier - Une putain d’histoire
Здесь есть возможность читать онлайн «Bernard Minier - Une putain d’histoire» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Город: Paris, Год выпуска: 2015, ISBN: 2015, Издательство: XO Éditions, Жанр: Триллер, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Une putain d’histoire
- Автор:
- Издательство:XO Éditions
- Жанр:
- Год:2015
- Город:Paris
- ISBN:978-2845637566
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Une putain d’histoire: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Une putain d’histoire»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
« Au commencement est la
.
La
de se noyer.
La
des autres,
ceux qui me détestent,
ceux qui veulent ma peau Autant vous le dire tout de suite :
Ce n’est pas une histoire banale. Ça non.
c’est une putain d’histoire.
Ouais,
… »
Une putain d’histoire — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Une putain d’histoire», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
C’était un paysage certes monotone mais pur, ouvert, immensément vide, presque dépourvu d’arbres — bien loin de la luxuriance corruptrice de sa Virginie natale. Les hautes herbes se mêlaient aux fleurs : gentiane, silphium, faux-indigo ; la route filait, droite et claire ; la prairie dominait un petit val calcaire où micocouliers, peupliers et noyers longeaient un ruisseau rachitique. C’était le cœur de l’Amérique. L’endroit où elle avait enfin trouvé la paix. Après toutes ces années passées à le servir, à ramasser derrière lui la merde, le sang, les larmes et l’ordure… Les étrangers jasaient sur l’ennui que distillait un tel paysage, sur l’ignorance de ses habitants, mais elle savait qu’il n’en était rien — préjugés de citadins — et surtout, ici, elle pouvait enfin les oublier, lui et son âme damnée. Ici, il n’y avait rien pour lui rappeler Grant Augustine.
Elle ne cherchait pas à lui échapper : il aurait aisément pu la retrouver — il avait à sa disposition tous les moyens possibles et imaginables et elle ne se cachait pas. Elle s’était juste construit une vie loin de lui, une vie sans lui, une vie qui — par sa simplicité même — était la négation de celle qu’elle avait connue à ses côtés. Du reste, elle avait parfois l’impression d’être suivie quand elle empruntait la 177 pour se rendre à Council Grove ou à Topeka, mais cela ne la préoccupait guère. S’il avait voulu entrer en contact avec elle, il l’aurait fait depuis longtemps. Après tout, c’était lui qui l’avait licenciée seize ans plus tôt, après cette triste histoire…
C’était la seule chose qu’elle regrettait de ce temps-là — ou plutôt la seule personne…
Au cours des cinq dernières années, elle en était arrivée à penser que Grant Augustine l’avait définitivement oubliée, rayée de sa vie. Mais elle était bien placée pour savoir qu’il n’oubliait jamais rien — ni personne. Et parfois, quand les éclairs illuminaient le ciel du Kansas et que la nuit était saturée de grondements sinistres, elle se réveillait et s’asseyait dans son lit, le cœur oppressé, en s’attendant presque à le voir s’encadrer sur les lueurs de la foudre.
Seize années …
Seize années sans un signe de lui et sa pensée arrivait encore, par moments, à lui ôter le sommeil.
Elle marcha dans la poussière jusqu’à la rangée de boîtes aux lettres. Elles portaient des noms comme Merryman, Puchalski, Boyle, elles étaient en métal et brûlantes, tout comme le capot de son Dodge, malgré l’ombre d’un orme rouge. Car, il y a quelques minutes encore, elles étaient en plein soleil. Elle ouvrit la sienne avec précaution. La sueur avait dessiné des auréoles sous ses aisselles et sous ses seins. Il y avait une paye que la clim du Dodge était en panne, qu’il consommait trop d’huile et que la transmission craquait comme si elle allait tomber en morceaux. Elle devait se décider à le remplacer.
Il y avait une carte postale au fond de la boîte.
C’était plus de courrier qu’elle en recevait la plupart du temps. Elle plongea une main dans la bouche d’ombre. Sortit la carte en pleine lumière.
La regarda — étonnée.
Une photo aérienne. Des îles verdoyantes posées sur une mer brillante, couvertes de forêt, et un minuscule ferry qui traçait sa route entre elles, laissant derrière lui plusieurs V scintillants. Elle retourna la carte. C’était bien son adresse : Martha Allen, 2200 Highway 177, Strong City, KS 66869 .
Elle commença à lire. Fronça les sourcils — ce qui eut pour effet, sous ce soleil vertical, de dessiner plusieurs rides profondes sur son front ruisselant.
Elle fixa les mots, qui dansèrent devant ses yeux.
Étouffa un cri.
Après toutes ces années. C’était impossible. D’un coup, les larmes lui montèrent aux paupières, débordèrent sur ses joues. Elle mordit son poing serré. Le message disait :
Il va bien, Martha. C’est devenu un bon garçon, aussi beau et fort que sa mère. Brûle cette carte après l’avoir lue. Et ne cherche pas à en savoir plus.
La carte n’était pas signée. Martha se demanda qui l’avait écrite. La carte parlait de lui mais pas d’ elle — était-elle morte ?
« Meredith », murmura-t-elle, et les larmes coulèrent de plus belle sur ses joues, brillantes comme du verre dans la lumière de l’été.
Aussitôt, elle regarda autour d’elle, presque effrayée, le cœur tel un oiseau qui se cogne à une vitre, comme si quelqu’un avait pu se dissimuler dans ce désert pour l’épier.
Pendant un long moment, elle resta plantée là, la carte à la main, les joues humides, la sueur ruisselant dans son dos sous ce soleil de plomb, perdue dans une sorte de brouillard. Pourquoi ? Pourquoi maintenant — après tout ce temps ? Pendant des années, elle avait espéré un signe, ouvert chaque matin sa boîte aux lettres avec un minuscule sursaut d’espoir — invariablement suivi de la petite déflagration de la déception —, des centaines, des milliers de matins à espérer ; autant de désillusions…
Et, à présent qu’elle n’attendait plus rien, à présent qu’elle s’était fait une raison — mais s’en fait-on vraiment une au tréfonds de soi-même, là où le cœur chuchote encore ? — , cette carte…
Elle refoula un sanglot, essuya son visage de ses deux mains. Déchira la carte en autant de morceaux qu’elle put, puis les lança rageusement dans le vent chaud qui faisait frissonner les hautes herbes sèches. Elle referma la boîte.
Sans se retourner, elle rejoignit le Dodge dont les chromes flamboyaient, mit le contact et démarra dans un nuage de poussière. Sur la vitre arrière, des autocollants clamaient FREE TIBET ou PAIX ET TOLÉRANCE. Une fois sur la route, elle accéléra, le regard fixé droit devant elle, à travers le pare-brise poussiéreux et constellé d’insectes morts.
Cet après-midi, elle irait nager dans la piscine du Maximus Fitness de Topeka, puis elle s’épuiserait sur les machines. Plus tard dans la soirée, quand l’air serait devenu un peu plus respirable, elle s’installerait sur sa véranda avec une bouteille de vin blanc qu’elle aurait préalablement mise à rafraîchir, un bon livre et ses chats, et, face à elle, le soleil prendrait tout son temps pour se coucher, dans la paix dorée des soirs d’été.
C’était tout ce qu’on pouvait attendre de la vie, n’est-ce pas ? Un peu de paix…
7.
Interrogations
« Comment tu te sens, Henry ? »
Les traits épais, le visage cerné d’un collier de barbe et des cils longs et noirs, le chef Bernd Krueger ressemblait à un acteur shakespearien dans un costume de shérif — ce qui, je vous l’accorde, est un pur anachronisme.
« Café ? a-t-il proposé de sa voix de stentor.
— Non, merci, j’ai dit.
— Coca ? Coca Zero ? Ocean Spray ?
— Non. Merci.
— Tu as faim ? Il y a des biscuits fourrés au beurre d’arachide dans le distributeur et il nous reste quelques pâtisseries danoises au fromage.
— Non, merci, chef… Ça ira…
— D’accord. Un joint alors ? »
J’ai relevé la tête.
« Hein ?
— Tu ne fumes jamais, Henry ? »
J’ai rougi. Réfléchi. Une demi-seconde de trop.
« Tu sais, on peut faire le test…
— C’est arrivé, j’ai finalement répondu, consterné par tant de perfidie. Pas souvent… pas souvent. Quel rapport avec… ? »
Et là, en levant les yeux, j’ai découvert que ce n’était pas comme au cinéma ou dans un jeu vidéo. Krueger n’avait pas la tronche de l’agent Smith dans Matrix ou de Steve Haines dans Grand Theft Auto V . Il avait l’air… normal . Cool, attentif, empathique. Et c’était encore plus flippant.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Une putain d’histoire»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Une putain d’histoire» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Une putain d’histoire» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.