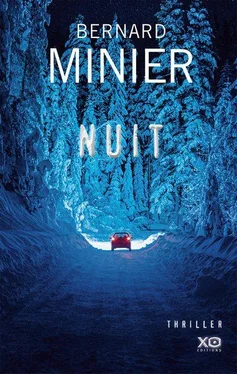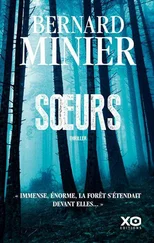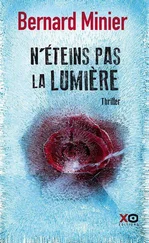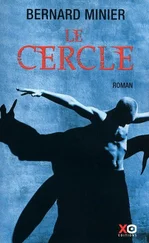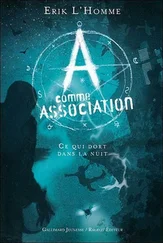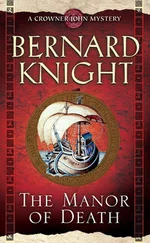— … disent que t’entends rien, lance Vincent depuis sa chaise.
Ils sont seuls dans la chambre, la porte ouverte sur le couloir, comme toujours.
Son adjoint se lève. S’approche du lit et pose les écouteurs sur ses oreilles.
Et… oh, Seigneur ! cette musique ! ce thème — le plus beau jamais écrit ! Oh, ce tumulte, ces saignements, ces mots d’amour ! Mahler… Son cher Mahler… Pourquoi personne n’y a-t-il pensé avant ? Il a l’impression que les larmes lui montent aux yeux, coulent sur ses joues. Mais il voit le visage de son adjoint — qui s’est penché et qui, de toute évidence, guette le moindre signe, le moindre symptôme émotionnel — et il ne lit rien d’autre que de la déception dans ses yeux, quand celui-ci ôte les écouteurs et se rassied.
Il voudrait crier : encore ! encore ! j’ai pleuré !
Mais seul son cerveau crie.
Une autre nuit. Son père de nouveau là, dans la chambre. Assis sur la chaise. Il lit un livre à voix haute. Comme quand Servaz était enfant. Il reconnaît le passage :
« Le squire Trelawney, le docteur Livesey et les autres gentlemen m’ayant demandé de coucher par écrit tous les détails concernant L’Île au Trésor , du commencement à la fin, sans omettre rien, si ce n’est la situation de l’île, et ceci uniquement à cause des trésors qui s’y trouvent encore, je saisis ma plume en cet an de grâce 17…, et reviens au temps où mon père tenait l’auberge de l’ Amiral Benbow , et où le vieux marin hâlé et balafré vint pour la première fois loger sous notre toit. » [6] R. Louis Stevenson, L’Île au Trésor , éditions G.P., 1948.
Qu’est-ce que t’en dis, fiston ? C’est quand même autre chose que ce que tu lis d’ordinaire, non ?
Son père doit faire allusion à ses nombreux volumes de S.-F. Ou peut-être à ses lectures actuelles. Et soudain lui revient en mémoire une autre lecture — terrifiante celle-là ; il devait avoir douze ou treize ans :
« L’horreur et le dégoût atteignirent alors, en Herbert West et en moi-même, une insoutenable intensité. Ce soir, je frissonne en y songeant, plus encore que ce matin où West, à travers ses bandages, murmura cette phrase terrifiante :
— Bon sang, il n’était pas tout à fait assez frais. »
Pourquoi ce souvenir refait-il surface maintenant ? Sans doute parce que, ce soir plus que les autres, il frissonne en la sentant présente dans les recoins sombres : celle qu’il a sentie dans cette maison lugubre, près de la voie ferrée — chemin du Paradis —, celle qui s’est attachée à ses pas depuis et qui l’a suivi jusqu’ici, comme une de ces malédictions qui, dans les films, passent d’une victime à l’autre.
Bon sang , doit-elle se dire, il n’est pas encore tout à fait assez prêt…
Il ouvrit les yeux.
Cligna des paupières.
Cligna des paupières… Ce n’était pas un mouvement imaginaire, cette fois. Ses paupières avaient vraiment bougé. L’infirmière de service lui tournait le dos. Il pouvait voir ses épaules et ses hanches tendre sa blouse tandis qu’elle examinait les feuilles de soins.
— Je vais vous faire une prise de sang, dit-elle sans se retourner — et sans attendre de réponse non plus.
— Mmmh.
Cette fois, elle se retourna. Le scruta. Il cligna. Elle fronça les sourcils. Il cligna de nouveau.
— Oh, merde, dit-elle. Vous m’entendez ?
— Mmmhhh.
— Oh, merde…
Elle fila. Le crissement de sa blouse contre ses bas Nylon lorsqu’elle quitta précipitamment la chambre. Quelques secondes plus tard, elle revenait avec un jeune interne. Visage inconnu. Lunettes à monture d’acier. Quelques poils au menton. Il s’approcha de lui. Se pencha. Très près. Le visage envahit son champ de vision. Servaz sentit l’odeur de café et de tabac dans son haleine.
— Vous m’entendez ?
Il hocha la tête et ressentit une douleur dans les cervicales.
— Mmmh.
— Je suis le docteur Cavalli, dit l’interne en prenant sa main gauche. Si vous comprenez ce que je dis, serrez-moi la main.
Servaz serra. Mollement. Il vit toutefois le médecin sourire. L’infirmière et lui échangèrent un regard.
— Allez prévenir le docteur Cauchois, dit le jeune interne à l’infirmière. Dites-lui de venir tout de suite.
Puis il se retourna vers lui et brandit un stylo devant ses yeux, le fit lentement passer de gauche à droite et de droite à gauche.
— Vous pouvez suivre ce stylo avec les yeux, s’il vous plaît ? Ne bougez pas. Juste les yeux.
Servaz s’exécuta.
— Génial. On va vous enlever ce tuyau et vous chercher de l’eau. Ne bougez surtout pas. Je reviens. Si vous comprenez ce que je dis, serrez ma main deux fois.
Servaz serra.
Il se réveilla de nouveau. Ouvrit les yeux. Le visage de Margot près de lui. Sa fille avait les siens embués mais il devina que c’étaient des larmes de joie, cette fois.
— Oh, papa, dit-elle. Tu es réveillé ? Tu m’entends ?
— Bien sûr.
Il prit la main de sa fille. Elle était chaude et sèche dans la sienne froide et moite.
— Oh, papa, je suis si contente !
— Moi aussi, je… (Il se racla la gorge, il avait la sensation d’avoir du papier de verre en guise de pharynx.) Je… suis… content que tu sois là…
Il avait réussi à dire cette phrase pratiquement d’une traite. Il tendit une main en direction du verre d’eau sur la table de chevet. Margot s’en saisit et l’éleva jusqu’à ses lèvres desséchées. Il regarda sa fille.
— Il… il y a longtemps que tu es ici ?
— Dans cette chambre ou à Toulouse ?… Quelques jours, papa.
— Et ton travail au Québec ? demanda-t-il.
Margot avait décroché plusieurs jobs là-bas ces dernières années, elle avait fini par faire son nid dans une maison d’édition canadienne. Elle s’y occupait du domaine étranger. Servaz avait été la voir deux fois et, chaque fois, la traversée en avion avait été une épreuve.
— J’ai pris un congé sans solde. Ne t’inquiète pas. Tout est réglé. Papa, ajouta-t-elle, c’est génial que tu sois… réveillé .
Génial. Le même mot que le jeune interne. Ma vie est géniale. Ce film est génial. Ce livre est carrément génial. Tout est génial, partout, tout le temps.
— Je t’aime, dit-il. C’est toi qui es géniale.
Pourquoi avait-il dit une chose pareille ? Elle le regarda, surprise. Rougit.
— Moi aussi… Tu te souviens de ce que je t’avais dit la fois où tu as fini à l’hôpital après cette avalanche ?
— Non.
— « Ne me fais plus jamais un coup pareil. »
Ça lui revint. L’hiver 2008–2009. La poursuite dans les montagnes en motoneige et l’avalanche. Margot à son chevet au réveil. Il lui sourit. Avec l’air de s’excuser.
— Putain, patron. Vous nous avez flanqué une de ces frousses !
Il était en train de prendre son petit déjeuner composé d’un café ignoble, de toasts et de confiture à la fraise — et aussi de médicaments — tout en lisant le journal, calé contre l’oreiller, lorsque Samira fit son entrée en coup de vent, suivie de Vincent. Il leva les yeux de l’article qui annonçait que Toulouse accueillait 19 000 nouveaux habitants chaque année et pourrait dépasser Lyon d’ici à dix ans, possédait 95 789 étudiants, 12 000 chercheurs, était reliée à 43 villes européennes par son aéroport, à Paris par plus de 30 vols quotidiens, mais — dans la queue le venin — l’article faisait ensuite remarquer que entre 2005 et 2011, les effectifs de la police toulousaine comme ceux de la police nationale dans son ensemble n’avaient cessé de diminuer pour des raisons strictement budgétaires et que cette baisse dramatique n’avait pas été totalement compensée depuis. Côté budget, il avait même fallu, en 2014, dispenser de formation technique certains policiers de la PJ. Cependant les événements du 13 novembre 2015 à Paris avaient radicalement changé la donne. La police, la justice étaient tout à coup redevenues prioritaires, les perquises de nuit autorisées (Servaz s’était toujours demandé pourquoi diable il n’était pas possible d’appréhender un individu dangereux avant 6 heures du matin — un peu comme si, pendant une guerre, il y avait une trêve toutes les nuits observée par un seul des deux camps), les procédures beaucoup plus simples. Le débat sur la restriction des libertés publiques et l’opportunité de proroger ces mesures n’avait cependant pas tardé à se ranimer, ce qui était sain et normal dans une démocratie, songea-t-il.
Читать дальше