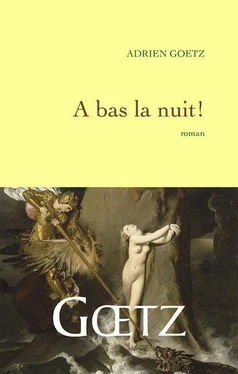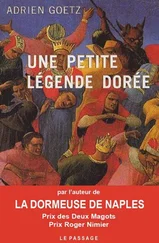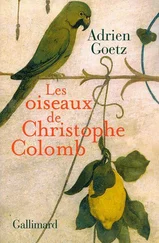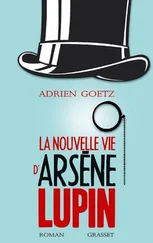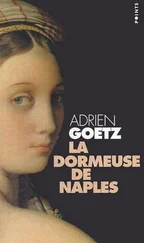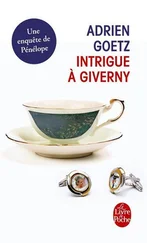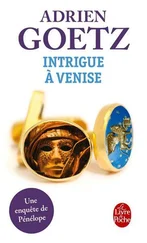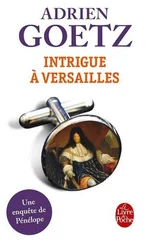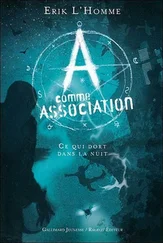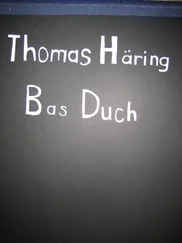« Ce n’était pas seulement pour les enfants, ces livres, vous savez. Il fallait apprendre à lire. Tous faisaient des efforts. Vous ne savez pas comme il y a ici une rage d’apprendre. Vous, vos parents étaient professeurs, médecins, vous croyez qu’il n’y a que comme cela que l’on réussit ses études. Aucun des parents ici ne parlait français, mais tous les enfants voulaient s’en sortir : la drogue, le sport, les trafics, les braquages, c’est aussi le moyen de parvenir, les études ne sont qu’un cas particulier. J’ai eu de la chance, je crois. Je me souviens. J’en parle au passé, mais on continue ici. Comme quand j’y étais : regardez, ce sont toujours des Tunisiens. Ils ont changé quelques affiches, mais rien n’a bougé. Je n’étais pas le seul à être devenu bon en classe. Chaque année, les écoles d’ingénieurs voient arriver quelques spécimens qui ont tout appris dans des trous à rats comme celui-ci. Ça donne envie d’air libre. J’avais commencé à sept ans par être un singe savant en calcul mental. Ici, on discute. On s’occupe des petits. Les mères les accompagnent, leur apprennent à compter, quand elles savent, ou s’y mettent avec eux, dans les deux langues. Les grands viennent en meute, faire du bruit avec le baby-foot. On entend leurs cris de victoire jusqu’au deuxième étage, ils apportent de l’alcool en cachette, des canettes de bière vers minuit et demi — je les avais surpris une fois. Je les ai regardés boire et fumer. Le seul baby-foot du quartier, mais nous défendions aux autres d’y venir. Puis, les réunions de l’équipe de foot, la vraie. Là, on ne se saoulait plus. Tout partait d’ici, les stratégies, les projets de changer de joueur, de faire des matches contre la cité d’à côté ou contre ceux de l’immeuble d’en face. Je ne participais à rien. J’ai appris le français ici : ma mère ne m’a pas donné de leçon d’arabe, elle le parlait mal, c’est difficile pour une Italienne. Elle ne pouvait parler l’italien avec personne.
Elle ne s’occupait pas vraiment de moi, ni d’elle-même, ni de mon père. Sa langue maternelle devenait peu à peu une langue morte pour elle, elle semblait résister à peine pour ne pas sombrer, pour ne pas se taire. Elle chantait, en italien. J’étais le seul fils unique de tout le quartier. Quand mon père est mort, — un accident sur un chantier — ma mère ne s’est plus trop intéressé à moi. Ce n’était pas sa faute. Les gens disaient qu’elle était folle. Je ne savais pas bien. Je restais dans mon coin. Mais je pouvais venir la trouver pour pleurer, elle me consolait avec les romances de sa jeunesse, de son pays. C’étaient des voix d’un autre monde. Je n’ai eu que l’école pour tout m’apprendre, en cachette des maîtres et des autres, sans jamais montrer que j’étais devenu très bon, et cette cave… Je restais des heures ici, à faire mes devoirs. J’écoutais tout, je voulais rire avec les autres. Je devins très tôt leur souffre-douleur. Vous n’avez jamais connu cela, vous. En classe, quand j’ai été, par hasard, le meilleur, ce fut pire. Les « Français » de l’école ne me le pardonnaient pas, les « Tunisiens », les « Algériens », les « Marocains », me voyaient comme un traître. On me prenait dans un coin de la cour pour me donner des coups de pied. Je n’étais d’aucun groupe, d’aucune bande, toujours exclu. Le pire a été un professeur, je le déteste rien qu’en y repensant : j’étais son meilleur élève, je croyais qu’il pourrait m’aider contre les autres. Or, un jour que je m’étais installé dans un renfoncement, avec un livre pour qu’on me laisse tranquille, il s’est moqué de moi devant les autres : va jouer, va courir, ne reste pas comme ça, va avec tes camarades. J’étais tellement désemparé. C’était l’époque, vers dix ans, où j’ai lu mille choses, bien au-dessus de mon âge, pour fuir. Ce qui me consolait le plus, c’étaient les livres qui parlaient de peinture. Je les dévorais à la bibliothèque du collège, je les relisais, j’observais la même page pendant des heures. J’étais si seul. Un autre univers, d’autres formes, des images d’un pays où je me sentais bien. Je croyais à ce que je voyais comme les enfants qui ont eu une éducation religieuse croient au Bon Dieu : la « foi de la petite enfance », je l’avais imaginée moi-même. Je ne savais pas où toutes ces choses se trouvaient. Jamais vu un vrai tableau, jamais vu un pinceau, un musée, jamais utilisé une toile, jamais parlé de peinture à personne. Les livres n’expliquaient rien, ils supposaient beaucoup de connu. Je devins ensuite, dès douze ans, très fort sur la vie des peintres, les œuvres, les époques qu’elles illustraient, les villes étrangères. J’avais appris à traquer les tableaux dans les livres d’histoire, dans les livres sur les capitales du monde. Ma « culture » vient de ce temps-là. Parfois, j’étonnais un professeur avec une date, un nom, mais c’était toujours un tel chahut que j’ai vite appris à me taire. Je n’avais pas un seul ami. Ni père, ni sœurs, ni frères. Je me taisais. Je me réfugiais dans ces images. Elles étaient toute l’affection que le monde pouvait me donner. »
Assis par terre tous les trois, sous le néon qui palpitait, entre les pieds du baby-foot, nous écoutions Maher. Il commençait le récit d’une époque pendant laquelle il s’était tu. Sa liberté, son détachement, sa délicatesse l’avaient mis sans qu’il le sache ni le veuille, de plain-pied avec les mieux éduqués du continent. Cela pouvait expliquer qu’il ait fait si vite amitié avec Konrad, prince de Faulx, et que Laura n’ait pas trouvé absurde de l’adopter, de vivre avec lui cette étrange histoire. Et l’amour avec Jeanne.
« Laura t’a servi de mère ?
— Non. Pourquoi ? J’ai une mère. »
Vivait-elle encore, comment était-elle sortie de sa vie, où était-elle ? Nous n’osions pas lui demander.
Rien ne semblait, dans la vie de tous les jours, affecter sa bienveillance, son ouverture d’esprit. Il savait se mettre à la place des autres, avoir l’air de penser pour vous, prévenant et prévoyant, visionnaire et imprévisible. Il ne gardait aucune rancœur. À qui eût-il pu s’en prendre ? Une enfance où, malgré tout, il avait découvert ce qu’il aimait. La vraie tristesse, à l’opposé, le marquait d’un abattement dont, on le voyait, il n’effacerait pas la trace.
Nous nous souvenions de ses gestes de somnambule quand il enfilait son pull noir, celui qu’il avait à l’enterrement de Konrad, visage clos, dans un hôtel à côté de la gare de Metz, deux jours après, pour l’enterrement de Jeanne. La vie lui infligerait peut-être quelques autres coups, elle ne diminuerait certainement pas, avec le temps, cette douleur.
Maher, dans ce sous-sol, assis en tailleur, nous a donné beaucoup de détails sur son enfance : ses fugues à seize ans, rejeté de tous. Il quittait La Plaine-Saint-Denis sans rien dire à personne. Petits voyages, d’un après-midi. Au Louvre, il avait voulu voir les arts face à face. La première fois, il était tellement énervé, tellement excité à l’idée des tableaux. Il nous a raconté que les cadres l’avaient étonné. À force de voir les peintures dans les livres, il n’avait jamais pensé qu’il fallût à ces images des baguettes de bois doré. L’architecture du palais, avec ses portes et ses colonnes, ses lignes de fuite en débandade, la cour carrée, tout l’avait stupéfié.
Il n’avait plus pensé à sa mère recluse dans leur appartement, là-bas, il n’avait plus pensé à Tunis, il n’avait plus pensé en arabe ou en français, il n’avait plus eu les mots pour décrire ce qu’il découvrait. Il n’avait plus pensé aux cours et aux récréations, où « les autres » le frappaient parce qu’il avait eu la meilleure note, il n’avait plus pensé qu’il était seul. Maher avait compris qu’il y avait désormais une infinité d’images nouvelles pour peupler ses songes. Et que ces amis, nouveaux, muets, mystérieux, seraient à lui.
Читать дальше