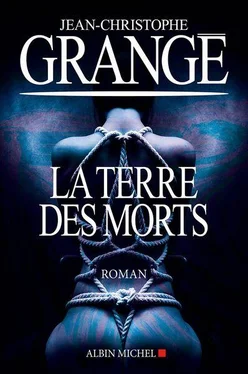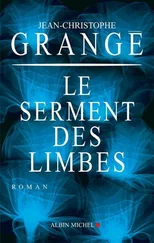Il dépassa le deuxième étage et continuait à monter quand il aperçut, à mi-chemin du suivant, par la porte entrouverte d’un appartement, Claudia elle-même. Assise dans un salon sur un canapé encore protégé de couvertures de feutre, elle écrivait sur son téléphone portable. Dans la lumière éclatante du jour d’hiver, son profil se découpait sur le ciel bleu — pas encore de rideaux aux fenêtres — avec la précision et la violence des coups de rasoir dans une toile de Fontana.
Il resta là à l’admirer. Le front bombé de jeune fille butée, le nez droit qui semblait provenir de l’époque bénie des sculptures grecques, les lèvres au dessin parfait et les sourcils qui, à un trait près, auraient pu être trop marqués mais qui emportaient au contraire l’ensemble vers la plus haute élégance. Peut-être que Claudia possédait une personnalité fascinante, un passé troublant, un charme spontané, tout ce qu’on voudra, il n’en avait rien à foutre. C’était cette beauté physique qui l’ensorcelait.
Catherine Bompart, quand elle parlait d’amour — ce qui bizarrement lui arrivait très souvent —, disait : « Les hommes n’aiment que l’extérieur, les femmes ne sont intéressées que par l’intérieur. Nous aimons le fruit et sa saveur. Ils se contentent des épluchures. »
Il se décida à achever son ascension et se dit, les yeux rivés sur Claudia : Va pour les épluchures .
Quand elle l’aperçut entre les portes entrouvertes et les déménageurs qui allaient et venaient, elle lui sourit — c’était bien le dernier truc auquel il s’attendait.
Malgré lui, il s’arrêta sur le seuil et Claudia vint à sa rencontre. Elle avait ce regard perdu qu’il avait déjà repéré plusieurs fois lors du procès. L’avocate décidée, manipulatrice, infaillible, avait souvent les yeux étonnés de quelqu’un qui navigue à vue, oscillant entre surprise et incertitude.
Elle lui adressa quelques paroles de bienvenue puis le poussa dans le salon et disparut préparer du thé. De plus en plus étonnant.
La pièce était petite mais il devinait que l’appartement était très vaste, peut-être même en duplex. Beaucoup de hauteur, peu de largeur. Pour l’instant, des meubles patientaient là, dans un désordre provisoire. Un canapé, une commode, un secrétaire… Du style ancien qu’il n’identifiait pas.
— Assieds-toi, ordonna-t-elle en revenant avec un plateau chargé d’une théière et de deux tasses.
Toujours le tutoiement. Il y vit cette fois une marque d’amitié. Il choisit un fauteuil en bois doré au châssis tarabiscoté et l’observa servir le thé. Assise sur une méridienne de velours rouge, elle n’avait pas l’air bouleversée par la mort de Sobieski mais elle n’était pas du genre à extérioriser ses sentiments. Son sang autrichien la verrouillait de l’intérieur.
— Qu’est-ce que tu fous là ? demanda-t-elle avec bonhomie.
— Je voulais te présenter mes condoléances.
Elle s’arrêta dans son geste, bec de la théière en l’air.
— Ne joue pas à ça avec moi.
— Je ne joue pas.
— Si tu es venu me narguer jusque chez moi, je…
— Non. Sérieusement. Je n’ai pas souhaité ça et je voulais te le dire.
— Tu es plutôt revenu sur les lieux du crime.
— Quel crime ?
— À travers moi, tu as tué Sobieski.
Il fit mine de se lever. Elle lui prit la main et le força à se rasseoir. Il se laissa faire. Pour être honnête, le contact de sa peau lui avait coupé les jambes.
— Je n’ai rien à voir avec le suicide de Sobieski, grommela-t-il.
— Disons que tu as été à fond dans ton rôle. De mon côté, je n’ai pas réussi à déjouer la manipulation dont Sobieski a été la victime.
— Tu en es encore là ?
— Ne me dis pas que tu es toujours persuadé qu’il est le tueur, riposta-t-elle en lui tendant une tasse.
Pour gagner du temps, il promena encore son regard sur le décor : des objets anciens — vase antique, sculpture primitive, livres d’art… — étaient posés sur des meubles ou simplement par terre. Impossible de dire s’ils n’étaient pas encore rangés ou si au contraire chaque chose avait déjà trouvé sa place.
Claudia, tenant sa tasse d’une main, déroula son autre bras sur le dossier et plaça ses pieds nus sous ses fesses — elle portait un jean et un pull ras du cou, simple mais exquis. Une position indolente qui tranchait vivement avec l’avocate des assises, sèche et volontaire, mais qui se mariait bien avec les volutes du thé qui s’épanchaient dans l’air.
Toujours pour se donner une contenance, Corso porta la tasse à sa bouche — du thé vert, qui transformait instantanément l’amertume en quelque chose de doux et de mélancolique, et dont la saveur vous rendait accro, comme le sexe ou le crack.
— Alors, tu vas te décider ? demanda-t-elle.
Corso sursauta.
— À quoi ?
— À m’avouer que tu es fou de moi.
Sa question aurait pu paraître cruelle mais Corso ne l’entendit pas ainsi. Claudia Muller était tellement habituée aux affaires criminelles, aux hommes qui découpent leur femme en lanières, aux tarés qui violent leurs proies jusqu’à les tuer, aux monstres qui s’en prennent aux enfants, que les sentiments naturels, les passions amoureuses, les cœurs brisés, tout ça, pour elle, c’était de la rigolade — et sans doute ne pouvait-elle évoquer ces thèmes qu’avec une légère ironie.
Il adopta le même ton amusé teinté de cynisme :
— Je plaide coupable.
Elle se redressa, posa sa tasse et se pencha vers lui au-dessus de la table basse. Elle s’approcha au point de se tenir à quelques centimètres de son visage, prenant même appui sur l’un des accoudoirs du fauteuil où il était assis.
— Alors, je veux te dire que tu n’as aucune chance.
Toujours pas de cruauté, plutôt un ton neutre, froid, impartial. Du genre, « les charges retenues contre mon client ne tiennent pas ».
— Pourquoi ? demanda-t-il stupidement, en éprouvant plutôt une sorte de soulagement.
Elle se laissa aller de nouveau dans la méridienne.
— Mon cœur est déjà pris, comme on dit dans les romans à l’eau de rose.
« Les romans à l’eau de rose », l’expression était démodée mais Barbie l’utilisait souvent, et elle ajoutait : « rose comme un cul », arguant que cette littérature parlait de plus en plus de sexe.
— Sobieski ?
Claudia resta muette. Comme souvent, la première hypothèse était la bonne. L’avocate ne valait pas mieux que toutes ces paumées qui écrivent aux tueurs en série en prison pour leur offrir leur amour.
Stéphane laissa le silence se prolonger, la meilleure méthode, d’après son expérience, pour faire passer le suspect aux aveux.
— Je l’ai découvert par sa peinture, commença-t-elle en effet. J’appartiens au milieu que tu exècres, les bobos intellos qui ne savent vers qui tourner leur instinct de révolte tant ils représentent eux-mêmes le pouvoir en place, l’ordre établi contre lequel ils voudraient se rebeller. Sobieski était une aubaine. On voyait en lui un Jean Genet ou un Lucian Freud. J’aimais le peintre. Je ne connaissais pas l’homme. Finalement, je l’ai croisé en 2015 dans un think tank consacré aux conditions de détention des prisonniers en longue peine.
Sobieski devait être le petit roi de ce genre de soirées. Le mec qui avait tout vu, tout connu, et qui était capable de pérorer jusqu’à l’aube.
— Je n’ai jamais rencontré un être aussi déplaisant, enchaîna-t-elle avec une curieuse grimace. Et pourtant, au fond de cette carcasse de coyote mal embouché, farci du matin au soir, j’ai senti quelque chose. Un être perdu, fracassé, lancé à corps perdu dans la peinture, la drogue et le sexe, pour oublier le trou noir de ses dix-sept années derrière les barreaux.
Читать дальше