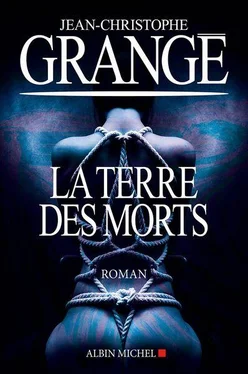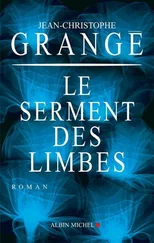Les gardiens, enfin. Documents, fouille, calibres au vestiaire. Puis le labyrinthe des portes, des couloirs, des barreaux. Corso ne supportait pas les prisons. Il y étouffait, comme tout le monde, mais ce qui le différenciait des autres, c’est qu’il s’y sentait chez lui. Il avait toujours eu le sentiment d’appartenir à l’univers carcéral. Il aurait dû écoper d’au moins dix ans pour le meurtre de Mama si Bompart ne l’avait pas couvert. Et de bien plus s’il était resté du mauvais côté du calibre.
Fleury était une taule de la taille du musée du Louvre. Quoi qu’on fasse, où qu’on aille, il fallait marcher au moins une demi-heure en traversant les pires odeurs de la Terre, celles de l’homme emprisonné qui ne cesse de régurgiter son amertume et son acidité.
Ils parvinrent à l’infirmerie. En dépit du nombre de détenus — plus de 4500 pour une capacité de 3000 —, la prison ne possédait qu’une unité de soins digne d’une école primaire. Une pièce dans laquelle deux lits à armature de fer se partageaient l’espace, avec une paillasse carrelée de blanc dans un coin, un négatoscope fixé au mur, une télé hors d’âge, une petite bibliothèque médicale…
Le responsable portait une espèce de blouse de papier bleu sombre qui lui donnait l’air d’un curé — sa chemise laissait apparaître un col blanc. Surtout, il était d’une solennité excessive, comme si une personne d’une importance considérable venait de mourir dans son modeste repaire.
— Vous n’avez pas de pensionnaires aujourd’hui ? s’enquit Corso, qui connaissait bien les habitudes des taulards, toujours malades.
— Ils ont pas voulu rester. À cause du corps.
Corso se demanda comment le Sobieski de deuxième génération — peintre-faussaire, tueur de strip-teaseuses — avait été accueilli à son retour au bercail.
— Suivez-moi, fit l’infirmier en s’inclinant à la japonaise.
Il y avait une autre pièce, celle de l’armoire à pharmacie et du « frigo ». C’était là que les choses sérieuses se déroulaient. Les médocs étaient sous clé. Quant au « frigo », il s’agissait d’un long compartiment réfrigéré sous un troisième lit aux allures de table d’examen. L’infirmier le fit coulisser sur ses rails.
Le cadavre était revêtu d’un drap dont les plis durs étaient figés comme du marbre, évoquant les tombeaux au fond des églises florentines.
Leur hôte dénuda le corps jusqu’à la taille : Sobieski paraissait avoir encore rétréci. Sa silhouette rappelait celle d’un adolescent. Malgré lui, Corso le revoyait de son vivant, sa gueule décharnée, son rire de travers, ses chicots agressifs. Sob la Tob .
— C’est terrible, commenta l’infirmier, les deux mains serrées à hauteur de l’entrejambe — vraiment un aumônier, ou un gamin qui a envie de pisser.
— Qu’est-ce qui est terrible ? demanda Corso, agacé.
— J’ai suivi de près l’affaire. Je le connaissais bien. Je suis un spécialiste de son histoire.
Il ne manquait plus que ça.
— Et alors ? rétorqua Corso, carrément agressif.
— Il n’aura pas eu le temps de démontrer toute la vérité.
La voix de l’infirmier résonnait dans les graves, comme le bourdon d’un clocher.
— Il a été condamné, non ?
L’homme eut un sourire consterné qui semblait tout particulièrement dirigé vers Corso.
— Allons, commandant, vous savez comme moi que cette affaire méritait plus qu’un verdict prononcé après deux heures de délibérations.
— En tout cas, bougonna Corso, il n’était pas innocent.
— Mais de quoi était-il coupable au juste ? interrogea l’autre en levant les yeux au ciel comme si Dieu en personne allait lui répondre.
— Il avait l’air déprimé ces derniers jours ? demanda Bompart.
— Il ne mangeait plus, il refusait de parler. Il s’enfonçait dans un isolement total et…
— Il a pas laissé un mot, coupa Corso, quelque chose ?
L’homme les regarda tour à tour, ménageant son effet, puis lâcha :
— Il a laissé mieux que ça.
Il s’orienta vers l’armoire à pharmacie qu’il déverrouilla avec plusieurs clés différentes. Le coffre-fort des soulagements, des sommeils chimiques, des délires artificiels…
Apparut une série de tiroirs de plastique gris, étiquetés ou portant parfois une inscription au marqueur. L’infirmier en ouvrit un et en sortit un sac à scellés.
Il revint et le posa sur le corps même, entre deux plis figés du drap.
— C’est quoi ? s’étonna Bompart.
— Le câble avec lequel il s’est pendu.
Corso avait déjà compris : à travers le papier transparent, s’enroulait un fil électrique gainé de plastique, s’achevant en une boucle tenue par une sorte de nœud coulant. Il reconnut aussitôt le nœud de prédilection du tueur du Squonk, un huit que l’assassin laissait ouvert pour exprimer « l’infini et au-delà ».
Mais cette fois, le huit était fermé.
Sobieski leur avait laissé un message : la série des morts s’achevait avec son suicide.
Une mauvaise idée, c’est comme un vice. Une fois qu’on l’a, impossible de passer à autre chose.
Le jour même, Corso essaya de joindre Claudia Muller sur son portable. Pas de réponse. Il ne savait pas pourquoi il voulait lui parler. Pour lui exprimer ses condoléances ? Il n’aurait pas été sincère. Lui soutirer quelques informations supplémentaires ? Vraiment pas le moment. En profiter pour se rapprocher d’elle ? Encore pire. Claudia considérait sans doute que son mentor était mort par sa faute à lui, et à lui seul, Stéphane Corso, flic buté et stupide.
Toujours est-il que le lendemain, le jeudi 7 décembre de bon matin, il décida de lui rendre visite. Il avait pris ses renseignements : Claudia Muller vivait maintenant rue de Miromesnil. Une fois n’est pas coutume, il prit le métro depuis Denfert-Rochereau et acheta les principaux journaux pour prendre la température des médias. Les points de vue étaient divisés en deux camps, à l’image de Corso et de Bompart : ceux qui pensaient que le suicide de Sobieski était un aveu de culpabilité et les autres qui estimaient au contraire que son acte était le geste désespéré d’un innocent condamné à tort.
Personne ne connaissait l’existence du nœud — pas divulguée dans la presse. Mais même ce détail était ambigu. L’évidence, c’est qu’en ayant recours au nœud du tueur, le peintre clamait qu’il était l’assassin. Mais quand on connaissait le bonhomme — comme Corso le connaissait —, ça pouvait être tout autant une ultime provocation. Façon de dire : « C’est ça que vous vouliez ? Eh bien, servez-vous. Je vous donne la preuve définitive, à votre insu, que vous êtes une sacrée bande de connards. »
En réalité, Corso ne se souciait plus de savoir qui avait tué, qui avait menti, qui était mort. Il avait décidé de tourner la page. La pendaison de Sobieski avait valeur de point final.
Mais impossible de renoncer à la belle.
La vérité était finalement très simple : il voulait profiter de la mort du peintre pour revoir Claudia Muller. Quand une mauvaise idée vous tient…
Son immeuble n’était pas un de ces monuments haussmanniens à la carrure solide et martiale du VIII earrondissement mais un bâtiment exigu, tout en briques, qui évoquait une tour haut perchée.
Pas besoin de code, des déménageurs avaient bloqué les portes ouvertes. Corso en déduisit qu’ils étaient là pour Claudia elle-même… Il grimpa un escalier en colimaçon — beaucoup plus XVIII eque XIX e —, croisant des gaillards les bras chargés d’objets empaquetés et de cadres enveloppés. Corso se demanda si Sobieski avait donné une toile à Claudia. Il ravala aussitôt son sarcasme. Pas le moment de déconner. Pas du tout .
Читать дальше