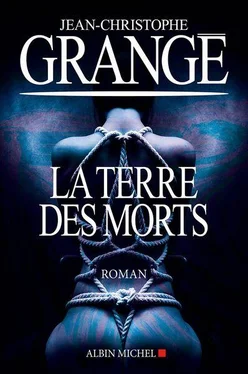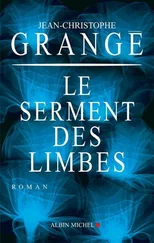Pour l’instant, c’était tout ce qu’il voyait et c’était suffisant. Claudia Muller était le genre de liqueur dont il ne fallait pas abuser. Une beauté à savourer à petites gorgées. Et de loin, parce que, encore une fois, Corso se dit : « Beaucoup trop belle pour toi. »
Enfin, arriva Michel Delage, le président du tribunal de grande instance, en robe noire et rouge surmontée d’hermine, avec ses deux assesseurs — en l’occurrence des femmes. Il y avait d’autres personnages dont Corso avait totalement oublié la fonction. Le plus impressionnant, c’était la longue suite de dossiers à couverture toilée qui se déployait en file indienne derrière eux : toute la procédure des meurtres du Squonk.
En fait, malgré la solennité des acteurs, malgré la beauté de Claudia Muller — celle qu’il fallait absolument garder à l’œil —, Corso se sentit encore plus fasciné par le dernier personnage à faire son entrée, Sobieski lui-même, dans son costard blanc de proxo, avec ses chaînes bling-bling et sa gueule décavée. Son visage était profondément marqué par son année de taule. Ses traits partaient de guingois, comme si un violent coup à la face lui avait désaxé la figure. Ses joues paraissaient plus creuses encore — Corso songea à celles de Marlene Dietrich et de Joan Crawford, les stars d’Hollywood qui s’étaient fait arracher les molaires pour dessiner une ombre au bas de leur visage félin.
Enfin, on allait juger le salopard.
Corso n’y croyait pas.
Et encore moins quand le président déclara d’une voix ferme :
— Accusé, levez-vous.
Depuis 2012, on ne lisait plus l’acte d’accusation au début du procès. Les faits reprochés furent tout de même brièvement exposés. La greffière trouva le moyen d’écorcher le nom des victimes et de se gourer dans la chronologie. Même Corso ne comprenait plus ce qui s’était passé. Pas grave, on était là pour revenir en détail sur les événements.
Le président informa l’accusé de ses droits et aussi de ce qu’il risquait au terme du procès : une condamnation à la réclusion à perpétuité. Aucune réaction de la part de Sobieski. Pas de trouble non plus du côté de Claudia Muller. L’accusé et son égérie répondirent, sans surprise, qu’ils plaidaient « non coupable ». Sans surprise, mais il y eut tout de même un murmure dans la salle. Compte tenu des témoignages et des preuves qui allaient suivre, une telle attitude était suicidaire.
Le président commença à interroger Sobieski. Docile, il répondit d’une voix éraillée, niant tout en bloc mais sans agressivité. Posé, modeste, il semblait s’être acheté une conduite. Pour le reste, son masque de clown blanc, cette tête de Pierrot fariné, jouait en sa faveur. En cet instant, il suscitait plutôt la pitié que la peur — certainement pas la haine.
Une fois les faits décrits puis contredits par l’accusé lui-même, le président se lança dans un portrait de Philippe Sobieski. Son histoire. Sa psychologie. Ses mobiles…
Aucun scoop à l’horizon. Corso connaissait par cœur le destin de l’artiste-tueur, scindé en trois parties. L’enfance et la jeunesse, crachées par le chaos comme de simples noyaux sanglants. Puis les dix-sept piges de prison où le criminel avait joué au juge, pratiqué le shibari et commencé à peindre. Les années de gloire et de liberté enfin, où il avait pris son envol pour devenir un artiste reconnu.
Des témoins qui avaient côtoyé Sobieski au fil de ces décennies défilèrent à la barre. Ceux de la première période ne firent qu’enfoncer le clou de sa culpabilité. Un enfant violent, un ado dangereux, un adulte violeur…
Les questions fusaient, Sobieski répondait. Les accusateurs — avocat général, partie civile — s’en donnaient à cœur joie. Tout ce qui était raconté, jusqu’au moindre détail, constituait des faits à charge. Surtout les quelques années qui avaient précédé le cambriolage des Hôpitaux-Neufs. Philippe Sobieski offrait l’image parfaite d’un prédateur sexuel, une vraie bête de sexe et de sang, qui se promenait sur la frontière française, longeant la Suisse et l’Italie, violant, volant, frappant.
Tout ça était assez ennuyeux. Le seul fait notable était l’absence de réaction de maître Muller, qui ne cherchait pas à défendre son client ni à mener des contre-interrogatoires. Elle laissait se dérouler — et s’approfondir — ce portrait de psychopathe dangereux et sans remords.
— La défense, des questions ?
— Pas de questions, Monsieur le Président.
Corso l’observait, fasciné. Ses traits avaient l’insolence de la beauté qui tient à quelques millimètres, parfois moins encore, et a l’air suspendue à sa propre grâce. La robe d’avocate offrait un cadre strict à cette harmonie et semblait l’accroître encore, comme les contraintes de la sonate ou les règles du nombre d’or ont produit de purs chefs-d’œuvre. Claudia était faite pour la robe et l’épitoge, la soie noire et le rabat blanc, comme certaines Japonaises sont faites pour le kimono.
On passa au premier meurtre, avec Jacquemart en guest-star, revenu du Jura. Corso n’écoutait plus. Il détaillait plutôt les personnages de la cour. Le président était un petit bonhomme aux cheveux rares qui semblait un peu limite dans son rôle de Saint Louis sous le chêne. Son embonpoint, son crâne dégarni, sa bouille de bon Français moyen lui donnaient plutôt l’air d’un tâcheron du glaive et de la balance.
À gauche, l’avocat général, un dénommé François Rougemont, arborant la Légion d’honneur et l’ordre du Mérite, avait un physique foisonnant : beaucoup de cheveux, beaucoup de sourcils, beaucoup de menton… Une vraie tête d’orateur façon XIX e siècle, l’époque où on portait la mèche longue, le col haut et le gilet serré sur sa lavallière.
L’avocate de la partie civile, maître Sophie Zlitan, était plus discrète : petite, boulotte, dans la cinquantaine, elle avait l’air de les avoir bien accrochées, si on pouvait dire. Avec sa coupe blonde, comme passée dans un gaufrier, elle lui rappelait Bompart à l’époque de leur brévissime liaison. Le genre à dégainer sans crier gare.
Les témoins du Jura se succédaient mais le président abrégea. Après tout, Sobieski avait payé sa dette envers la société et le lien avec les meurtres du procès actuel n’était pas si évident.
Toujours pas un mot de maître Muller.
On passa aux décennies de taule. Les années shibari. Le temps du « Juge », des diplômes et de la peinture. Ce nouveau chapitre en rajoutait dans l’ordre du toxique et du malsain. Les jurés étaient servis : hormis son talent d’artiste, l’accusé ressemblait à une caricature négative. Même son intelligence, sur laquelle tout le monde s’accordait, semblait toujours au service de calculs sournois et de jeux vicieux.
L’avocat général et l’avocate de la partie civile ne prenaient même pas la peine d’interroger les directeurs des prisons ou les anciens détenus après le président, et Claudia Muller s’obstinait dans son mutisme. Que cherchait-elle ? Quelle était sa ligne ? Elle devait posséder des armes de destruction massive qui allaient balayer tous ces soupçons.
L’après-midi fut consacré aux psychiatres.
Le premier ouvrit le feu avec un discours pontifiant. Le gars, collier de barbe, pull jacquard, accumulait les idées toutes faites comme on empile des Lego. Une pichenette aurait suffi pour faire tout tomber. Corso ne jouait pas dans l’équipe de Sobieski mais il n’aurait pas souhaité à son pire ennemi un tel saucissonnage du cerveau. Le médecin expliquait tout, commentait tout — pour accoucher d’une souris. L’enfance, la taule, l’art même, tout prédestinait l’accusé à commettre ces meurtres fomentés sous le signe de son maître, Goya. Bonjour le scoop .
Читать дальше