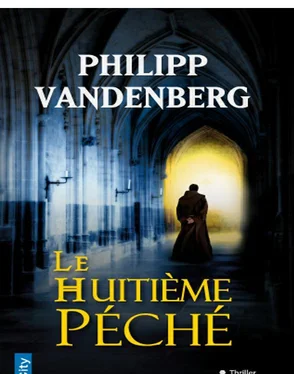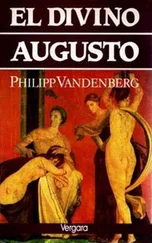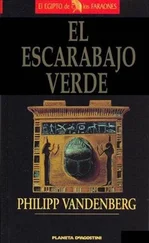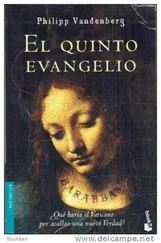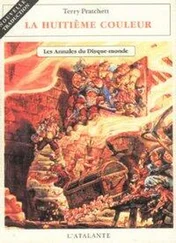Les génies, il en avait fait l'expérience au château de Layenfels, étaient vaniteux...
Anicet s'endormit sur cette idée. Il se réveilla au son de la cloche d'une église. Encore somnolent, il mit de l'ordre dans ses pensées en se rasant. Puis il prit son petit-déjeuner et régla sa note.
Il fit à pied le bout de chemin qui le séparait de la Luisenstraat. La pluie s'était calmée et la brise fraîche du matin était revigorante.
Leonardo lui avait conseillé de passer par-derrière.
Anicet s'engagea donc dans la petite ruelle dont les pavés étaient encore humides.
Il passa à côté des poubelles dans la cour intérieure et arriva à la porte par laquelle Leonardo l'avait fait sortir la veille. Il n'y avait pas de sonnette. Anicet frappa du poing sur le bois.
À l'intérieur, personne ne réagit. Anicet appuya sur la poignée. La porte n'était pas fermée.
- Maître Leonardo ! cria Anicet après avoir pénétré dans le couloir voûté. Maître Leonardo !
Comme la veille, la lumière était allumée. Anicet rejoignit à l'autre bout du couloir l'escalier pentu qui menait à l'étage.
Il gravit lentement les marches, l'une après l'autre, en espérant que le grincement bruyant attirerait l'attention de Leonardo sur son visiteur matinal.
- Maître Leonardo ! cria-t-il de nouveau, Maître L...
La voix d'Anicet s'étrangla soudain. Leonardo pendait à une corde accrochée au plafond de l'atelier. Une langue blanche comme de la viande avariée pendait de sa bouche ouverte.
Ses yeux exorbités, telles deux boules de verre laiteux, fixaient le vide. Sa tête, penchée sur le côté, laissait voir la naissance irrégulière de sa barbe.
Comme la veille, Leonardo portait son gilet et ses hauts-de-chausses rouges. Son bras gauche pendait le long de son corps. Le bras droit était légèrement replié et cachait son sexe, exactement comme sur le plus grand de ses chefs-d'œuvre, le suaire de Turin. Hasard ? Ou ultime message ?
Leonardo se mit tout à coup à tournoyer sur lui-même. Anicet laissa échapper un cri de stupeur. Mais il remarqua bientôt que c'était le courant d'air qui entraînait le cadavre dans cette danse macabre.
Ce spectacle inattendu avait paralysé les facultés de réflexion d'Anicet. Il retrouva lentement ses esprits. Que s'était-il passé ? L'attitude de Leonardo, la veille au soir, ne laissait en rien présager qu'il eût été las de la vie.
Anicet regarda autour de lui. Le désordre qui régnait dans l'atelier était le même qu'hier. Tous les tableaux se trouvaient à leur place, du moins dans la mesure où Anicet pouvait s'en souvenir.
Il remarqua seulement un escabeau d'environ deux mètres de haut, qui se trouvait juste à droite à côté de l'escalier. Il doutait de l'avoir vu la veille à cet endroit.
Soudain, il comprit : Leonardo était accroché à au moins un mètre et demi du sol, or rien ne permettait de comprendre comment il avait pu fixer la corde à la poutre. Il n'y avait même pas de chaise, ici, et d'ailleurs une chaise aurait été bien trop basse.
Il restait l'échelle, et celle-ci était appuyée au mur.
La certitude que Leonardo ne s'était pas suicidé gagna peu à peu Anicet. En même temps, il comprit qu'il était temps de quitter les lieux, et ce le plus rapidement possible.
27
Sur toute la durée du trajet en direction de Santa Maddalena, Caterina se demandait comment la marquise Falconieri avait pu tomber si bas. Santa Maddalena était le nom de la prison pour femmes dans laquelle Lorenza Falconieri était incarcérée depuis deux semaines.
Les aristocrates désargentés n'avaient rien d'exceptionnel en Italie, mais qu'une marquise dévie à ce point du droit chemin n'était pas vraiment courant. Dans l'exercice de son métier de journaliste spécialisée dans les affaires judiciaires, Caterina avait acquis une certaine expérience dans les démarches à mener pour obtenir un droit de visite dans une prison.
Elle devait absolument parler à la marquise. N'avait-elle pas été l'amie de Marlène ? Peut-être serait-elle en mesure de faire un peu la lumière sur son existence mystérieuse.
Pendant que le chauffeur de taxi se frayait un chemin à travers la circulation dense du matin, Caterina ne pouvait s'empêcher de penser que Lorenza Falconieri pouvait même avoir été mêlée, d'une manière ou d'une autre, à l'assassinat de Marlène. Ne serait-ce qu'en tant que complice. Mais pour quelle raison ?
Un vent froid soulevait de petits nuages de poussière sur le parking devant le bâtiment lugubre en briques, dont l'architecture martiale était déjà impressionnante en soi. L'entrée de la prison était très étroite, comparée aux dimensions des bâtiments auxquels elle donnait accès. Ce détail répondait certainement à une volonté délibérée. Toujours est-il que Caterina ressentit une certaine angoisse lorsque la porte d'entrée se referma derrière elle.
Elle se retrouva dans le sas d'entrée devant un guichet avec une vitre blindée, percée d'une ouverture ovale, surmontée de la consigne : Parler ici . Caterina exposa sa requête : elle désirait parler à la marquise Falconieri.
Une matrone à lunettes, aux cheveux coupés très court, boudinée dans une espèce d'uniforme, aboya dans le judas :
- Parente ?
Caterina, qui s'attendait à cette question, répondit sur le même ton :
- Au deuxième degré.
La matrone lui jeta un regard perplexe à travers la vitre blindée.
- Ma mère et la sœur de la marquise sont de la même famille.
La femme en uniforme réfléchit un instant, du moins donna-t-elle cette impression, avant de tendre par l'ouverture ovale un formulaire à Caterina, en lui demandant avec une politesse subite :
- Merci de remplir ceci. Et donnez-moi votre carte d'identité, s'il vous plaît.
Caterina s'exécuta, puis une commande actionnant l'ouverture automatique grésilla à côté du guichet. Elle put alors entrer. Une autre femme en uniforme l'attendait derrière une table, dans une pièce aveugle carrelée de blanc et éclairée par un néon éblouissant. Elle lui ordonna de poser son sac sur la table.
Puis elle passa le long du corps de Caterina un instrument qui ressemblait à une raquette de tennis. Elle finit par faire entrer Caterina dans un long corridor où une autre surveillante l'attendait. Contre toute attente, cette dernière lui fit un signe de tête amical et la pria de la suivre.
Le parloir se trouvait au sous-sol. Il était éclairé par deux ouvertures étroites en pavés de verre, pratiquées dans le plafond. L'ameublement se réduisait à une table et deux chaises, ainsi qu'une autre chaise qui se trouvait à côté de la porte, laquelle était dépourvue de poignée. Caterina s'assit à la table.
La marquise arriva un bon moment après.
- Vous ? dit-elle, étonnée. Vous êtes la dernière personne que je m'attendais à voir !
La marquise portait une jupe gris-bleu et un corsage de la même couleur, dont se dégageait une odeur de désinfectant. Elle avait relevé à la hâte ses cheveux en chignon. Elle semblait pâle et résignée.
- Je suis ici pour parler de Marlène Ammer, déclara Caterina tout de go.
- Alors vous êtes venue pour rien ! répliqua aussitôt la marquise, de mauvaise humeur, en feignant de se lever pour quitter la pièce.
Caterina posa son bras sur celui de la marquise.
- Marquise, je vous en prie !
- Je ne veux plus rien avoir à faire avec les journalistes, jeta Lorenza Falconieri d'un ton acerbe. Je n'ai eu que de mauvaises expériences avec eux, vous comprenez ?
- Marquise, je ne viens pas en tant que journaliste, mais à titre privé. Je vous prie de me croire !
- Qu'entendez-vous par « à titre privé » ?
- Vous souvenez-vous de Lukas Malberg ?
Читать дальше