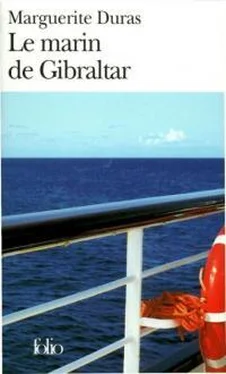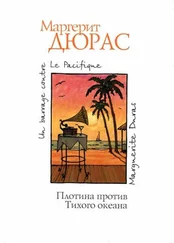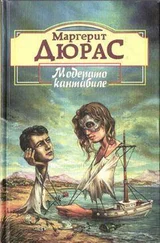Il demanda s'il devait faire des œufs. Elle dit que ce n'était pas la peine. Je commandai encore une autre carafe de vin.
— Alors, comme ça, vous avez fini ? demanda le patron.
— On a fini, dis-je.
On parla encore un peu, du patron qui était sympathique, de sa femme qui tricotait dans un coin, qui était assez belle. Puis, bien sûr, je lui demandai de me parler encore. Mais elle s'y attendait.
— Je voudrais savoir la fin de cette histoire, dis-je, de la femme du marin de Gibraltar.
Elle ne se fit pas prier. On ne mangeait plus, on buvait, on buvait toujours plus. On n'avait rien à se dire, à cause de la chaleur aussi, croyait-on. Alors elle me raconta volontiers leur vie à Londres. L'ennui à Londres. Que, cette fois, après leur rencontre de Marseille, elle n'avait pas pu l'oublier, l'ennui à Londres aidant, sans doute. Puis la paix, la découverte des camps de concentration, puis ce dimanche — il ne s'était rien passé de décisif dans les jours qui avaient précédé — où elle avait décidé de rentrer à Paris. Qu'elle était partie un après-midi, pendant l'absence de son mari, qu'elle lui avait laissé une lettre. Puis elle s'arrêta de parler.
— Je suis saoule, dit-elle. Ce vin.
— Moi aussi, dis-je. Qu'est-ce que ça fait ? Tu lui disais quoi dans cette lettre ?
— Je ne sais plus très bien, l'amitié que j'avais pour lui. Je lui ai dit aussi que je savais l'horreur des chagrins d'amour, mais que je ne pouvais plus vivre seulement pour les lui éviter. Et que je l'aurais sans doute aimé si le sort, oui j'ai dit le sort, ne m'avait pas si étrangement enchaînée au marin de Gibraltar.
Elle fit une grimace.
— C'est une sinistre histoire, dit-elle.
— Continue.
— Je suis arrivée à Paris. Puis, pendant trois jours, je me suis promenée, un peu partout. Je n'avais pas marché autant depuis Shanghai, cinq ans plus tôt. Au bout de trois jours, un matin, dans un café, j'ai vu, dans un journal qui traînait sur une table, une information sur mon mari. Il s'était tué. Un héros de Londres a mis fin à ses jours. C'était le titre de l'information. Ces choses-là, dans le milieu de mon mari, faisaient l'objet d'informations. Mais tu vois, c'est terrible, la première chose à laquelle j'ai pensé en lisant ça, c'est que puisque c'était dans le journal, lui pouvait le lire. Une manière de lui donner de mes nouvelles. Mon hôtel était occupé par des F.F.I., excepté le premier étage, où se trouvait ma chambre. J'ai été trouver les F.F.I. et je leur ai demandé de me laisser occuper ma chambre pendant trois jours. Ils me l'ont permis et même de disposer d'une ligne de téléphone. Pendant trois jours, après que l'information fut passée, je suis restée dans cette chambre. La concierge m'apportait à manger en pleurant, elle aussi, elle avait lu l'information. Elle comprenait, disait-elle, mon chagrin. L'information précisait qu'il s'était tué parce que ses nerfs fragiles avaient été trop éprouvés par la guerre. J'ai donné trois jours au marin de Gibraltar pour arriver à Paris au cas où il ne s'y serait pas trouvé, et venir me rejoindre. En somme pour être sûre qu'il vivait. J'ai lu, je ne sais plus quoi. S'il n'avait pas téléphoné, alors je me serais tuée. Je me l'étais promis, c'était là la seule chose qui me permettait de ne pas trop penser à ce que j'avais commis en quittant Londres. J'ai adjuré le sort de me le rendre et pour cela je lui ai donné trois jours. Le soir du deuxième jour, j'ai reçu son coup de téléphone.
Elle s'arrêta encore une fois de parler.
— Après ?
— On a vécu cinq semaines ensemble, puis il est parti.
— Ça… a été comme avant ?
— Ça ne pouvait pas être comme avant. Nous étions tout à fait libres.
— Mais raconte.
— On s'est parlé davantage. Un jour il m'a dit qu'il m'aimait. Ah oui, puis un autre soir je lui ai reparlé de Nelson Nelson. On en avait un peu parlé quand on s'était retrouvés, mais comme ça, pour en rigoler. Ce soir-là je lui ai dit que je savais que lorsqu'il était très jeune, il avait été renversé par une auto, qu'on l'avait fait monter dans l'auto pour le conduire à l'hôpital, que le patron de cette auto était vieux, gros et qu'il lui avait demandé s'il avait mal, qu'il lui avait dit que non. Il n'a pas résisté. Il m'a raconté la fin de l'histoire. Il m'a dit que l'Américain lui avait dit : la tête saigne toujours beaucoup, et qu'il avait trouvé qu'il le regardait avec un drôle d'air. Que comme c'était la première fois qu'il roulait dans une bagnole pareille, il lui avait demandé quelle marque c'était et que l'Américain lui avait dit que c'était une Rolls Royce, en souriant. Que tout de suite après il avait ouvert son pardessus et qu'il avait sorti de son gilet un très gros portefeuille. Qu'il l'avait ouvert. Qu'on voyait clair dans l'auto à cause des becs de gaz. Que l'Américain avait sorti une liasse de billets de mille francs et qu'il avait vu qu'il en restait au moins quatre dans le portefeuille. Qu'il avait enlevé l'épingle de la liasse qu'il tenait et qu'il avait lentement commencé à compter. Qu'il saignait beaucoup et qu'il voyait mal, mais qu'il l'avait vu compter, que ça, il l'avait bien vu. Mille francs. Il m'a dit qu'il se souvenait encore de ses doigts blancs et gras. Deux mille francs. Qu'il l'avait regardé encore une fois. Puis qu'il avait hésité, puis qu'il avait pris le troisième billet. Puis le quatrième, en hésitant encore plus. Puis qu'il s'était arrêté à quatre, qu'il avait replié la liasse et qu'il l'avait remise dans le portefeuille. Que ç'avait été à ce moment-là qu'il l'avait tué. On n'en a jamais plus reparlé.
Elle s'arrêta une nouvelle fois de parler et me considéra, un peu moqueuse, mais toujours très bienveillante.
— Tu n'aimes pas beaucoup cette histoire, dit-elle.
— Ce n'est pas une raison, dis-je, je voudrais quand même la connaître.
— C'est lui ? Lui, qui ne te plaît pas ?
— Je crois que oui. Je veux dire, les marins de Gibraltar.
Elle attendait que je parle, souriante, sans reproche aucun dans le regard.
— Je me méfie un peu des destinées exceptionnelles, dis-je. Je voudrais que tu me comprennes.
J'ajoutai :
— Même de ces destinées-là.
— Ce n'est pas de sa faute, dit-elle doucement. Il ne le sait même pas que je le cherche.
— C'est de la tienne, dis-je. Tu voulais vivre le plus grand amour de la terre.
Je ris. Nous étions un peu saouls.
— Qui n'a pas voulu le vivre ? demanda-t-elle.
— Bien sûr, dis-je, mais on ne peut les vivre qu'avec eux, qu'avec des types comme lui.
— Ce n'est pas de leur faute, dit-elle, si on les aime pour de mauvaises raisons.
— Non, ce n'est pas de leur faute. Et puis les mauvaises raisons, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois qu'on peut aimer les gens pour les plus mauvaises raisons, je ne crois pas que ce soit ça.
— Mais si tu ne les aimes pas, pourquoi veux-tu entendre leur histoire ?
— Parce que ce sont ces histoires-là que je préfère.
— Les fausses histoires ?
— Non, si tu veux, les histoires interminables. Les bourbiers.
— Moi aussi, dit-elle.
— Je vois, dis-je en riant.
Elle rit aussi. Puis elle demanda :
— Si ce n'est pas ça, c'est quoi ?
— Pendant qu'il faisait son éblouissante carrière, dis-je, j'étais le cul sur une chaise à l'État civil, c'est peut-être pour ça.
— Je ne crois pas, dit-elle, que ce soit ça.
— Il devrait m'éblouir, dis-je.
— Oh non, dit-elle. Mais cet homme qui passe pour le déshonneur du monde, et qui le regarde, ce monde, avec des yeux d'enfant, il me semble que tout le monde doit pouvoir l'aimer…
— Tout le monde l'aime celui-là, dis-je. C'est celui que tu en as fait…
Читать дальше