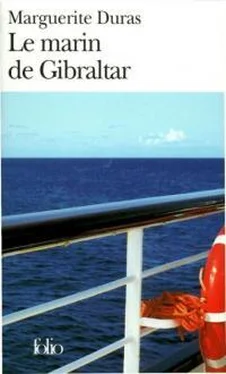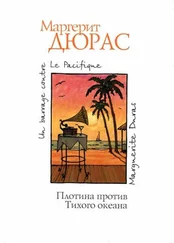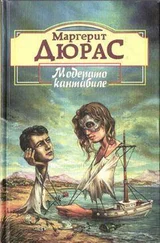Il marchait le long du fleuve tout en fumant. J'étais content de le rencontrer. Je n'avais jamais aimé les vieillards et leurs conversations m'avaient toujours impatienté, mais ce soir-là, j'aurais pu parler à un centenaire, que dis-je ? à un fou.
— Il fait chaud, dit-il, vous avez chaud sous la moustiquaire, non ?
— C'est ça, dis-je, on dort mal quand il fait aussi chaud.
— Ce sont les moustiquaires qui tiennent chaud. Moi, je dors sans, ma peau, elle est vieille, alors, les moustiques, ils ne veulent plus de ça.
Je voyais bien sa figure à la lueur reflétée du fleuve. C'était un paquet de rides très fines. Quand il riait ses joues se bombaient, ses yeux s'éclairaient, il prenait un air de vieil enfant un peu vicieux.
— Je ne sais pas ce qu'ils attendent pour répandre le D.D.T., là, au bas de la montagne. Trois ans qu'ils disent on vient, on vient.
Il pouvait dire n'importe quoi. Je devais le regarder comme si c'était pour moi essentiel, ce qu'il allait me dire. Quand même il paraissait légèrement étonné.
— Il n'y a pas que les moustiques, dis-je, il y a la musique qui empêche de dormir.
— Je comprends. On ne fait pas l'habitude en un jour, dit-il, mais demain vous ferez déjà l'habitude.
— Bien sûr, dis-je.
— Eh, quand même, on ne peut pas empêcher le bal, non ?
— Oh non, dis-je, on ne peut pas.
— Mais vous verrez, dit-il, on fait plus vite l'habitude de la musique que des moustiques.
— Sans doute, dis-je.
— Ce n'est rien ici à côté des colonies, repris-je, pour les moustiques.
— Vous venez des colonies ?
— J'y suis né, j'y ai grandi.
— Le frère de ma femme, il était en Tunisie, il faisait l'épicier à Tunis.
On parla des colonies pendant un bon moment. Puis il revint aux moustiques. Cette question le préoccupait. Il s'énerva un peu.
— Un moustique, dis-je, un seul, peut gâcher une nuit.
— Vous croyez qu'ils ne le savent pas à Sarzana ? Ils le savent. Mais à Sarzana il n'y a pas de moustiques, alors ils oublient.
— Pourtant ce serait si simple. Un coup de D.D.T. et c'est fini.
— Cette mairie de Sarzana, elle ne marche pas.
— C'est par là que nous sommes arrivés. C'est une belle petite ville.
— Je ne sais pas si c'est belle, dit-il, irrité, mais ce que je sais c'est qu'ils s'occupent d'eux à Sarzana.
— Quand même, j'ai trouvé que c'était une belle petite ville.
Il se radoucit.
— Vous trouvez que c'est belle ? C'est curieux, d'habitude on ne trouve pas. Ce qu'il y a, c'est que c'est bien ravitaillé. On y va en barque chaque semaine par la Magra.
La navigation, c'était un sujet d'importance. Si je m'y prenais bien, je pouvais le retenir encore un long moment.
— Il y a beaucoup de mouvement sur la Magra ? débutai-je.
— Il y en a encore assez, dit-il. Toutes les pêches de la plaine, elles passent par ici. Dans les bateaux elles s'abîment moins que dans le train et que dans les cars.
— Et où vont-elles comme ça, ces pêches ?
Il me montra du doigt un point lointain de la côte qui brillait.
— Par là. A Viareggio. Et aussi par là — il montra un autre point de la côte de l'autre côté —, c'est La Spezia. Les plus belles partent par le fleuve. Les autres, celles pour faire la confiture, elles partent par le car.
On parla des pêches. Puis des fruits.
— On m'a dit que les fruits de la région étaient très beaux, dis-je.
— Ils sont très beaux. Mais les pêches du Piémont, elles sont plus belles que les nôtres. Ce qui est le plus beau pour nous, c'est le marbre, ça oui.
— C'est ce jeune homme dont je vous ai parlé qui m'a dit ça. Son père habite par ici, je ne sais pas où.
— A Marina di Carrara, dit-il, vous allez sur la plage pendant trois kilomètres et vous êtes à Marina di Carrara, c'est là. Justement c'est le port du marbre. Il en part des bateaux et des bateaux.
— Il m'a dit que son cousin habitait ici aussi, dis-je. Qu'il fait de la pêche sous-marine.
— Son cousin il habite ici, dit-il, mais de l'autre côté, pas sur la mer, sur le fleuve. Il fait le marchand de fruits. Mais c'est pas très belle, son village, Marina di Carrara, c'est très belle.
— Il doit venir samedi, dis-je, on doit faire de la pêche sous-marine ensemble dans le fleuve.
— Je ne comprends pas, dit-il, ce qu'ils ont cette année avec la pêche sous-marine, tous, ils font la pêche sous-marine.
— On ne peut pas s'imaginer, dis-je, ce que c'est, quand on n'en a jamais fait. C'est très beau, il y a des couleurs extraordinaires. Les poissons vous passent sous le ventre, et puis c'est calme, on ne peut pas s'imaginer.
— Eh, vous aussi, je vois, vous la faites.
— Je n'en ai jamais fait, dis-je, je vais en faire samedi avec lui, mais c'est connu.
On n'eut plus grand-chose à se dire. Il me reparla encore du marbre.
— Vous verrez, dit-il, à Marina di Carrara, tout le marbre sur le port, il attend de partir.
— Il ne m'a pas parlé du marbre, dis-je machinalement. C'est cher, le marbre de Carrare.
On parla du marbre.
— C'est le transport qui le fait cher, c'est lourd, et fragile. Mais ici, bien sûr ce n'est pas cher. Dans cette plaine on est tous enterrés dans le marbre, même les pauvres — il sourit — je lui souris aussi, on pensa à la même chose. Ici, même les éviers des cuisines ils sont en marbre, continua-t-il.
Puis j'arrivai, à partir de ce marbre qui partait dans le monde entier, à le faire parler de ses voyages. Il n'était jamais allé à Rome mais seulement à Milan, c'était cette fois-là qu'il avait vu les pêches du Piémont. Mais sa femme, elle, elle connaissait Rome. Elle y était allée une fois.
— C'était pour donner l'alliance au Duce, comme toutes les femmes de l'Italie. Pour ce que ça nous a rapporté, elle aurait mieux fait de la garder.
Il aimait les Français. Il en avait connu en 1917. Il croyait que les Français méprisaient les Italiens.
— Qu'est-ce qu'on ne fait pas croire aux gens pendant les guerres, dis-je.
Mais il trouvait qu'ils avaient raison.
— Quand même, dit-il, notre petite sœur latine, ils nous ont forcés à la bombarder. Qui peut effacer ça ?
Ces souvenirs le faisaient visiblement encore souffrir. Je changeai de conversation. Au fait, que faisait-il là, si tard, à se promener sur ce chemin ?
— Le bal m'empêche de dormir, dit-il. Alors les soirs de bal je me promène. Et puis je surveille la petite, la plus jeune de mes filles, la Carla. Nous l'avons eue très tard, elle a seize ans. Si je me couchais, elle se sauverait au bal.
Il devait beaucoup aimer cette Carla. Il sourit en parlant d'elle.
— Elle n'a que seize ans. Il faut que je la surveille encore, il pourrait lui arriver du mal.
— Quand même, dis-je, de temps en temps, elle pourrait y aller. Et comment la marierez-vous, si vous ne l'envoyez pas au bal ?
— Pour ça, dit-il, on la voit suffisamment dans la journée. Elle va au puits dix fois par jour au lieu de cinq qu'elle devrait, qui seraient nécessaires et je la laisse y aller. Et puis voyez, mes autres filles, il y a bien trois ans qu'elles vont au bal et ça n'a servi à rien, elles ne sont pas encore mariées.
Il se demandait s'il arriverait jamais à les marier, surtout l'aînée. Alors que je ne m'y attendais pas du tout, dès qu'il me parla de ses filles je recommençai à bander. Une petite inquiétude me traversa. Saurai-je un jour clairement ce que je voulais ? Ce qu'il me fallait ?
— Il y a bien des candidats de temps en temps, dit-il, mais c'est pauvre, et ils ont peur devant le mariage. On gagne trop peu en Italie.
— Puis, ajouta-t-il, c'est de la Carla qu'ils veulent tous, pas des autres.
Читать дальше