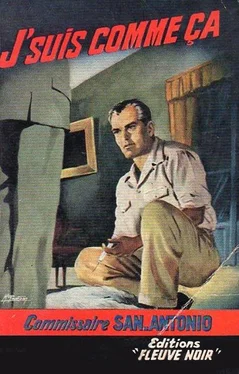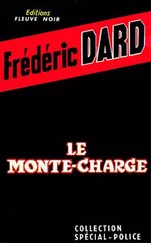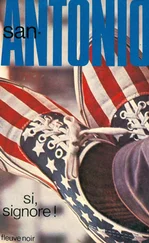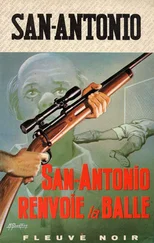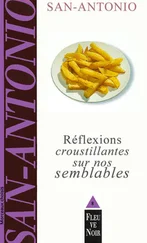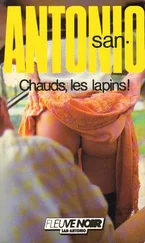J’hésite à comprendre…
— Le climat est tel, en ce moment, avec la Pleurésie, poursuit le Tondu, que l’assassinat d’une telle personnalité serait catastrophique.
— Mais…
— Non, pas de mais. Sa disparition est une chose, sa mort en est une autre. Ce sont les vivants qui disparaissent, pas les morts. Faites le nécessaire pour qu’on ne retrouve jamais sa trace ! Ce serait une bonne chose…
Comme je ne moufte pas, il insiste :
— Compris ?
— Compris, patron.
— Qu’est-ce qu’il t’a dit ? s’informe mon coéquipier.
Je lui répète l’ordre extravagant du patron.
Le Gros coule un regard navré sur la banquette arrière.
— Mais qu’est-ce qu’on va fiche de ce client ?
— Je me le demande…
Il se gratte le crâne, se cure une dent, s’arrache un poil du nez et murmure :
— Bon ; envisageons les possibilités. On peut l’enterrer dans un coin perdu…
Je secoue la tête.
— On finit toujours par retrouver les corps ; soit qu’un chien ait du flair, soit qu’on entreprenne des travaux à cet endroit, soit que quelqu’un vous ait vu…
— Et si on y mettait le feu ?
— Tu parles ! On identifie les cendres !
Il s’emporte.
— Écoute, San-A., je le boufferais bien, mais je n’ai plus faim !
La situation est plutôt moche. Nous avons bonne mine, en habit, avec un cadavre dans notre voiture.
Le jour commence à poindre vers le levant (il serait d’ailleurs surprenant qu’il pointât vers le couchant). Des coqs chantent dans les métairies.
— Il faut que nous nous changions, dis-je. On va retourner en ville. J’irai à notre hôtel mettre d’autres fringues pendant que tu garderas le collègue. Ensuite ce sera ton tour. Une fois que nous serons en civil…
— Eh bien ?
— Eh bien nous aviserons, me casse pas les pattes !
J’ai passé un Prince de Galles en drap anglais d’Elbeuf et me suis rafraîchi un peu la frime. Quel métier ! Vous parlez d’une nuit.
— À ton tour ! fais-je à Bérurier.
Le Gros s’extirpe de la bagnole.
— Ne t’attarde pas, recommandé-je.
— Tu peux toujours faire un brin de causette avec môssieur en mon absence, rigole-t-il.
Il s’éloigne. Les basques de son habit, tordues comme de vieilles cravates, lui battent les miches.
Je suis dans un parking, près de l’hôtel. Nous avons jeté une couverture sur le cadavre. J’ai, par mesure de sécurité, bloqué les portières arrière de façon à ce que personne ne puisse les ouvrir de l’extérieur. Par veine, comme il fait frisquet, les vitres sont embuées. Dans l’immédiat, j’ai l’impression que nous sommes parés.
En attendant le Gros, je lance un nouvel appel pour Paris. Cette fois, ce n’est pas la maison Poulardin and Co que je réclame, mais celle de Félicie. Brave vieille mère ! Quel est son sort ! Pendant qu’elle est aux prises avec une équipe de truands qui la séquestrent, la molestent peut-être, son fils, à des centaines de kilomètres d’elle, se met dans des situations impossibles.
J’attends longtemps avant d’obtenir le révérend Pinaud au bigophone. Il bâille un « Allô » lamentable qui servirait d’anesthésique dans un hôpital où le penthotal viendrait à manquer.
— Ici, San-A. Du nouveau ?
— Non. Ah ! si… On est passé pour le gaz, comme je n’avais pas suffisamment d’argent sur moi, je n’ai pas payé la quittance. Ils la représenteront demain après-midi… J’espère que tu seras rentré. Je te signale que j’ai bu une bouteille de muscadet malgré ta défense. Je me fais vieux, tout seul ici… J’ai aussi regardé la télé. Y avait du catch, hier soir : le Taureau de Camargue contre l’Assassin de Düsseldorf. C’est l’Allemand qu’a gagné, faut pas demander ! Combat incorrect. Moi, j’aurais été l’arbitre…
— Tu vas la boucler, excroissance humaine ! tonné-je.
Il balbutie.
— Ben alors ! Ah ! celle-là, elle est raide ! Je…
— As-tu eu un appel téléphonique ?
— Pas depuis celui d’hier, non !
— Il y a du courrier ?
— Bien sûr ! Je voulais te dire…
— Mais dis-le, graine de gâtisme !
— C’est une carte postale de notre collègue Mongin qui est en vacances aux Sables-d’Olonne. Je me suis permis de la lire vu qu’elle était pas sous enveloppe. Il dit « Un bonjour d’un gars sur le sable qu’est aux Sables ». Il a de l’esprit, Mongin. On ne dirait pas à le voir…
— Et à part ça ?
— À part ça, rien à signaler, sauf mes rhumatismes qui me travaillent les articulations.
Je coupe la communication.
Sur ces entrefaites, retour de Son Éminence le Rubicond.
Il a repris ses hardes. Là-dedans, il est vraiment lui-même.
— M’a semblé que tu causais ? fait-il, soupçonneux, en regardant derrière pour si des fois Tulacomak jouait les Lazare.
— Je communiquais avec Pinuche pour lui demander si j’avais du courrier à la maison.
— J’sais pas si que t’en avais à la maison, déclare le Mahousse, mais t’en avais à l’hôtel.
Il tire une enveloppe de sa poche.
— On a apporté ça pour toi du temps que je me changeais.
— Pas possible !
D’un coup d’ongle j’éventre l’enveloppe.
Je lis :
« Et maintenant, assez joué. Les documents, sinon c’est la catastrophe. Quelqu’un passera à midi. »
Pas de signature. On a dactylographié le message sur une feuille blanche.
— Qui a apporté ce pli ?
— Le portier de nuit l’ignore. On l’a déposé à son guichet pendant qu’il était occupé ailleurs.
Conclusion : on sait que je suis en Suisse. Qui ? la môme Nathalia ? Quel jeu joue-t-elle, à part celui de la mort et de l’amour ?
— T’as une idée pour le camarade refroidi ? demande Bérurier.
— Un bout d’idée…
Je démarre. À faible allure, — je ne tiens pas à attirer l’attention des perdreaux —, je quitte la ville par la route de Neufchâtel. La veille, juste avant d’entrer dans Berne, j’ai aperçu sur le chemin plusieurs villas portant l’écriteau « À louer ».
Je m’arrête devant la première venue. L’avis de location est rédigé en allemand et en français. Il est dit sur le panneau que, pour louer, on doit s’adresser à l’agence du coin. Fouette cocher !
Les Suisses sont matinaux. Faut dire qu’ils ne manquent pas de réveille-matin.
Bien que huit plombes ne soient pas encore sonnées, l’agence Schprountz vient d’ouvrir. C’est un petit magasin pimpant, peint paon et peint pain (deux très jolies couleurs qui font un peu automne) dans la vitrine duquel sont placardées des photos de propriétés toutes plus alléchantes les unes que les autres.
Le patron, M. Schprountz fils, un grand vieillard à la barbe neigeuse, me reçoit aimablement devant un déjeuner complet qui m’humecte les muqueuses.
Je lui vends ma salade. Je suis un ingénieur français. Je viens à Berne pour installer un appareil délicat servant à trier les lentilles et dont la mise en service nécessitera un séjour de deux mois. J’ai horreur de l’hôtel, bref, je lui loue sa maison pour un prix très élevé. Il me donne les clés, me dit de ne pas couper les rosiers, le propriétaire y tenant beaucoup, et me souhaite un bon séjour.
À l’instant où je rejoins Béru, la Suisse se met à sonner huit heures. Dans quatre plombes, tout doit être liquidé.
Nous prenons possession de la demeure. Notre premier soin est de rentrer la bagnole dans le garage attenant à icelle et de débarquer notre ambassadeur.
— Où qu’on le met ? fait Béru qui surveille toujours son langage lorsqu’il coltine par les pieds un ambassadeur décédé.
Читать дальше