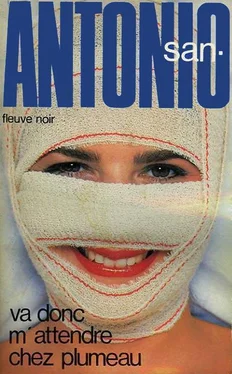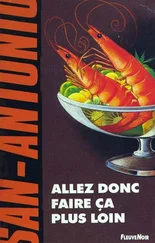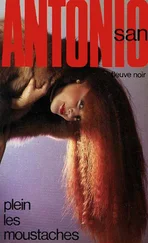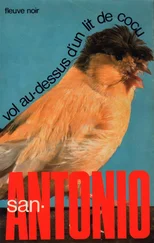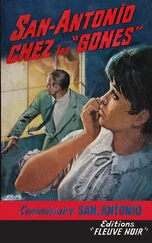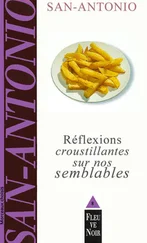San-Antonio
Va donc m'attendre chez Plumeau
A Robert DEBŒUF
Avec mon affection berjallienne
San-Antonio
Tiens, je suis d’humeur.
Je vais t’en pondre un bourré de péripéties.
Un qui cavale, cavalcade, cabriole.
Un qui pète et qui claque. Pif ! Pouf ! Paf ! Ça oui : paf, avec moi, tu peux pas y échapper.
Saignant ! Qu’est-ce qu’on risque, puisque c’est pour rire.
Le titre, j’hésite.
J’aimerais « Coolie de tomates », mais cinquante pour cent des mecs ignorent ce qu’est un coolie, et l’autre cinquante pour cent ce qu’est du coulis ; alors mon jeu de mots je me le carre dans le hangar à thermomètre.
C’est dur de faire le con avec des cons. Si tu joues trop au con, ils te prennent pour un con, et si tu déploies du vrai esprit, ils le trouvent con. C’est con.
Non, dans celui-ci, je vais acharner sur l’historiette. Bien rebondissante à souhait.
Et je te tue, et tu me tutoies, et on danse en tutu. Turlututu chapeau pointu.
Tu vois le genre ? Académique, quoi.
Bon, alors, enfile ta veste, Ernest.
Moi j’enfilerai ta dame.
Une Daimler double-six (12 cylindres) de couleur marron glacé. Fastoche à reconnaître à cause des cannelures de sa calandre.
Et qui roule, roule, roule imperturbablement derrière moi. Il arrive qu’elle me dépasse, dans les lignes droites, mais très vite elle attend que je la saute.
Ce dont je.
Et elle continue de guigner mon pot d’échappement : une merveille du genre. Même Chazot peut pas prétendre.
Bref, cette Daimler marron glacé me suit, il faut appeler les verbes par leur nom, dirait Béru.
Depuis Zurich. Et bientôt ce sera Berne, la capitale fédérale, un peu austère, mais si belle.
Je me dis textuellement et familièrement ceci : « Mon vieux Toto, avant de débarquer en ville, tu dois en avoir le cœur net ! »
Mon cerveau ayant transmis cet ordre à ma pédale de frein, j’écrase icelle vigoureusement, pile au moment où je parviens à la hauteur d’une station-service, et j’oblique foutrement sur la rampe d’accès y conduisant.
Dans mon rétro, j’ai le temps de constater que le gonzier de la Daimler, surpris, se range sur le bas-côté et entreprend la périlleuse manœuvre consistant à reculer sur une autoroute afin de gagner lui aussi la voie menant à la station.
Peu de monde aux pompes. Un zig en combinaison jaune et rouge flambant neuve me demande en allemand ce que je souhaite.
— Le plein ! j’annonce dans la langue de ce cher Goethe (que je n’ai pas relu depuis bien longtemps, j’espère qu’il ne m’en voudra pas. Et j’ajoute :) Qu’où sont les toilettes ?
Le pompistador m’indique. La chose se situe dans un local annexe, derrière la station. Nobody. Trois pissotières offrent leurs conques aux vessies de passage, deux chiottards, leurs portes béantes. Je m’engouffre par la première. Le local est éclairé à la lumière électrique. J’attends, l’oreille tendue.
Un bruit d’arrivant ne tarde pas. Et que perçois-je alors ? Celui, plus menu, mais autrement inquiétant, d’un pistolet que l’on arme. Moi, l’Antonio d’élite, je ne barguigne jamais dans ces cas-là. Hop ! le dos au mur, les pieds contre la paroi d’en face.
Evidemment, c’est pas dans la cathédrale de Chartres que tu peux réussir cette fantaisie. Prenant appui des pinceaux, je fais glisser mon dos, en élévation, contre la paroi de faïence, qu’heureusement nous sommes en Suisse, car ce serait en France ou au Zaïre, mon beau costar clair serait plein de merde.
Puis je remonte mes pieds. Et ainsi de suite, très vite, de manière à me trouver surélevé horizontalement d’un mètre cinquante de la cuvette à changement de vitesses, freins à disques, chasse incorporée, refroidissement par air pulsé, faf à train monogrammé, musique d’ambiance. Le bas de la porte s’arrête à dix centimètre du sol, ce qui me permet de voir, grâce à la lumière rasante du local, l’ombre de deux pieds parallèles, face à la porte.
J’entends distinctement : « Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! Tchouf ! » Quatre trous perforent la lourde à hauteur d’homme assis. Le mur, au-dessus de la cuvette, est défaïencé de première.
Nouveau bruit de pas qui s’éloignent sans se presser. Je compte jusqu’à trois et me remets en position verticale. Ensuite je délourde fissa et ramasse les quatre douilles gisant au sol.
Le mec de la Daimler est un grand blond, coiffé d’une casquette sport à petits carreaux. Il porte un blouson de cuir bordeaux, un pantalon blanc ; il a le pif chaussé de Ray-Ban sombres.
Il va récupérer sa guinde stoppée à l’écart. Je pique un sprint silencieux et le rejoins au moment où il actionne son démarreur. La frime qu’il pousse en me voyant vaut le sprint ! Un pur moment d’égarement, d’incrédulité.
— Un instant ! lui dis-je. J’ai une particularité : quand on me tue, je rends toujours les douilles. Pour les balles, il faut attendre que ma digestion soit faite !
Et je jette les quatre douilles dans sa tire.
L’Effaré décarre en trombe. Il n’a pas vu le bitougnot aimanté que j’ai plaqué contre la portière de sa voiture.
Je radine jusqu’au pompiste. Il achève mon plein. Je le cigle calmement. Un vieux kroum barbichu ressort des gogues en glapissant comme quoi c’est scandaleux de percer des trous dans les portes des toilettes ! Les voyeurs ne se contrôlent plus, décidément.
Je démarre pleins gaz. Une Daimler roule vite, mais une Maserati, c’est pas dégueulasse non plus. En quelques kilbus j’ai recollé à mon agresseur. Alors je prends un petit boîtier dans le vide-poches, pas plus grand qu’un paquet de Gitanes. J’oriente l’objet convenablement, en le tenant hors de ma voiture par la vitre baissée. J’ai choisi une belle ligne droite avec personne venant dans l’autre sens, ni personne à proximité de la Daimler, mais par contre, du monde derrière moi, qui pourra témoigner.
Allez, zou ! Je presse le contacteur.
Là-bas, à deux cents mètres, il se fait une gerbe intéressante. Ma bombette, c’est pas du berlingot de laitier. La moitié du véhicule est arrachée. La Daimler titube, fonce sur la glissière de sécurité qui la renvoie à droite. Elle escalade un talus abrupt terminé par un fort grillage, ce dernier fait trampoline et la retourne à l’envoyeur. La bagnole en folie n’en finit pas de tourniquer comme un reptile tranché.
Je m’arrête à bonne distance et cours, armé de mon extincteur, à toutes fins utiles. C’est utile puisque des flammes jaillissent déjà du moteur. Je pulvérise ma drogue à tout-va : les flammes s’éteignent. D’autres tomobilistes viennent à la rescousse avec, eux aussi, des extincteurs.
Les portières sont bloquées. Mon tueur blond est plutôt mal en point, la moitié du corps prise dans des ferrailles disloquées. Il me regarde salement, ce teigneux, avec un pied dans le tableau de bord et l’autre dans la tombe.
— Tu vois, lui dis-je, avec tes mauvaises manières, tu te fais des ennemis, c’est fatal.
Il perd connaissance. Moi, en douce, je lui secoue son portefeuille, plus un petit sac de plastique fermé par un cordonnet ; tout cela sous prétexte de lui porter aide et assistance ; les témoins m’hurlent de m’écarter, que peut-être le réservoir d’essence va exploser.
Bon, bon, je m’écarte, gueulez pas si fort !
Mais le réservoir n’explose pas.
Lorsque les policiers bernois s’annoncent, nous leur expliquons ce qui s’est passé. Ils trouvent sur le mort un pistolet muni d’un silencieux, plus un petit revolver à mufle de bulldog.
Читать дальше