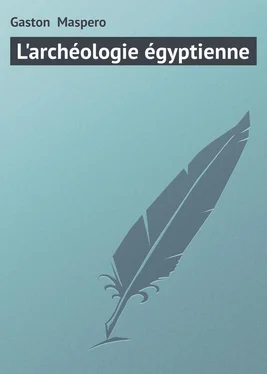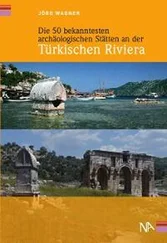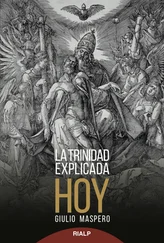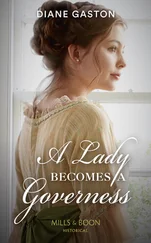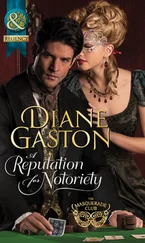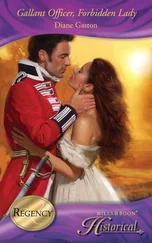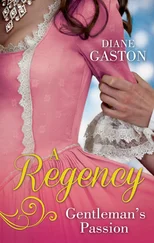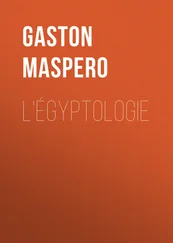Gaston Maspero - L'archéologie égyptienne
Здесь есть возможность читать онлайн «Gaston Maspero - L'archéologie égyptienne» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Издательство: Array Иностранный паблик, Жанр: foreign_antique, foreign_prose, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:L'archéologie égyptienne
- Автор:
- Издательство:Array Иностранный паблик
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
L'archéologie égyptienne: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «L'archéologie égyptienne»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
L'archéologie égyptienne — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «L'archéologie égyptienne», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
On retaillait en biseau une des faces latérales, et le joint, au lieu d’être vertical, s’inclinait sur le lit. Si la pierre n’avait plus la hauteur ou la largeur voulue, on rachetait la différence au moyen soigneusement qu’on enveloppât les blocs, ils couraient le risque de perdre en chemin leurs arêtes et leurs angles, ou même de se briser en éclats. Il fallait presque toujours les retoucher, et le désir d’avoir le moins de déchet possible portait l’ouvrier à leur prêter des coupes anormales. On retaillait en biseau une des faces latérales, et le joint, au lieu d’être vertical, s’inclinait sur le lit. Si la pierre n’avait plus la hauteur ou la largeur voulue, on rachetait la différence au moyen d’une dalle complémentaire. Parfois même, on laissait subsister une saillie, qui s’emboîtait, pour ainsi dire, dans un creux correspondant, ménagé à l’assise supérieure ou inférieure. Ce qui n’était d’abord qu’accident devenait bientôt négligence. Les maçons, qui avaient hissé par inadvertance un bloc trop gros, ne se souciaient pas de le redescendre, et se tiraient d’affaire avec l’un des expédients dont je viens de parler. L’architecte ne surveillait pas assez attentivement la taille et la pose des pierres. Il souffrait que les assises n’eussent pas toutes la même hauteur, et que les joints verticaux de deux ou trois d’entre elles fussent dans un même prolongement. Le gros œuvre achevé, on ravalait la pierre, on reprenait les joints, on les noyait sous une couche de ciment ou de stuc, coloré à la teinte de l’ensemble, et qui dissimulait les fautes du premier travail. Les murs ne se terminent presque jamais en arête vive. Ils sont comme cernés d’un tore autour duquel court un ruban sculpté, et couronnés soit de la gorge évasée que surmonte une bande plate, soit, comme à Semnéh, d’une corniche carrée, soit, comme à Médinét-Habou, d’une ligne de créneaux.
Ainsi encadrés, on dirait autant de panneaux unis, levés chacun sur un seul bloc, sans saillies et presque sans ouvertures. Les fenêtres, toujours très rares, ne sont que de simples soupiraux, destinés à éclairer des escaliers comme au second pylône d’Harmhabi, à Karnak, ou à recevoir des pièces de charpente décorative les jours de fête. Les portes ne présentent que peu de relief sur le corps de l’édifice, sauf le cas où le linteau est surhaussé de la gorge et de la plate-bande.
Seul, le pavillon de Médinét-Habou possède des fenêtres réelles ; mais il était construit sur le plan d’une forteresse et ne doit être rangé qu’à titre d’exception parmi les monuments religieux.
Le sol des cours et des salles était revêtu de dalles rectangulaires assez régulièrement ajustées, sauf dans l’intervalle des colonnes où, désespérant de raccorder à l’ensemble les lignes courbes de la base, les architectes ont accumulé des fragments de petite dimension sans ordre ni méthode.
Au contraire de ce qu’ils pratiquaient pour les maisons, ils n’ont presque jamais employé la voûte dans les temples. On ne la rencontre guère qu’à Déir-el-Baharî et dans les sept sanctuaires parallèles d’Abydos, encore est-elle obtenue par encorbellement. La courbe en est dessinée dans trois ou quatre assises horizontales, placées en porte à faux l’une au-dessus de l’autre, puis évidées au ciseau, suivant une ligne continue.
La couverture ordinaire consiste en dalles plates juxtaposées. Quand les vides entre les murs ne sont pas trop considérables, elle les franchit d’une seule volée ; sinon, on l’étayait de supports d’autant plus multipliés que l’espace à couvrir est plus étendu. Ils étaient alors reliés par d’immenses poutres en pierre, les architraves, sur lesquelles s’appuient les dalles dont le toit se compose.
Les supports sont de deux types différents : le pilier et la colonne. On en connaît d’un seul bloc. Les piliers du temple du Sphinx, les plus anciens qui aient été découverts jusqu’à présent, ont 5 mètres de hauteur sur 1m,40 de côté. Des colonnes en granit rose, éparses au milieu des ruines d’Alexandrie, de Bubaste, de Memphis, et qui remontent aux règnes d’Harmhabi et de Ramsès II, mesurent 6 et 8 mètres d’une même venue. Ce n’est là qu’une exception. Colonnes et piliers sont bâtis en assises souvent inégales et irrégulières, comme celles des murailles environnantes. Les grandes colonnes de Louxor ne sont pleines qu’au tiers du diamètre : elles ont un noyau de ciment jaunâtre, qui n’a plus de consistance et tombe en poudre sous les doigts. Le chapiteau de la colonne de Taharqou, à Karnak, contient trois assises hautes chacune d’environ 0m,123. La dernière, la plus saillante, se compose de vingt-six pierres, dont les joints verticaux tendent au centre, et qui ne sont maintenues en place que par le poids du dé superposé. Les mêmes négligences que nous avons signalées dans l’appareil des murs, on les retrouve toutes dans celui des colonnes. Le pilier quadrangulaire, à côtés parallèles ou légèrement inclinés, le plus souvent sans base ni chapiteau, est fréquent dans les tombes de l’ancien Empire. Il apparaît encore à Médinét-Habou, dans le temple de Thoutmos III, ou à Karnak, dans ce qu’on appelle le promenoir. Les faces en sont souvent habillées de tableaux peints ou de légendes, et la face extérieure reçoit un motif spécial de décoration : des tiges de lotus ou de papyrus en saillie, sur les piliers-stèles de Karnak, une tête d’Hathor coiffée du sistre, au petit spéos d’Ibsamboul, une figure debout, Osiris dans la première cour de Médinét-Habou, Bîsou à Dendérah et au Gebel-Barkal.
À Karnak, dans l’édifice construit probablement par Harmhabi avec les débris d’un sanctuaire d’Amenhotpou II, le pilier est surmonté d’une gorge qu’un mince abaque séparé de l’architrave.
Abattant les quatre angles, on le transforme en un prisme octogonal ; puis, abattant les huit angles nouveaux, en un prisme à seize pans. C’est le type de certains piliers des tombeaux d’Assouân et de Beni-Hassan ; du promenoir de Thoutmos III, à Karnak, et des chapelles de Déir-el-Baharî.
À côté de ces formes régulièrement déduites on en remarque dont la dérivation est irrégulière, à six pans, à douze, à quinze, à vingt, ou qui aboutissent presque au cercle parfait. Les piliers du portique d’Osiris à Abydos sont au terme de la série ; le corps en offre une section curviligne à peine interrompue par une bande lisse aux deux extrémités d’un même diamètre. Le plus souvent les pans se creusent légèrement en cannelures ; parfois, comme à Kalabshéh, les cannelures sont divisées en quatre groupes de cinq par autant de bandes.
Le pilier polygonal a toujours un socle large et bas, arrondi en disque. À El-Kab, il porte une tête d’Hathor appliquée à la face antérieure.
Presque partout ailleurs, il est surmonté d’un simple tailloir carré qui le réunit à l’architrave. Ainsi constitué, il présente un air de famille avec la colonne dorique, et l’on comprend que Jomard et Champollion ont pu lui donner, dans l’enthousiasme de la découverte, le nom peu justifié de dorique primitif.
La colonne ne repose pas immédiatement sur le sol. Elle est toujours pourvue d’un socle analogue à celui du pilier polygonal, au profil tantôt droit, tantôt légèrement arrondi, nu ou sans autre ornement qu’une ligne d’hiéroglyphes. Les formes principales se ramènent à trois types : 1° la colonne à chapiteau en campane ; 2° la colonne à chapiteau en bouton de lotus ; 3° la colonne hathorique.
1° Colonne à chapiteau campaniforme. – D’ordinaire, le fût est lisse ou simplement gravé d’écriture et de bas-reliefs. Quelquefois pourtant, ainsi à Médamout, il est composé de six grandes et de six petites colonnettes alternées. Aux temps pharaoniques, il s’arrondit, par le bas, en bulbe décoré de triangles curvilignes enchevêtrés, simulant de larges feuilles ; la courbe est alors calculée de telle sorte que le diamètre inférieur soit sensiblement égal au diamètre supérieur. À l’époque ptolémaïque, le bulbe disparaît souvent, probablement sous l’influence des idées grecques : les colonnes qui bordent la première cour du temple d’Edfou s’enlèvent d’aplomb sur leur socle. Le fût subit toujours une diminution de la base au sommet. Il se termine par trois ou cinq plates-bandes superposées. À Médamout, où il est fasciculé, l’architecte a pensé sans doute qu’une seule attache au sommet paraîtrait insuffisante à maintenir les douze colonnettes, et il a indiqué deux autres anneaux de plates-bandes à intervalles réguliers. Le chapiteau, évasé en forme de cloche, est garni à la naissance d’une rangée de feuilles, semblables à celles de la base, et sur lesquelles s’implantent des tiges de lotus et de papyrus en fleurs et en boutons. La hauteur et la saillie sur le nu de la colonne varient au gré de l’architecte.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «L'archéologie égyptienne»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «L'archéologie égyptienne» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «L'archéologie égyptienne» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.