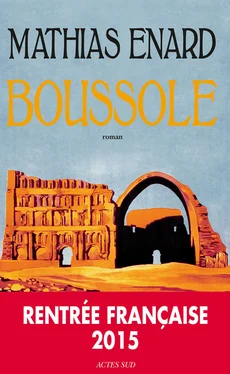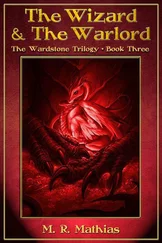Fort heureusement, le réel vous remet les idées en place ; un formalisme stérile me paraissait régner chez toutes les confessions en Syrie et mon élan spirituel se brisa bien vite contre les simagrées de mes condisciples qui allaient se rouler par terre la bave aux lèvres dans des séances de zikr deux fois par semaine comme on va au gymnase, un gymnase où les transes me semblaient venir un peu trop vite pour être honnêtes : répéter à l’infini “ la ilâha illâ Allah , il n’y a de dieu qu’Allah” en secouant la tête dans un couvent de derviches était sans doute de nature à vous mettre dans des états bizarres, mais cela relevait plus de l’illusion psychologique que du miracle de la foi, du moins telle que la décrivait, dans sa belle sobriété, le compatriote Leopold Weiss. Partager mes interrogations avec Sigrid n’était pas chose facile : mes pensées étaient si confuses qu’elle n’y comprenait rien, ce qui n’était pas étonnant ; son monde à elle, les langues slaves, était bien loin du mien. Nous nous retrouvions autour de la musique russe ou polonaise, autour de Rimski, de Borodine, de Szymanowski, certes, mais moi c’était Schéhérazade ou Le Chant du muezzin amoureux , l’Orient en eux, et pas les rives de la Volga ou de la Vistule qui me passionnaient — la découverte du Muezzin amoureux de Karol Szymanowski, de ses “Allah akbar” au beau milieu des vers en polonais, de cet amour insensé (“Si je ne t’aimais pas, serais-je le fou qui chante ? Et mes chaudes prières qui s’envolent vers Allah, n’est-ce pas pour te dire que je t’aime ?”) diffusé par les mélismes et la colorature me paraissait une belle variation européenne sur un thème oriental : Szymanowski avait été très impressionné par son voyage en Algérie et en Tunisie en 1914, par les fêtes des nuits de ramadan, passionné même, et c’était cette passion qui affleurait dans ce Chant du muezzin amoureux , chant par ailleurs assez peu arabe : Szymanowski se contentait d’y reprendre les secondes augmentées et les mineures typiques des imitations de la musique arabe, sans se soucier des quarts de ton introduits par Félicien David — mais ce n’était pas son propos ; Szymanowski n’avait pas besoin, dans cette évocation, de se défaire de l’harmonie, d’y briser la tonalité. Mais ces quarts de ton, il les avait entendus ; il les utilisera dans Mythes , et je suis persuadé qu’à l’origine de ces pièces qui transformèrent radicalement le répertoire pour violon du XX esiècle se trouve la musique arabe. Une musique arabe digérée, cette fois-ci, non plus un élément exogène mis en œuvre pour obtenir un effet exotique, mais bel et bien une possibilité de renouvellement : une force d’évolution, pas une révolution, comme il l’affirmait si justement lui-même. Je ne me souviens plus si à Tübingen je connaissais déjà les poèmes de Hafez et Le Chant de la nuit sur des vers de Roumi, le chef-d’œuvre de Szymanowski — je ne crois pas.
Il m’était difficile de partager mes nouvelles passions avec Sigrid ; Karol Szymanowski réalisait pour elle une partie de l’âme polonaise, rien d’oriental ; elle préférait les Mazurkas au Muezzin , les danses des Tatras à celles de l’Atlas. Sa vision était elle aussi tout à fait justifiée.
Peut-être libérés des correspondances de l’âme, nos corps s’en donnaient à cœur joie : je ne sortais de mon fauteuil dogmatique que pour bondir sur le lit et rejoindre le torse, les jambes et les lèvres qui s’y trouvaient. Les images de la nudité de Sigrid m’excitent encore aujourd’hui, elles n’ont rien perdu de leur puissance, sa maigre blancheur, allongée sur le ventre, les jambes légèrement disjointes, quand seul un trait rose, entouré de carmin et de blondeur, naissait des draps clairs, je revois parfaitement ses fessiers durs, deux courts plateaux, rejoindre les hanches, et la crémaillère des vertèbres culminer au-dessus du repli où se rejoignent les pages du livre entrouvert des cuisses dont la peau, jamais exposée aux rayons du jour, est un sorbet parfait qui glisse sous la langue, quand ma main s’attarde à descendre la pente duveteuse du mollet avant de jouer dans les sillons parallèles de l’intérieur du genou, ça me donne envie d’éteindre à nouveau la lumière, de préciser ces visions sous ma couette, de retrouver en imagination les nuages de Tübingen, si propices à l’exploration de la féminité, il y a plus de vingt ans : aujourd’hui la perspective de devoir m’habituer à la présence d’un corps, qu’on s’habitue au mien, m’épuise d’avance — une immense paresse, une flemme proche du désespoir ; il faudrait séduire, oublier la honte de mon physique tout disgracieux, tout maigre, marqué par l’angoisse et la maladie, oublier l’humiliation de la mise à nu, oublier la honte et l’âge qui vous rend lent et gourd et cela me semble impossible, cet oubli, sauf avec Sarah, bien sûr, dont le nom s’invite toujours au creux de mes pensées les plus secrètes, son nom, son visage, sa bouche, sa poitrine, ses mains et avec cette charge d’érotisme allez vous rendormir maintenant, dans ces tourbillons féminins au-dessus de moi, des anges, des anges de luxure et de beauté — il y a quoi, deux semaines de ce dîner avec Katharina Fuchs, je ne l’ai évidemment pas rappelée, ni croisée à l’université, elle va penser que je l’évite, et c’est juste, je l’évite, malgré le charme indéniable de sa conversation, son charme indéniable, je ne vais pas la rappeler, soyons sincères, plus le dîner approchait de sa fin plus j’étais effrayé de la tournure que pouvaient prendre les événements, Dieu sait pourtant que je m’étais efforcé d’être beau, que j’avais noué sur ma chemise blanche ce petit foulard de soie lie-de-vin qui me donne un air artiste tout à fait chic, je m’étais peigné, aspergé d’eau de Cologne, j’espérais donc quelque chose de ce dîner en tête à tête, bien sûr, j’espérais coucher avec Katharina Fuchs, mais je ne pouvais m’empêcher de regarder fondre la bougie dans son candélabre en étain comme l’annonce d’une catastrophe, Katharina Fuchs est une excellente collègue, une collègue précieuse, c’est sûr qu’il valait mieux dîner avec elle que lutiner des étudiantes comme certains. Katharina Fuchs est une femme de mon âge et de ma condition, une Viennoise drôle et cultivée qui mange proprement et ne fait pas de scandales en public. Katharina Fuchs est spécialiste de la relation entre musique et cinéma, elle peut parler pendant des heures de La Symphonie des brigands et des films de Robert Wiene ; Katharina Fuchs a un visage agréable, des pommettes rouges, des yeux clairs, des lunettes très discrètes, des cheveux châtains et de longues mains aux ongles soignés ; Katharina Fuchs porte deux bagues ornées de diamants — qu’est-ce qui m’a pris de manigancer ce dîner avec elle, et même de rêver dormir avec elle, la solitude et la mélancolie, sans doute, quelle détresse. Dans ce restaurant italien élégant Katharina Fuchs m’a posé des questions sur la Syrie, sur l’Iran, elle s’est intéressée à mes travaux, la bougie se consumait en jetant une ombre orange sur la nappe blanche, de petites couilles de cire pendaient du rebord du chandelier gris : je n’ai jamais vu La Symphonie des brigands — tu devrais, disait-elle, je suis sûre que ce film te passionnerait, j’imaginais me déshabiller devant Katharina Fuchs, oh je suis sûr que c’est un chef-d’œuvre, et qu’elle se mette nue devant moi dans ces sous-vêtements de dentelle rouge dont j’apercevais une bretelle de soutien-gorge, je peux te le prêter si tu veux, je l’ai en DVD, elle avait des seins intéressants et d’une taille respectable, ici le tiramisu est excellent, et moi-même, quel caleçon portais-je ? Le rose à carreaux qui tombe à cause de son élastique foutu ? Pauvres de nous, pauvres de nous, quelle misère que le corps, il est hors de question que je me déshabille devant qui que ce soit aujourd’hui, pas avec cette loque lamentable sur les hanches, ah oui, un tiramisu, c’est un peu — comment dirais-je — mou, oui, c’est le mot, le tiramisu est souvent trop mou pour moi, non merci.
Читать дальше