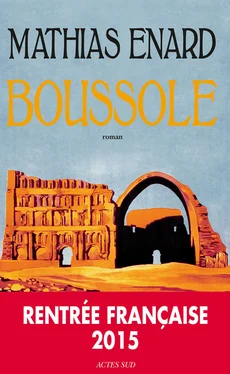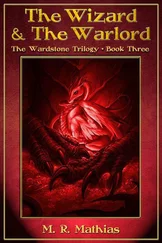Notre première nuit dans le même lit (elle dirait plus tard qu’on ne pouvait raisonnablement parler d’un même lit ) me laissait un souvenir impérissable, des os endoloris et un catarrhe peu glorieux : je terminai notre expédition la goutte au nez, rougissant de ces sécrétions pourtant anodines, comme si mon tarin révélait au monde extérieur, d’une façon symbolique, ce que mon inconscient avait secrètement ourdi la nuit entière.
Les touristes avaient fini par nous déloger, ou du moins par nous contraindre à nous lever et à rompre nos faisceaux, la bataille étant perdue d’avance — patiemment, en brûlant des brindilles, nous avons réussi à faire bouillir de l’eau pour préparer un café turc ; je me revois assis sur le rocher, à contempler la palmeraie, loin au-delà des temples, une tasse à la main. Je comprenais le vers jusque-là énigmatique de Badr Shakir Sayyab, “Tes yeux sont une forêt de palmiers à l’aurore / ou un balcon, avec la lune loin au-dehors” qui ouvre Le Chant de la pluie ; Sarah était heureuse que j’évoque le pauvre poète de Bassora, perdu dans la mélancolie et la maladie. Cette nuit, ce matin, cette couverture avait créé entre nous une intimité, nos corps s’étaient apprivoisés, et ils ne souhaitaient plus se quitter — ils continuaient à se serrer, à se blottir l’un contre l’autre dans une familiarité que le froid ne justifiait plus.
Est-ce à ce moment-là que l’idée m’est venue de mettre ce poème en musique, sans doute ; est-ce la douceur glaciale de cette nuit au désert, les yeux de Sarah, le matin de Palmyre, les mythes flottant sur les ruines qui ont fait naître ce projet, c’est du moins ainsi que j’aime l’imaginer — peut-être y avait-il aussi un jeu du destin, c’est à mon tour d’être seul, malade et mélancolique dans Vienne endormie, comme Sayyab l’Irakien, Sayyab dont le sort me touchait tant à Damas. Il ne faut pas que je pense à l’avenir terrifiant que les livres de médecine me prédisent comme des pythies, à qui pourrais-je confier ces craintes, à qui pourrais-je révéler que j’ai peur de dégénérer, de pourrir comme Sayyab, peur que mes muscles et ma cervelle petit à petit se liquéfient, peur de tout perdre, de me défaire de tout, de mon corps et de mon esprit, par morceaux, par bribes, par squames, jusqu’à ne plus être capable de me souvenir, de parler ou de me mouvoir, est-ce que ce trajet a déjà commencé, c’est cela le plus terrible, est-ce que déjà en ce moment je suis moins que ce que j’étais hier, incapable de m’apercevoir de ma déchéance — bien sûr je m’en rends compte dans mes muscles, dans mes mains crispées, dans les crampes, les douleurs, les crises de fatigue extrême qui peuvent me clouer au lit, ou au contraire l’insomnie, l’hyperactivité, l’impossibilité de s’arrêter de penser ou de parler seul. Je ne veux pas me plonger dans ces noms de maladie, les toubibs ou les astronomes aiment à donner leurs propres noms à leurs découvertes, les botanistes, ceux de leurs femmes — on peut à la limite comprendre la passion de certains pour parrainer des astéroïdes, mais pourquoi ces grands docteurs ont-ils laissé leurs patronymes à des affections terrifiantes et surtout incurables, leur nom est synonyme aujourd’hui d’échec, d’échec et d’impuissance, les Charcot, Creutzfeldt, Pick, Huntington, autant de toubibs qui sont (dans un étrange mouvement métonymique, le guérisseur pour l’inguérissable) devenus la maladie elle-même et si le nom de la mienne est bientôt confirmé (le médecin est un obsédé du diagnostic ; des symptômes épars doivent être regroupés et prendre sens dans un ensemble : le bon Dr Kraus sera soulagé de me savoir mortellement atteint, enfin un syndrome connu, nommé comme par Adam lui-même) ce sera après des mois d’examens, d’errance de service en service, d’hôpital en hôpital — il y a deux ans, Kraus m’a envoyé consulter un Esculape spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, persuadé que j’avais rapporté un parasite d’un de mes voyages, et j’eus beau lui expliquer que l’Iran ne regorge pas de vibrions agressifs ni d’infusoires exotiques (et surtout que je n’avais pas quitté l’Europe depuis des années), en bon Viennois, pour qui le vaste monde commence de l’autre côté du Danube, Kraus prit son air entendu et rusé, typique des savants lorsqu’ils souhaitent dissimuler leur ignorance, pour me gratifier d’un “on ne sait jamais”, phrase à laquelle son orgueil de Diafoirus souhaitait faire dire “moi, je sais, j’ai ma pensée de derrière”. Je me suis donc retrouvé face à un professionnel des infections allogènes, avec mes pauvres symptômes (migraines ophtalmiques, insomnies, crampes, douleurs très handicapantes dans le bras gauche), d’autant plus ennuyé de patienter dans un couloir d’hôpital que (bien évidemment) Sarah était à Vienne à ce moment-là, que nous avions d’urgentes et horribles visites touristiques sur le feu. Il avait fallu que je lui explique mon rendez-vous au centre hospitalier, mais sans avouer pourquoi : j’avais trop peur qu’elle ne m’imagine contagieux, ne s’inquiète de sa propre santé et ne me mette en quarantaine — il serait peut-être temps que je lui raconte mes difficultés, je n’ai pas encore osé, mais si demain la maladie me transforme en animal priapique et baveux ou en chrysalide desséchée dans sa chaise percée alors je ne pourrai plus rien lui dire, il sera trop tard. (Quoi qu’il en soit, perdue comme elle l’est apparemment au Sarawak, comment lui expliquer, quelle lettre écrire, et surtout pourquoi lui écrire à elle, que représente-t-elle pour moi, ou plutôt, encore plus mystérieux, que représenté-je pour elle ?) Je n’ai pas le courage non plus de parler à Maman, comment annoncer à une mère qu’elle va se retrouver, à près de soixante-quinze ans, à torcher son fils, à le nourrir à la cuiller jusqu’à ce qu’il s’éteigne, assez rabougri pour pouvoir retourner dans sa matrice, c’est une atrocité que je ne peux pas commettre, Dieu nous préserve, je préfère encore crever seul avec Kraus. Ce n’est pas le mauvais bougre, Kraus, je le déteste mais c’est mon seul allié, contrairement aux médecins de l’hôpital, qui sont des singes, malins et imprévisibles. Ce spécialiste des maladies tropicales portait une blouse blanche ouverte sur un pantalon de toile bleue ; il était un peu gras, avec une grosse figure ronde et un accent de Berlin. Comme c’est comique, j’ai pensé, il faut bien évidemment qu’un spécialiste des infections exotiques soit allemand, nous notre empire a toujours été européen, pas d’îles Samoa et de Togoland où étudier les fièvres pestilentielles. Sarah m’a posé la question, alors ce rendez-vous, tout va bien ? Je lui ai répondu tout va bien, le praticien ressemblait à Gottfried Benn, ce qui l’a immédiatement fait éclater de rire, comment ça, à Gottfried Benn, mais Benn ressemblait à M. Tout-le-Monde — exactement, Gottfried Benn ne ressemble à rien de particulier, donc ce docteur est son portrait craché. Pendant toute la consultation je m’étais imaginé dans un lazaret sur le front belge en 1914 ou dans une horrible clinique pour maladies vénériennes de la république de Weimar, Gottfried Benn observait ma peau à la recherche de traces de parasitose ou de “Dieu sait quoi d’autre”, persuadé que l’humanité était toujours infectée par le Mal. Je n’ai d’ailleurs jamais donné suite aux absurdes demandes d’examens du Dr Benn, déféquer dans une boîte en plastique étant absolument au-dessus de mes forces, ce que je n’ai bien évidemment pas avoué à Sarah — il faut dire, à ma décharge, qu’être ausculté par l’auteur de Morgue ou de Chair ne vous met pas en confiance. Pour noyer le poisson devant Sarah, je me suis alors lancé dans une comparaison embarrassée entre Benn et Georg Trakl, qu’il faut à la fois rapprocher et opposer ; Trakl le subtil homme secret dont la poésie obscurcissait le réel pour l’enchanter, Trakl le sensible Salzbourgeois dont le lyrisme dissimule, cache le moi dans une complexe forêt symbolique, Trakl le maudit, drogué, amoureux fou de sa sœur et du suc du pavot, dont l’œuvre est parcourue de lune et de sang, sang du sacrifice, sang menstruel, sang de la défloration, rivière souterraine coulant jusqu’aux charniers de la bataille de Grodek en 1914 et aux mourants des premiers combats de Galicie — Trakl, peut-être, sauvé par son décès si prématuré des horribles choix politiques de Benn, c’est Sarah qui m’opposa cette atroce sentence, mourir jeune préserve parfois des terrifiantes erreurs de l’âge mûr ; imagine que Gottfried Benn soit mort en 1931, disait-elle, est-ce que tu le jugerais de la même façon s’il n’avait pas écrit L’État nouveau et les intellectuels , et tenu des propos aussi horribles contre les écrivains antifascistes ?
Читать дальше