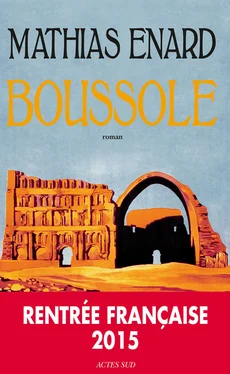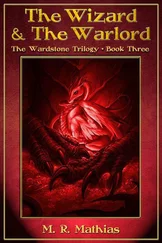Joseph von Hammer-Purgstall l’orientaliste, toujours lui, raconte qu’il fréquentait Beethoven à Vienne par l’intermédiaire du Dr Glossé. Quel monde tout de même que ces capitales au début du XIX esiècle, où les orientalistes fréquentaient les princes, les Balzac et les musiciens de génie. Ses Mémoires contiennent même une anecdote terrifiante, pour l’année 1815 : Hammer assiste à un concert de Beethoven, dans un de ces extraordinaires salons viennois ; on imagine facilement les cabriolets, les laquais, les centaines de bougies, les lustres aux perles de verre ; il fait froid, c’est l’hiver, l’hiver du congrès de Vienne et on a chauffé le plus possible chez la comtesse Thérèse Apponyi, qui reçoit — elle a à peine trente ans, elle ne sait pas que quelques années plus tard elle charmera le Tout-Paris ; Antoine et Thérèse Apponyi seront les hôtes, dans leur ambassade du faubourg Saint-Germain, de tout ce que la capitale française compte d’écrivains, d’artistes et de musiciens importants. Le noble couple autrichien sera l’ami de Chopin, de Liszt, de la scandaleuse George Sand ; ils recevront Balzac, Hugo, Lamartine et tous les trublions de 1830. Mais ce soir d’hiver, c’est Beethoven qu’elle reçoit ; Beethoven qui n’est pas sorti dans le monde depuis des mois — comme les grands fauves c’est sans doute la faim qui le tire de sa triste tanière, il a besoin d’argent, d’amour et d’argent. Il donne donc un concert pour cette comtesse Apponyi et le cercle immense de ses amis, dont Hammer. L’orientaliste diplomate est bien en cour, au moment de ce congrès de Vienne, où il s’est rapproché de Metternich ; il a fréquenté Talleyrand, dont on ne sait s’il s’agit d’un furet pervers ou d’un faucon altier — une bête de proie, dans tous les cas. L’Europe fête la paix, l’équilibre retrouvé dans le jeu des puissances, et surtout la fin de Napoléon, qui trépigne à l’île d’Elbe ; les Cent-Jours passeront tel un frisson de peur dans le dos d’un Anglais. Napoléon Bonaparte est l’inventeur de l’orientalisme, c’est lui qui entraîne derrière son armée la science en Égypte, et fait entrer l’Europe pour la première fois en Orient au-delà des Balkans. Le savoir s’engouffre derrière les militaires et les marchands, en Égypte, en Inde, en Chine ; les textes traduits de l’arabe et du persan commencent à envahir l’Europe, Goethe le grand chêne a lancé la course ; bien avant Les Orientales d’Hugo, au moment même où Chateaubriand invente la littérature de voyage avec l’ Itinéraire de Paris à Jérusalem , alors que Beethoven joue ce soir-là pour la petite comtesse italienne mariée à un Hongrois devant les plus beaux habits de Vienne, l’immense Goethe met la dernière main à son West-östlicher Divan , directement inspiré de la traduction de Hafez qu’a publiée Hammer-Purgstall (Hammer est là bien sûr, on lui prend son manteau, il se penche pour faire semblant d’effleurer des lèvres le gant de Teresa Apponyi, en souriant, car il la connaît très bien, son mari est aussi un diplomate du cercle de Metternich) en 1812, alors que ce dragon de Napoléon, cet horrible Méditerranéen pensait pouvoir affronter les Russes et leur terrifiant hiver, à trois mille lieues de la France. Ce soir-là, pendant que Napoléon tape du pied en attendant les bateaux à Elbe, il y a Beethoven, et il y a le vieux Hafez, et Goethe, et donc Schubert, qui mettra en musique des poèmes du Divan occidental-oriental , et Mendelssohn, et Schumann, et Strauss et Schönberg, eux aussi reprendront ces poèmes de Goethe l’immense, et à côté de la comtesse Apponyi se trouve Chopin le fougueux, qui lui dédicacera deux Nocturnes ; près de Hammer s’assoient Rückert et Mowlana Jalal od-Din Roumi, et Ludwig van Beethoven, leur maître à tous, s’installe au piano.
On imagine Talleyrand, soudainement réchauffé par les poêles en faïence, s’endormir avant même que les doigts du compositeur ne touchent le clavier ; Talleyrand le diable boiteux a joué toute la nuit, mais pas de la musique, aux cartes : une petite banque de pharaon avec du vin, beaucoup de vin, et il a les yeux qui se ferment. C’est le plus élégant des évêques défroqués, et aussi le plus original ; il a servi Dieu, servi Louis XVI, servi la Convention, servi le Directoire, servi Napoléon, servi Louis XVIII, il servira Louis-Philippe et deviendra l’homme d’État dont les Français feront leur modèle, eux qui croient sincèrement que les fonctionnaires doivent être comme Talleyrand, des bâtiments, des églises inamovibles qui résistent à toutes les tempêtes et incarnent la fameuse continuité de l’État , c’est-à-dire la veulerie de ceux qui subordonnent leurs convictions à la puissance, quelle qu’elle soit — Talleyrand rendra hommage à l’expédition d’Égypte de Bonaparte et à tout ce que Denon et ses savants ont rapporté de connaissances sur l’Égypte antique en ordonnant que son corps soit embaumé à l’égyptienne , momifié, sacrifiant à la mode pharaonique qui a envahi Paris, mettant un peu d’Orient dans son cercueil, lui le prince qui avait toujours rêvé transformer son boudoir en harem.
Joseph Hammer ne s’endort pas, il est mélomane ; il apprécie le beau monde, la belle compagnie, les belles assemblées — il a un peu plus de quarante ans, des années d’expérience du Levant, il parle six langues parfaitement, a fréquenté les Turcs, les Anglais et les Français et apprécie, quoique différemment, ces trois nations dont il a pu admirer les qualités. C’est un Autrichien, fils d’un fonctionnaire de province, et il ne lui manque qu’un titre et un château pour réaliser ce Destin dont il sent qu’il est le sien — il lui faudra attendre vingt ans de plus et un coup du sort pour hériter de Hainfeld, de la baronnie qui l’accompagne et devenir von Hammer-Purgstall.
Beethoven a salué l’assistance. Ces années sont bien pénibles pour lui, il vient de perdre son frère Carl et se lance dans un long procès pour qu’on lui confie la garde de son neveu ; l’avancée de sa surdité l’isole de plus en plus. Il est obligé d’utiliser ces énormes cornets acoustiques en cuivre, aux formes étranges, que l’on voit à Bonn, dans une vitrine de la Beethovenhaus, et qui lui donnent l’air d’un centaure. Il est amoureux, mais d’un amour dont il pressent, soit à cause de sa maladie ou de la haute naissance de la jeune femme, qu’il ne donnera rien d’autre que de la musique ; comme Harriet pour Berlioz, cet amour est là, dans la salle ; Beethoven commence à jouer, sa vingt-septième sonate, composée quelques mois plus tôt, avec vivacité, sentiment et expression.
Le public tremble un peu ; il y a un murmure que Beethoven n’entend pas : Hammer raconte que le piano, peut-être en raison du chauffage, n’a pas tenu l’accord et sonne horriblement — les doigts de Beethoven jouent parfaitement, et il entend, intérieurement, sa musique telle qu’elle devrait être ; pour le public, c’est une catastrophe sonore et si Beethoven observe de temps en temps sa bien-aimée, il doit s’apercevoir, petit à petit, que les visages sont envahis par la gêne, la honte, même, d’assister ainsi à l’humiliation du grand homme. Heureusement la comtesse Apponyi est une dame de tact, elle applaudit à tout rompre, elle fait discrètement signe d’abréger la séance, et l’on imagine la tristesse de Beethoven, lorsqu’il comprendra de quelle horrible farce il a été victime — ce sera son dernier concert, nous apprend Hammer. J’aime imaginer que lorsque Beethoven composera, quelques semaines plus tard, le cycle de lieder An die ferne Geliebte , à l’aimée lointaine, c’est à cette distance de la surdité qu’il pensera, qui l’éloigne du monde plus sûrement que l’exil, et même si on ignore encore, malgré les recherches passionnées des spécialistes, qui était cette jeune femme, on devine, dans le Nimm sie hin, denn, diese Lieder final, toute la tristesse de l’artiste qui ne peut plus chanter ou jouer lui-même les mélodies qu’il écrit pour celle qu’il aime.
Читать дальше