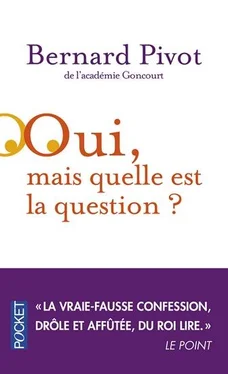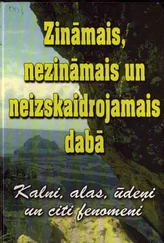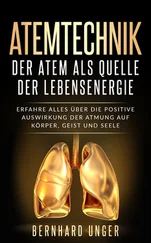— Mais je ne pars pas, répondit-elle. Je n’ai aucun voyage en vue.
— Mais si, chérie, tu vas partir. Et pour toujours.
De stupeur elle resta silencieuse pendant quelques secondes. Puis elle se reprit. Elle me dit qu’elle avait en promotion un roman dans lequel on pouvait lire le récit d’une scène identique, sauf que c’était la femme qui, de son couteau pointu et effilé de charcutière, montrait la porte du magasin à son mari, ex-champion cycliste, sans emploi.
De cette éprouvante liaison ainsi que de celle avec Marie-Dominique, je tirai quelques conclusions pour ma gouverne. D’abord, mais je le savais avant, poser des questions à la femme qui partage ma vie, et lui en poser beaucoup, est pour moi vital. Sinon, je m’étiole comme un arbre contraint de ne pouvoir étendre ses ramures. Ensuite, il est nécessaire pour une bonne santé de mon moi que je sois interrogé par ma compagne sur ce que je fais et pense. Pas trop, ah ! non, pas avec ma boulimie d’intervieweur compulsif, sans verser dans mes excès. Mais suffisamment pour que je retire l’impression de n’être pas transparent à ses yeux, ou opaque, et que je continue d’être pour elle un sujet de curiosité.
Où se situe la frontière entre trop de questions et pas assez ? That is the question . Ça dépend des femmes. Ça dépend de la fréquence et de l’opportunité de leurs questions. Ça dépend aussi de mon humeur. J’en conviens, j’étais et je suis toujours un fieffé casse-pieds.
Question de toutes les questions. La seule qui vaille. À moins que ce ne soit, question-scie, la plus cauteleuse et la plus vaine :
— Tu m’aimes ?
Variantes :
— Est-ce que tu m’aimes ?
— Dirais-tu que tu m’aimes ?
— Ça fait combien de temps que tu ne m’as pas dit que tu m’aimes ?
— C’est bien vrai que tu m’aimes ?
— J’aimerais t’entendre dire que tu m’aimes.
— Do you love me ?
Rien ne vaut cependant la brièveté de « tu m’aimes ? » Qui ne laisse pas à l’autre le temps de réfléchir. Juste deux syllabes. À la vitesse de la première balle de service. Retour gagnant espéré.
Comme la plupart des hommes je pose la question dans les moments d’union fusionnelle, de symbiose ressentie comme parfaite. La réponse ne fait alors aucun doute. Il est plus risqué et plus amusant de la poser quand l’amante ne s’y attend pas. Nous faisons des courses au supermarché, elle s’empare d’une boîte de fettucines à la sauce tomate et, tandis qu’elle la range dans le chariot, je l’interpelle : « tu m’aimes ? » Même question glissée à son oreille alors que, debout, secoués par le métro, la valise d’un passager dans nos pattes, un sac à dos lui rentrant dans le sien, nous partageons le même inconfort : « tu m’aimes ? » Ou encore, migraineuse, s’apprêtant à avaler deux comprimés de « Doliprane 1 000 mg », un verre d’eau dans l’autre main, elle s’entend demander : « tu m’aimes ? » D’abord étonnées, puis amusées, elles répondent souvent, comme dans les films français de la Nouvelle Vague, avec désinvolture.
Le philosophe Jean-Luc Marion — avec qui j’ai fait un « Aparté » il y a quelques semaines — disait que « la déclaration d’amour ne se conçoit que comme un CDI, jamais comme un CDD ». Les amoureux, en effet, partent avec la conviction, qui émane du cœur et non de la raison, que leur temps est illimité. Cependant, même au plus fort de la passion, ils sont effleurés par le doute. Et si leur engagement n’était qu’un CDD ? Ils se rassurent en se posant mutuellement la question de confiance. Dans ma bouche, elle devient assez rapidement : « Tu m’aimes toujours ? » Ou, plus précise, plus juste : « Tu m’aimes encore ? »
Je n’ai jamais apprécié qu’elle réponde : « et toi ? » Balle de retour dans le filet. Ou hors des limites. « Comment as-tu trouvé le film ? — Et toi ? » « Tu aimes le coq au vin jaune ? — Et toi ? » « Où veux-tu aller en vacances ? — Et toi ? » « Tu m’aimes encore ? — Et toi ? » Cette façon bébête de se défiler est agaçante, et, pour moi qui déteste que l’on me retourne mes questions, exaspérante.
J’ai connu une femme qui, au « tu m’aimes encore ? », ne répondait jamais par un mot. Elle optait pour un baiser sur la bouche. Plus ou moins long et profond. Le regard plus ou moins chatoyant. En prenant ou non ma tête dans ses mains. À moi de décrypter sa réponse, d’évaluer la force de son sentiment à travers l’exécution de son baiser. Un soir, elle m’embrassa sur la joue. C’était fini.
« Tu m’aimes ? » est un mot de passe. Jeune spectateur des films de cape et d’épée et des films de guerre, je tremblais lorsque le héros devait prononcer le mot de passe qu’une sentinelle lui demandait et qu’il ignorait. Chez les scouts, dans les batailles de foulards, camp contre camp, je ne laissais à personne le soin d’inventer le nouveau mot de passe. Dans l’amour, c’est toujours le même. Pas de suspense. Nous sommes dans le conventionnel. Le code est le même pour tous les couples. Moi qui fais profession de me détourner des questions convenues, j’ai près de quarante années de pratique intensive de « tu m’aimes ? » Pas de quoi faire le glorieux. Mais comment dire autrement ? Et comment me retenir de tomber dans le lieu commun ? Sauf que ces trois mots ne forment pas vraiment une question. « Tu m’aimes ? » est une déclaration d’amour.
Seigneur, Cléopâtre s’est-elle suicidée d’une piqûre d’aspic — mort originale et spectaculaire représentée par de nombreux peintres — ou en absorbant la poudre ou le liquide que contenaient les épingles creuses de sa chevelure ?
Seigneur, les relations si amicales, si tendres, entre les jeunes Jean Cocteau et François Mauriac sont-elle restées platoniques ?
Seigneur, qui, le 20 septembre 1979, place de l’Abbé-Georges-Henocque, dans le treizième arrondissement de Paris, a assassiné Pierre Goldman, écrivain militant révolutionnaire, qui fit de la prison pour trois braquages ?
Seigneur, où sont cachés les célébrissimes tableaux Le Concert , de Vermeer, Le Christ dans la tempête sur le lac de Génésareth , de Rembrandt, volés après avoir été découpés au cutter dans le musée Gardner, à Boston, le 18 mars 1990 ?
Personne n’a jamais pensé à me poser cette question qui me viendrait nécessairement à l’esprit si j’étais mon propre intervieweur : toi qui passes ton existence à poser des questions, en poses-tu à toi-même ? Oh, oui ! Ô combien ! Mais j’abomine cet exercice masochiste.
Comment échapper à son propre interrogatoire ? J’y parviens assez souvent. Surtout ne pas rêvasser. Ne pas laisser l’esprit divaguer avec son ombre ou son double. Ne pas céder à la narcissique mélancolie. Sauf cas grave, éviter les examens de conscience, les ruminations ontologiques, les recueillements, les huis clos du carafon. Dès que dans la solitude l’autoquestionnement menace, se saisir d’un journal ou d’un livre, ouvrir l’ordinateur, la radio ou la télévision, téléphoner, chanter, bricoler, faire des pompes. Ne pas se trouver disponible pour un tête-à-tête avec soi.
Si toutefois le courage prend le dessus sur ma lâcheté, la concentration sur la fuite, ou quand je ne peux faire autrement que retourner la question contre moi comme un assassin retourne l’arme du crime contre lui, ça se passe bizarrement, toujours de la même façon.
D’abord, je me pose des questions bateaux. « Comment vas-tu ?… Es-tu heureux ?… Comment marche ton boulot ?… Es-tu content des derniers audimats ?… Et si tu te mettais au régime ?… Côté cœur, ça va comment ?… » Je réagis aussitôt avec colère. « Arrête tes questions sans intérêt. Tu oserais les poser à tes interviewés ? Non, évidemment. Alors, pourquoi à moi ? Parce que tu me prends pour un con ! Tu m’interroges comme si tu n’attendais de moi que des réponses conventionnelles, rebattues, usées. De vraies réponses à de vraies questions te font peur. C’est pourquoi tu feins de m’interroger. Tu es dans l’esquive et l’hypocrisie. Comment pourrais-je être dans la sincérité ? »
Читать дальше