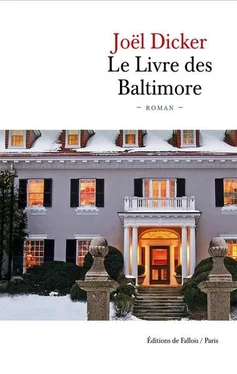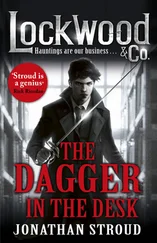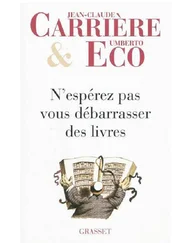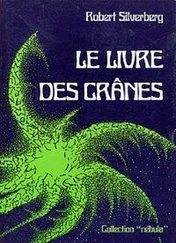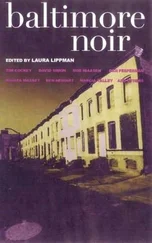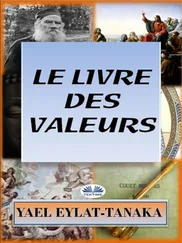— Markie, murmurait-il, mon petit Markie ! Ça me fait plaisir de te voir.
— Ça va, Oncle Saul ?
Souvent, je lui posais la question en espérant qu'il retrouverait son air invincible, qu'il se rirait des tracas comme il avait su le faire du temps de notre jeunesse perdue et qu'il me dirait que tout allait bien, mais il hochait la tête et me répondait :
— C'est un cauchemar, Marcus. Un cauchemar.
Il s'asseyait sur le lit et attrapait le téléphone pour appeler la réception.
— Tu restes combien de temps ? me demandait-il.
— Autant que tu veux.
J'entendais un employé répondre à l'autre bout du fil et Oncle Saul dire : « Mon neveu est là, il me faudrait une autre chambre, s'il vous plaît. » Puis il se tournait vers moi et me disait :
— Pas plus longtemps que le week-end. Tu dois avancer dans ton livre, c'est important.
Je ne comprenais pas pourquoi il ne rentrait pas chez lui. Puis, au début de l'été, un jour où j'allai faire un tour à Oak Park, à la recherche d'inspiration pour mon livre, je découvris avec horreur un camion de déménagement devant la maison des Baltimore. Une nouvelle famille y emménageait. Je trouvai le mari occupé à diriger deux costauds qui déplaçaient un panneau.
— Vous louez ? lui demandai-je.
— J'ai acheté, me répondit-il. Je retournai aussitôt au Marriott.
— Tu as vendu la maison d'Oak Park ?
Il me regarda tristement :
— Je n'ai rien vendu, Markie.
— Il y a pourtant une famille en train d'emménager à l'intérieur et qui affirme avoir acheté la maison.
Il répéta :
— Je n'ai rien vendu. La banque me l'a saisie.
J'en fus complètement abasourdi.
— Et les meubles ?
— J'ai tout fait débarrasser, Markie.
Dans la foulée, il m'annonça qu'il était sur le point de vendre la maison des Hamptons pour avoir des liquidités, et qu'il allait également se défaire de la Buenavista, et utiliser le capital pour aller s'offrir une nouvelle vie et une nouvelle maison ailleurs.
— Tu vas quitter Baltimore ? demandai-je, incrédule.
— Je n'ai plus rien à faire ici.
De la grandeur des Goldman-de-Baltimore, de ce qu'ils avaient été, il ne resterait bientôt plus rien. Ma seule parade à la vie, c'était mon livre.
Grâce aux livres,
Tout était effacé
Tout était oublié.
Tout était pardonné.
Tout était réparé.
À mon bureau de Montclair, je pouvais revivre éternellement le bonheur des Baltimore. Au point que je ne voulais plus quitter ma pièce, et s'il me fallait vraiment m'absenter, j'étais encore plus excité de les retrouver à mon retour.
Et quand je retournais au Marriott, à Baltimore, je détournais l'attention d'Oncle Saul de sa télévision en lui parlant du livre que j'écrivais. Il s'y intéressait au plus haut point, n'en parlait sans cesse, voulait savoir comment j'avançais et il pourrait bientôt en lire un extrait.
— De quoi parle ton roman ? m'interrogeait-il.
— C'est l'histoire de trois cousins.
— Les trois cousins Goldman ?
— Les trois cousins Goldstein, le corrigeais-je. Dans les livres, ceux qui ne sont plus se retrouvent et s’étreignent.
Je passai dix mois à raccommoder les plaies de mes cousins en réécrivant notre histoire. Je terminai le roman les cousins Goldstein à la veille de Thanksgiving 2005, soit une année exactement après le Drame.
Dans la scène finale du roman des Goldstein, Hillel et Woody descendaient en voiture de Montréal vers Baltimore. Ils s'arrêtaient dans le New Jersey pour me prendre et nous continuions la route ensemble. À Baltimore, dans une magnifique maison illuminée, le couple insubmersible d'Oncle Saul et Tante Anita attendait notre retour.
Durant cet été 2012, grâce à la magie du roman, je les retrouvai comme je l'avais déjà fait sept ans plus tôt.
Une nuit, vers deux heures du matin, ne parvenant pas à trouver le sommeil, je m'installai sur la terrasse. Malgré la nuit, il faisait une chaleur tropicale, mais j'étais bien dehors, bercé par le chant des grillons. J'ouvris mon cahier et je me mis à écrire son nom. Il n'en fallut pas plus pour qu'elle apparaisse devant moi.
— Tante Anita, murmurai-je.
Elle me sourit et posa avec tendresse ses mains sur mon visage.
— Tu es toujours aussi beau, Markie.
Je me levai et l'enlaçai.
— Ça fait tellement longtemps, lui dis-je. Tu me manques terriblement.
— Toi aussi, mon ange.
— J'écris un livre sur vous. Un livre sur les Baltimore.
— Je sais, Markie. Je suis venue te dire qu'il faut que tu arrêtes de te torturer avec le passé. D'abord le livre de tes cousins, maintenant le livre des Baltimore. Il est temps que tu écrives le livre de ta vie. Tu n'es responsable de rien, et il n'est rien que tu aurais pu faire. Quant au coupable, s'il en faut un, des chaos de nos vies, ce n'est que nous, Marcus. Nous seuls. Chacun est responsable de sa vie. Nous sommes responsables de ce que nous sommes devenus. Marcus, mon neveu, mon chéri, rien, m'entends-tu, rien de tout cela n'est de ta faute. Et rien de tout cela n'est de la faute d'Alexandra. Tu dois laisser partir les fantômes.
Elle se leva.
— Où vas-tu ? demandai-je.
— Je ne peux pas rester.
— Pourquoi ?
— Ton oncle m'attend.
— Comment va-t-il ?
Elle sourit.
— Il va très bien. Il dit qu'il a toujours su que tu écrirais un livre sur lui.
Elle sourit, me fit un signe de la main et disparut dans l'obscurité.
À sa parution en 2006, le succès phénoménal de mon livre me rendit mes deux cousins. Ils étaient partout : dans les librairies, dans les mains des lecteurs, dans les bus, dans les métros, dans les avions. Ils m'accompagnèrent fidèlement à travers le pays durant toute la tournée promotionnelle qui suivit la parution du roman.
Je n'avais plus jamais eu de contact avec Alexandra. Mais je l'avais revue un nombre incalculable de fois sans qu'elle le sache. Sa carrière avait pris un envol spectaculaire. Pendant l'année 2005, son premier disque avait continué sa progression dans les classements, atteignant, au mois de décembre, le million et demi d'exemplaires vendus, et son titre phare avait terminé à la première place des Charts américains. Sa notoriété avait rapidement explosé. L'année de la publication de mon livre fut celle de la sortie du deuxième album d'Alexandra. C'était pour elle le triomphe absolu. Public et critiques étaient conquis.
Je n'avais jamais cessé de l'aimer. Je n'avais jamais cessé de l'admirer. J'allais régulièrement la voir en concert. Tapi dans l'obscurité de la salle, anonyme parmi des milliers d'autres spectateurs, je bougeais mes lèvres en même temps que les siennes pour réciter les paroles de ses chansons que je connaissais par coeur, pour la plupart écrites dans notre petit appartement de Nashville. Je me demandais si elle y vivait encore. Certainement pas. Elle avait sûrement emménagé dans la banlieue aisée de Nashville, là où, à l'époque, nous allions ensemble admirer les maisons en nous demandant laquelle nous habiterions un jour.
Avais-je des remords ? Évidemment. J'en crevais. En la voyant sur scène, je fermais les yeux pour n'entendre plus que le son de sa voix, et dans ma tête je retournais des années en arrière. Nous étions sur le campus de l'université de Madison et elle me tirait par la main. Je lui demandais :
— T'es sûre que personne ne va nous voir ?
— Mais non ! Allez, viens je te dis !
— Et Woody et Hillel ?
— Ils sont à New York, chez mon père. T'inquiète.
Читать дальше