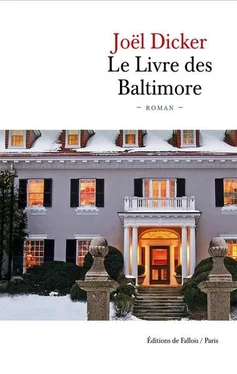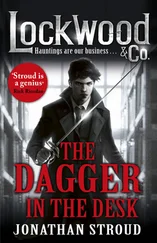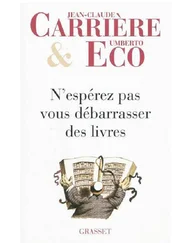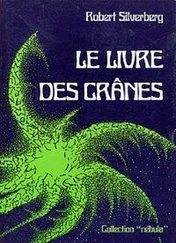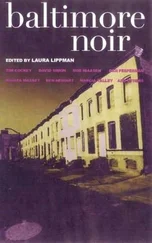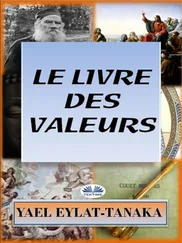À l'aéroport de Nassau, j'achetai un billet pour le premier vol à destination de New York. Je voulais disparaître à jamais. Pourtant, elle me manquait déjà. Et dire que je n'allais plus la revoir pendant huit longues années.
Il m'arrive souvent de repenser à cette scène. Moi qui abandonne Alexandra. En ce chaud mois de juin 2012, seul à mon bureau de Boca Raton, retraçant les méandres de notre jeunesse, je pensais à elle, à Londres. Je n'avais qu'une envie : aller la retrouver. Mais il me suffisait de la revoir en larmes, poursuivant mon taxi, pour me dissuader de faire quoi que ce soit. Avais-je le droit de surgir dans sa vie après huit ans et de tout chambouler ?
Quelqu'un frappa à la porte de la pièce. Je sursautai. C'était Leo.
— Pardonnez-moi, Marcus. Je me suis permis d'entrer chez vous : je ne vous vois plus et je commençais à me faire du souci. Est-ce que tout va bien ?
Je soulevai le cahier dans lequel j'écrivais en lui adressant un sourire amical.
— Tout va bien, Leo. Merci pour le cahier.
— Il vous revient de droit. C'est vous l'écrivain, Marcus. Un livre, c'est beaucoup plus de travail que je pensais. Je vous dois des excuses.
— Ne vous en faites pas.
— Vous avez l'air un peu triste, Marcus.
— Alexandra me manque.
Janvier 2005.
Dans les semaines qui suivirent ma rupture avec Alexandra, je passai la plupart de mon temps à Baltimore. Ce n'était pas tant pour rendre visite à Oncle Saul que pour me cacher d'elle. J'avais tiré un trait sur elle, j'avais changé de numéro de téléphone. Je ne voulais pas qu'elle vienne à Montclair.
Je me repassais sans cesse dans la tête la scène du départ d'Oak Park, lorsque la voiture d'Hillel et Woody bifurquait vers l'autoroute. Ils entraient dans la clandestinité. Si j'avais connu leur projet de fuite, j'aurais pu les en dissuader. J'aurais raisonné Woody. Qu'est-ce que c'était que cinq années ? A la fois beaucoup et rien. En sortant, il n'aurait même pas trente ans. Il aurait la vie devant lui. Et puis, s'il se tenait bien, il pourrait même bénéficier d'une remise de peine. Il aurait pu utiliser ces années pour terminer ses études par correspondance. Je l'aurais convaincu que nous avions la vie devant nous.
Depuis leur mort, tout semblait s'effondrer. À commencer par la vie d'Oncle Saul. La mauvaise passe dans laquelle il se trouvait ne faisait que commencer.
Son éviction de son cabinet d'avocats commençait à faire du bruit. Des rumeurs disaient que la vraie raison de son départ était un important détournement de fonds. Le conseil de discipline du barreau du Maryland venait d'ouvrir une procédure, estimant que le comportement d'Oncle Saul, s'il était avéré, portait atteinte à la profession.
Pour sa défense, Oncle Saul se fit épauler par Edwin Silverstein. Je le croisais régulièrement au Marriott. Un soir, il m'emmena dîner dans un restaurant vietnamien du quartier.
Je lui demandai :
— Qu'est-ce que je peux faire pour mon oncle ?
Il me répondit :
— Honnêtement, pas grand-chose. Tu sais, Marcus, t'as du cran. C'est pas donné à tout le monde. T'es vraiment un chouette garçon. Ton oncle a de la chance de t'avoir…
— Je voudrais faire plus.
— Tu en fais déjà assez. Saul m'a dit que tu voulais devenir écrivain ?
— Oui.
— Je ne pense pas que tu puisses vraiment bien te concentrer ici. Tu devrais aussi penser à toi et ne pas passer trop de temps à Baltimore. Tu devrais aller écrire ton bouquin.
Edwin avait raison. Il était temps pour moi de me lancer dans le projet qui me tenait tant à cœur. C'est dans le courant de ce mois de janvier, en rentrant d'un séjour à Baltimore, que je commençai mon premier roman. J'avais compris que pour faire revenir mes cousins, il me faudrait les raconter.
L'idée me vint sur une aire de l'autoroute I-95, quelque part en Pennsylvanie. J'étais en train de boire un café et de relire mes notes quand je les vis entrer. C'était impossible. Pourtant, c'était bien eux. Ils plaisantaient, heureux, et en me voyant, me sautèrent dessus.
— Marcus, me dit Hillel en me serrant contre lui, je savais bien que c'était ta voiture !
Woody se joignit à notre accolade et noua ses énormes bras autour de nous deux.
— Vous n'êtes pas réels, dis-je. Vous êtes morts ! Vous êtes deux connards morts qui m'avez laissé tout seul dans ce monde de merde !
— Oh, Markikette, ne fais pas la tête ! lança Hillel goguenard, en m'ébouriffant les cheveux.
— Viens ! me dit Woody dans un sourire consolateur. Viens avec nous !
— Où allez-vous ?
— Au Paradis des Justes.
— Je ne peux pas vous accompagner.
— Pourquoi ?
— Je dois aller à Montclair.
— Alors, nous te retrouverons là-bas.
Je ne fus pas certain de bien comprendre. Ils me serrèrent contre eux et repartirent. Avant qu'ils ne passent la porte, je les interpellai :
— Hillel ! Wood' ! Est-ce que c'était de ma faute ?
— Non, bien sûr que non ! répondirent-ils comme un seul homme.
Ils tinrent parole. Mes cousins adorés, je les retrouvai à Montclair, dans le bureau aménagé par ma mère. J'étais à peine assis à ma table de travail, et les voilà qui dansaient déjà autour de moi. Ils étaient tels que je les avais toujours connus : bruyants, magnifiques, débordants de tendresse.
— J'aime ton bureau, me dit Hillel, vautré sur mon fauteuil.
— J'aime la maison de tes parents, poursuivit Woody. Pourquoi est-ce qu'on n'est jamais venus ?
— Je ne sais pas. C'est vrai… Vous auriez dû.
Je leur montrai mon quartier, nous arpentâmes Montclair. Ils trouvaient que tout était beau. Notre trio réuni à nouveau me remplissait d'un bonheur fou. Puis nous retournions à mon bureau et je reprenais le cours de mon histoire.
Tout s'arrêtait lorsque mon père ouvrait la porte de la chambre.
— Marcus, il est deux heures du matin… Tu travailles encore ? me demandait-il.
Ils s'enfuyaient tous les deux par les interstices du plancher comme des souris effrayées.
— Oui, je vais bientôt aller me coucher.
— Je ne voulais pas te déranger. J'ai vu de la lumière et… Est-ce que tout va bien ?
— Tout va bien.
— Il m'a semblé entendre des voix…
— Non, c'était peut-être de la musique.
— Peut-être.
Il venait m'embrasser.
— Bonne nuit, fils. Je suis fier de toi.
— Merci, P'a. Bonne nuit à toi aussi.
Il s'en allait en refermant la porte. Mais ils étaient partis. Ils avaient disparu. Ils étaient les disparus.
*
Entre janvier et novembre 2005, j'écrivis sans relâche dans le bureau de Montclair. Je descendais tous les week-ends à Baltimore retrouver Oncle Saul.
Je fus le seul des Goldman à aller le voir régulièrement. Grand-mère disait que c'était trop pour elle. Mes parents firent l'aller-retour quelquefois, mais je crois qu'ils avaient du mal à accepter la situation. Et puis il fallait être capable de supporter Oncle Saul, en fantôme de lui-même, qui refusait de quitter le périmètre de l'hôtel Marriott de Baltimore où il résidait.
Pour ne rien arranger, en février, sur décision du conseil de discipline, Oncle Saul fut radié du barreau du Maryland. Le Grand Saul Goldman ne serait plus jamais avocat.
Je venais le retrouver sans rien attendre de lui. Je ne le prévenais même pas de ma venue. Je quittais Montclair en voiture et je roulais jusqu'au Marriott. À force d'y venir. j'avais l'impression d'être dans cet hôtel comme dans ma propre maison ; les employés m'appelaient par mon prénom, j'entrais directement dans les cuisines pour commander ce que je voulais. À mon arrivée, je montais au septième étage, je frappais à la porte de sa chambre et il ouvrait, la mine défaite, la chemise froissée, la télévision en arrière-fond sonore. Il me disait bonjour comme si j'arrivais de la rue d'à côté. Je ne m'en formalisais pas. Il finissait par me serrer contre lui.
Читать дальше