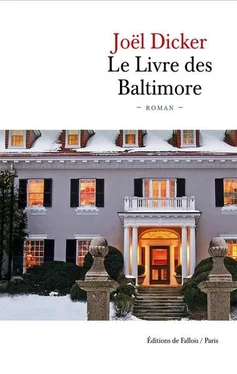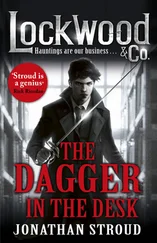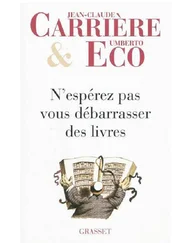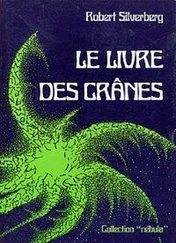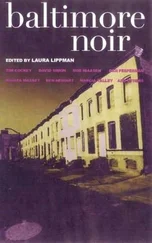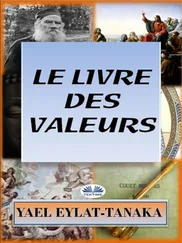— Je n'ai pas vu Duke aujourd'hui.
— Il n'est pas venu ?
— Si, mais j'ai dû le renvoyer chez lui. La peur d'être pris.
Il me dévisagea d'un air curieux.
— Vous ne seriez pas un peu malade mental sur les bords ?
Le lendemain, quand Duke jappa à six heures, je lui avais préparé de la viande de première qualité. Comme je devais passer au bureau de poste, je l'emmenai avec moi. Je ne résistai pas ensuite à l'envie d'aller nous promener en ville : je le conduisis chez un toiletteur et l'emmenai manger une glace à la pistache dans un petit établissement artisanal que j'affectionnais. Nous étions installés sur la terrasse et je lui tenais son cône en biscuit qu'il léchait avec passion lorsque j'entendis une voix d'homme qui m'interpellait :
— Marcus ?
Je me tournai, terrifié de savoir qui m'avait pris en flagrant délit. C'était Leo.
— Leo, bon sang, vous m'avez fait peur !
— Marcus, mais vous êtes complètement timbré ! Qu'est-ce que vous faites ?
— Nous mangeons une glace.
— Vous vous promenez en ville avec le chien, au vu et au su de tous ! Vous voulez qu'Alexandra découvre le pot aux roses ?
Leo avait raison. Et je le savais. Peut-être que c'était ce que je voulais au fond : qu'Alexandra découvre tout. Qu'il se passe quelque chose. Je voulais davantage que nos moments volés. Je réalisais que je voulais que tout redevienne comme avant. Mais huit ans avaient passé et elle avait refait sa vie.
Leo me somma de ramener Duke à Alexandra avant qu'il ne me prenne l'envie de l'emmener au cinéma ou de faire je-ne-sais-quelle-imbécillité. Je lui obéis. À mon retour, je le trouvai devant sa maison, occupé à écrire. Je pense qu'il s'était installé là pour me guetter. J'allai le trouver.
— Alors ? lui demandai-je en désignant de la tête son cahier toujours vierge. Comment avance votre roman ?
— Pas mal. Je me dis que je pourrais écrire l'histoire d'un vieux type qui voit son jeune voisin aimer une femme à travers un chien.
Je soupirai et je m'assis sur la chaise à côté de la sienne.
— Je ne sais pas ce que je dois faire, Leo.
— Faites comme avec le chien. Faites-vous choisir. Le problème des gens qui achètent un chien, c'est qu'ils ne réalisent souvent pas qu'on ne choisit pas un chien, mais bien l'inverse : c'est lui qui décide de ses affinités. C'est le chien qui vous adopte, feignant d'obéir à toutes vos règles pour ne pas vous peiner. S'il n'y a pas de connivence, c'est foutu. J'en veux pour preuve cette histoire épouvantable mais véridique survenue dans l'État de Géorgie, où une mère célibataire, très grande paumée devant l'Éternel, avait acheté un teckel vairon, baptisé Whisky, pour animer un peu son quotidien et celui de ses deux enfants. Mais pour son malheur, Whisky ne lui correspondait pas du tout, et la cohabitation devint intenable. Faute de réussir à s'en débarrasser, la femme décida d'employer les grands moyens : elle le fit s'asseoir devant sa maison, l'aspergea d'essence et lui mit le feu. Le clébard en flammes, hurlant à la mort, s'élança dans une course endiablée et finit par entrer dans la maison, dans laquelle les deux enfants étaient avachis devant la télévision. La baraque brûla intégralement, Whisky et les deux enfants avec, et les pompiers n'en retrouvèrent que des cendres. Vous comprenez maintenant pourquoi il faut laisser le chien vous choisir.
— J'ai peur de n'avoir rien compris à votre histoire, Leo.
— Vous devez vous y prendre de la même façon avec Alexandra.
— Vous voulez que je la brûle vive ?
— Non, imbécile. Cessez de jouer les amoureux transis : faites-vous choisir par elle.
Je haussai les épaules.
— De toute façon, je crois qu'elle va bientôt rentrer à Los Angeles. Il était question qu'elle reste le temps de la convalescence de Kevin, et il est quasiment remis sur pied.
— Alors quoi, vous allez vous laisser faire ? Arrangez-vous pour qu'elle reste ! Et puis, allez-vous me raconter à la fin ce qui s'est passé entre vous deux ? Vous ne m'avez toujours pas parlé de votre rencontre.
Je me levai.
— La prochaine fois, Leo. Promis.
Le lendemain matin, mon copain Duke se fit repérer pendant son évasion. Il jappa comme d'habitude devant ma porte à six heures du matin, mais en ouvrant la porte, je découvris derrière lui Alexandra, mi-amusée, mi-incrédule, vêtue de ce qui semblait être son pyjama.
— Il y a un trou dans le fond du jardin, me dit-elle. Je l'ai vu ce matin. Il passe sous la haie et il vient directement ici ! Tu peux y croire ?
Elle éclata de rire. Elle était toujours aussi belle, même en pyjama et sans maquillage.
— Tu veux entrer boire un café ? lui proposai-je.
— Je veux bien.
Je réalisai soudain que les affaires de Duke étaient éparpillées dans mon salon.
— Attends une seconde, je dois mettre un pantalon.
— Tu portes déjà un pantalon, me fit-elle remarquer.
Je ne répondis rien et lui refermai simplement la porte au nez en la priant d'avoir un instant de patience. Je me précipitai à travers la maison et ramassai tous les jouets de Duke, les gamelles, la couverture et les jetai en vrac dans ma chambre.
Je retournai aussitôt ouvrir la porte d'entrée, et Alexandra me lança un regard amusé. En refermant la porte derrière elle, je ne remarquai pas l'homme qui nous observait depuis sa voiture et prenait des photos.
Baltimore.
1992–1993.
Selon un calendrier immuable, tous les quatre ans, Thanksgiving est précédé par une élection présidentielle. En 1992, le Gang des Goldman participa de façon active à la campagne de Bill Clinton.
Oncle Saul était un démocrate convaincu, ce qui avait généré des tensions régulières lors de nos vacances d'hiver en Floride, durant le Nouvel an 1992. Ma mère affirmait que Grand-père avait toujours voté républicain, mais que depuis que le Grand Saul votait libéral, Grand-père faisait de même. Quoi qu'il en fût, Oncle Saul fit notre première éducation citoyenne en nous faisant rallier la cause de Bill Clinton. Nous allions sur nos douze ans et l'épopée du Gang des Goldman battait son plein. Je ne vivais que pour eux, que pour ces moments ensemble. Et la seule idée de faire campagne avec eux — peu importait pour qui — m'emplissait de joie.
Woody et Hillel n'avaient jamais cessé de travailler pour Bunk. Non seulement ils en tiraient du plaisir, mais ils arrondissaient leur argent de poche. Ils travaillaient vite et bien, et certains habitants d'Oak Park, agacés par la lenteur de Bunk, les contactaient même directement pour effectuer des travaux de jardin. Dans ces cas-là, ils retranchaient 20 % de leurs gains, qu'ils reversaient à Bunk sans que celui-ci ne s'en rende compte, en déposant l'argent dans la poche de sa veste ou dans la boîte à gants de sa camionnette. Lorsque je venais à Baltimore, j'avais un plaisir fou à les aider, surtout s'ils travaillaient pour leurs propres clients. Ils s'étaient créé une petite clientèle fidèle, et portaient un t-shirt qu'ils avaient fait fabriquer dans une mercerie avec, cousu au niveau du cœur, l'inscription Goldman Jardiniers, depuis 1980. Ils m'en avaient fabriqué un également, et je ne me suis jamais senti aussi fier qu'en déambulant dans Oak Park avec mes deux cousins, tous trois vêtus de nos uniformes magnifiques.
J'étais très admiratif de leur esprit d'entreprise et très fier de gagner un peu d'argent à la sueur de mon front. C'était une ambition que j'avais depuis que j'avais découvert les talents de self-made-man de l'un de mes amis d'école à Montclair, Steven Adam. Steven était un garçon très gentil avec moi : il m'invitait souvent chez lui pour passer l'après-midi et me proposait de rester dîner ensuite. Mais une fois à table, il lui arrivait de piquer des colères terribles. À la moindre contrariété, il se mettait à insulter sa mère de façon terrifiante. Il suffisait que la nourriture ne soit pas à son goût, et soudain il tapait du poing, envoyait valdinguer son assiette et hurlait : « J 'en veux pas de ton jus de poubelle, c'est dégueulasse ! » Le père se levait aussitôt : la première fois que j'en fus témoin, je pensais que c'était pour donner une magistrale paire de gifles à son fils, mais à ma grande surprise, le père alla attraper une tirelire en plastique sur une commode. C'était depuis toujours le même cirque. Le père se mettait à courir derrière Steven en piaillant : « La tirelire à gros mots ! Trois gros mots, soixante-quinze cents ! — Dans ton cul, ta tirelire de mes deux ! répondait Steven en courant à travers le salon et en brandissant son doigt du milieu. — Tirelire à gros mots ! Tirelire à gros mots ! » ordonnait le père d'une voix tremblante.
Читать дальше