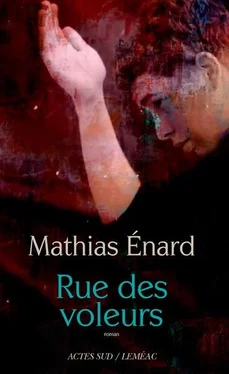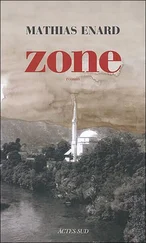J’étais d’accord, tout cela était un peu effrayant ; je lui avais parlé, par mail, de l’attentat du Café Hafa et je lui ai montré le portrait-robot quand elle est revenue à Tanger. Elle m’a dit tout simplement c’est lui, c’est horrible, il faut faire quelque chose.
C’est lui, c’est atroce, c’est Bassam, il est devenu fou, il faut que tu ailles voir la police pour leur dire.
J’ai essayé de la convaincre, ce n’est pas lui, s’il était à Tanger je le saurais, il aurait repris contact avec moi d’une façon ou d’une autre, et elle s’est un peu calmée.
Nous sommes en train de jouer à nous faire peur, j’ai dit.
Je ne voulais pas l’inquiéter plus en lui disant que j’avais reçu ce mail énigmatique. J’avais envie que Tunis soit parfaite, magique, comme avait été magique Tanger six semaines plus tôt ; je voulais être là pour elle, l’aider dans ses cours, lui parler pendant des heures de grammaire et de littérature arabes, baiser souvent, baiser le plus souvent possible et voir ce qu’il était advenu de la Révolution.
Rien de moins.
Judit est venue me chercher à l’aéroport ; les douaniers tunisiens ressemblaient aux gabelous marocains, gris et mastocs ; ils m’ont engueulé parce que je n’avais pas rempli la fiche de débarquement, dont j’ignorais jusqu’à l’existence, mais m’ont pris en pitié et m’ont laissé revenir sans avoir à refaire la queue.
Judit m’attendait juste à la sortie, j’ai hésité une seconde à la serrer dans mes bras — après tout nous étions dans l’aéroport d’un pays révolutionnaire. J’ai posé ma petite valise, j’ai attrapé Judit par la taille, elle a jeté ses mains autour de mon cou et nous nous sommes embrassés, jusqu’à ce que ce soit elle, un peu gênée, qui mette fin aux effusions.
Je venais de prendre l’avion pour la première fois, et pour la première fois, j’étais à l’étranger. Judit parlait beaucoup, très vite, de Tunis, de ses cours, de la ville, de son logement, de ses camarades ; je la regardais, ses cheveux longs éclaircis par l’été, ses traits fins, précis, une certaine rondeur autour des pommettes ; ses lèvres, que tous ces sons sortant de sa bouche ne laissaient jamais tranquilles.
La nuit tombait.
Judit avait décidé de m’offrir un taxi pour aller en ville ; à notre gauche on apercevait la lagune, le lac de Tunis ; le ciel rougissait encore un peu à l’ouest.
Elle habitait dans un minuscule appartement assez charmant à dix minutes à pied de l’institut où elle prenait ses cours ; en rez-de-chaussée, sur le côté d’un immeuble, deux pièces blanches donnant sur un petit patio tout aussi blanc, carrelé de faïence bleue : une chambre avec un grand matelas à même le sol et un petit bureau, et une cuisine-salon-salle à manger ; le tout ne devait pas mesurer plus de trente mètres carrés, mais les proportions étaient parfaites ; j’avoue avoir pris beaucoup de plaisir à saisir mes Poilus morts chaque matin en regardant l’ombre se réduire dans la cour, puis le soleil de l’été exploser sur les carreaux bleutés ; le soir, quand Judit rentrait, nous arrosions le sol et nous allongions sur les dalles, nus dans la fausse fraîcheur de l’humidité, jusqu’à ce que la nuit tombe.
Le samedi, Judit m’a fait visiter le centre de Tunis et la vieille ville ; la chaleur était moins étouffante qu’on n’aurait pu croire : un peu comme à Tanger, une légère brise soufflait de la mer. La réverbération était pourtant si puissante que la lagune paraissait une immense étendue de sel, d’un blanc éclatant. Le dialecte tunisien était amusant, plus chantant que le marocain ou l’algérien, avec déjà quelque chose d’oriental, me semblait-il. La Médina était un vaste labyrinthe à dévorer les touristes et il fallait se perdre dans les ruelles pour qu’on ne vous hèle plus toutes les deux minutes, mon ami, mon ami, un thé mon ami ? Un tapis, un souvenir ? Et j’étais assez fier, parce qu’en compagnie de Judit, on m’adressait le plus souvent la parole en français.
La veille, jour de mon arrivée, il y avait eu de violents affrontements entre manifestants et policiers devant le palais du gouvernement, place de la Casbah ; tout le quartier avait été bouclé, et le sit-in de jeunes qui demandaient entre autres la démission du ministre de l’Intérieur avait été dispersé à coups de matraques et de gaz lacrymogènes. Les sites internet appelaient à faire revivre la Révolution, dont on sentait bien qu’elle était en train de mourir, ou de se terminer, c’est selon, et les élections, en octobre, ont remis comme il fallait s’y attendre le pouvoir aux mains des Islamistes d’Ennahda. Les jeunes sentaient bien qu’ils allaient se faire voler les fruits de la révolte, et que l’émeute allait accoucher d’un gouvernement des plus conservateurs, pour ne pas dire réactionnaire — certes démocratique, mais on n’allait pas beaucoup plus rigoler que sous Ben Ali. J’imaginais sentir, en parvenant sur la place de la Casbah encore barricadée, encombrée de cars de flics et d’hommes casqués, l’odeur piquante des lacrymos — les larmes acides des révolutionnaires. Les combats de la veille s’étaient étendus à une bonne partie du pays et à Sidi Bouzid, bastion de la contestation, la police avait même tiré à balles réelles — soi-disant pour effrayer la foule, mais un gamin de quatorze ans avait tout de même été tué par un ricochet. D’après ce que je lisais sur Internet, beaucoup de militants pensaient que le rassemblement de vendredi avait été organisé par les Islamistes.
Dans la chaleur de l’été, les Tunisiens se plaignaient plus de l’absence (relative) de touristes que du gouvernement provisoire. Ils s’accrochaient tous à la date du 23 octobre, qui mettrait un terme démocratique, semblait-il, aux gaz et aux coups de gourdin.
Il y avait, pour moi, peut-être parce que j’étais étranger, une certaine tristesse dans cette transition, dans l’après-Révolution, et Tunis semblait comme paralysée, pétrifiée dans la fumée des grenades et la blancheur de l’été.
Je n’étais pas Ibn Batouta : je n’allais pas rencontrer les Ulémas importants, ni écouter les sermons dans les mosquées, même si ça ne m’aurait pas déplu, mais il aurait fallu que j’y aille seul : en Tunisie, ainsi qu’au Maroc, les mosquées sont interdites aux non-musulmans. Comme Judit trouvait cette mesure assez discriminatoire — elle m’assurait qu’au Caire ou à Damas ce n’était pas du tout le cas — j’en ai cherché la cause, et ce sont les Français, plus précisément le premier résident général au Maroc, Lyautey, qui instaurèrent cette loi, qui s’étendit ensuite à tout le Maghreb sous domination française, pour assurer le respect entre les différentes communautés religieuses. J’ignore si c’est bien ou mal, mais il me semblait étrange que les groupes de touristes puissent librement entrer dans la mosquée des Omeyades ou celle d’Al-Azhar et pas à Kairouan ou à la Zitouna, sans parler de Judit qui, sans être musulmane, savait de nombreux passages du Coran par cœur et était tout à fait respectueuse à l’égard de la religion. Par solidarité, je ne suis donc pas entré voir la fameuse cour aux colonnes antiques et les salles de prière de la plus célèbre mosquée du Maghreb, qu’à cela ne tienne. Au fond je n’étais là que pour être avec elle, et la semaine a passé vite ; je trouvais que nos liens étaient chaque jour plus forts, plus intimes, à tel point qu’il serait bientôt très difficile de nous séparer. Nous parlions une langue qui n’appartenait qu’à nous, un mélange d’arabe littéraire, de dialecte marocain et de français ; Judit faisait chaque jour des progrès énormes en arabe. Et effectivement, quand il m’a fallu quitter Tunis, après sept jours de soldats morts, de Casanova — Judit me regardait travailler, par-dessus mon épaule, elle rigolait de mes Poilus et trouvait la langue du Vénitien assez difficile à comprendre — , de séances de piscine du pauvre dans le patio, de promenades à la Goulette, à Carthage et à La Marsa, plus l’heure du départ approchait et plus je me sentais déprimé de rentrer à Tanger, d’autant que cette fois-ci nous n’avions aucune perspective de retrouvailles proches, aucun projet. Judit me promettait qu’elle reviendrait à l’automne, mais elle ignorait quand et comment, elle n’aurait sans doute pas d’argent.
Читать дальше