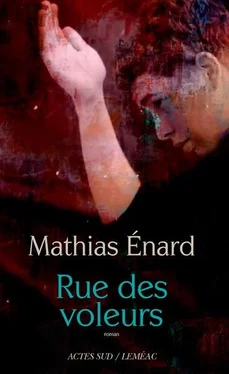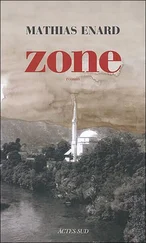Il y avait très peu de jeunes sur l’ Ibn Batouta . La plupart de l’équipage avait dépassé la quarantaine. Il faut dire que nous n’étions pas nombreux pour un navire de cette taille ; l’absence de service de cabine, comme de restauration (enfin, je vendais des sandwiches et des chips à la cafétéria, ça oui) permettait un effectif aussi réduit : la traversée était bien trop courte pour s’embarrasser de détails.
Je n’étais pas Sindbad, ça c’est certain. Malgré le calme de la mer, les mouvements du bateau me provoquaient une sensation étrange, comme si j’avais fumé trop de joints — pas vraiment malade, mais pas tout à fait en forme non plus. Mon corps, mes jambes en particulier ne semblaient plus obéir aux mêmes lois que sur la terre ferme, pris d’une légère ondulation, ou plutôt une oscillation, un rythme neuf qui faisait que même le plus anodin des mouvements — grimper un escalier, parcourir un pont — requérait une acuité différente de la normale : soudain, le déplacement n’était plus un phénomène si naturel qu’on puisse l’accomplir sans y penser, au contraire, tout vous rappelait qu’il fallait en être terriblement conscient, sous peine de zigzaguer, de glisser légèrement ou même, en novembre, pendant les deux ou trois tempêtes que j’ai pu essuyer, de vous retrouver carrément sur le cul, projeté sans ménagement contre le plancher par un hoquet de l’embarcation.
Mais c’était tout de même magnifique d’être là : le paysage était grisant. Le matin, quand le soleil était encore bas, les collines du Maroc s’éloignaient, brillantes, jusqu’à devenir des taches vertes et blanches, des promontoires pour géants, pour Hercule, et la lumière paraissait jouer avec ses colonnes, du côté du cap Spartel ; puis la côte andalouse se rapprochait, et on pensait alors à l’expédition de Tareq ibn Ziyad, le conquérant de l’Espagne, et à ces Berbères qui avaient défait les Wisigoths : je commandais ma propre armée de camions, de vieilles Renault, de Mercedes ; ensemble nous allions reprendre Grenade, et ce n’était pas la Guardia Civil du port d’Algésiras qui allait nous en empêcher. Il fallait d’abord anesthésier tout le pays avec quelques tonnes de bon shit rifain, parachuté gratuitement au-dessus des grandes villes, notre offensive aérienne ; des régiments de Gnawas feront trembler les murailles des dernières cités hostiles avec leurs instruments et enfin mes poids lourds et mes bagnoles d’émigrés quitteront le ventre de l’ Ibn Batouta dans une procession glorieuse pour se diriger vers l’Alhambra : l’Espagne redeviendra marocaine, ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être.
Les flics du port d’Algésiras devaient partager ma façon de voir, parce qu’ils se méfiaient de nous comme de la peste ; ils nous soupçonnaient d’essayer de les rouler, de faire de la contrebande, de laisser passer des clandestins. Enfin, je dis nous, mais je devrais plutôt parler des vieux marins du bateau : moi, ils se contentaient de me mépriser. Lorsque nous arrivions à quai, nous commencions le débarquement ; j’étais alors sur le sol de l’Europe, et cette sensation était étrange, au début — avant que les grillages et les baraques de la Douane dans mon dos ne me fassent comprendre qu’en réalité je n’étais nulle part.
À la fin octobre, alors que les Tunisiens venaient de porter démocratiquement les Islamistes d’Ennahda au pouvoir et que les Espagnols se préparaient à élire les catholiques du Parti populaire, tout comme les Marocains, à peu près au même moment, étaient sur le point d’aller aux urnes, j’ai commencé à me lasser de ces allers-retours stériles sur le Détroit. Mon salaire tardait à arriver, on ne me payait pas, mes économies se réduisaient à pas grand-chose ; le boulot était assez fatigant et monotone. Je m’étais certes fait un ami au sein de l’équipage, Saadi, un vieux marin d’une soixantaine d’années qui avait navigué sur toutes les mers du globe, et était en préretraite dans le Détroit. Il me racontait des histoires inouïes, des récits dignes des romans d’aventures, et je feignais de les croire ; en tout cas, ça faisait passer le temps.
Je n’avais plus trop l’occasion de poursuivre ma carrière de poète : je rentrais trop crevé à la maison pour me mettre à écrire et même lire devenait une activité du dimanche, quand je ne travaillais pas. Mon appartement était très loin du port de Tanger Méditerranée et il me fallait trois bons quarts d’heure de bus pour aller au boulot ou en revenir. Enfin bref, je me demandais si je n’avais pas fait une énorme connerie de quitter M. Bourrelier et les soldats morts. Même ma correspondance avec Judit n’était plus aussi suivie. Je pensais à elle, très souvent même ; les premiers temps, je profitais de l’escale d’Algésiras pour envoyer une lettre manuscrite à Barcelone — Je t’écris depuis l’Andalousie — mais très vite, nous nous sommes rendu compte que ces missives et ces cartes postales mettaient au moins autant de temps à lui parvenir que si je les avais expédiées de Tanger. Judit s’investissait de plus en plus dans la contestation anti-système, comme elle disait ; elle avait rejoint un groupe de réflexion lié au mouvement des Indignés, ils préparaient plusieurs actions d’envergure pour après les élections. Ce qu’elle décrivait de la situation en Catalogne était assez effrayant ; la droite nationaliste au pouvoir détruisait systématiquement, disait-elle, tous les services publics, l’Université en tête : on supprimait des matières, les enseignants voyaient leur salaire se réduire de trimestre en trimestre. Elle était inquiète : déjà que la qualité n’est pas extraordinaire, on se demande ce que ça va devenir, disait-elle. Elle était à la croisée des chemins, en dernière année avant son diplôme, et il lui faudrait choisir une orientation, un master sans doute, ou un long séjour dans le Monde arabe ; elle hésitait à essayer de devenir interprète, enfin bref, elle était un peu perdue, et donc de plus en plus indignée.
J’avais reçu un ou deux mails de Bassam, toujours aussi énigmatiques, envoyés chaque fois de boîtes différentes. Il ne demandait pas de mes nouvelles ; il ne me donnait pas des siennes ; il se plaignait juste de la difficulté de l’existence et citait des versets coraniques. Un jour, la Sourate de la Victoire : Quand viendra la victoire de Dieu et la Conquête , etc. ; un autre la sourate du Butin : Et ton Seigneur révéla aux Anges : “Je suis avec vous : affermissez les croyants. Je vais jeter l’effroi dans les cœurs des impies. Frappez donc au-dessus des nuques.”
L’attentat du Café Hafa n’avait pas été revendiqué et l’on n’en parlait plus dans les journaux. Seules les élections retenaient l’attention de la presse, les élections en Tunisie, au Maroc, en Espagne, on avait l’impression qu’une vague de démocratie déferlait sur notre coin du monde.
J’étais suspendu, j’habitais le Détroit ; je n’étais plus ici et pas encore là-bas, éternellement sur le départ, dans le barzakh , entre la vie et la mort.
Mes cauchemars étaient récurrents et me pourrissaient la vie ; soit je rêvais de Meryem et des fleuves de sang, soit de Bassam et du Cheikh Nouredine ; je voyais des attentats, des explosions, des combats, des massacres à l’arme blanche. Je me souviens, une nuit particulièrement horrible j’ai rêvé que Bassam, le regard vide, un bandeau sur le front, égorgeait Judit comme un mouton, en la tenant par les cheveux. Cette scène atroce m’a hanté plusieurs jours.
Quand j’avais le temps, j’essayais de prier à heures régulières, pour me reposer l’esprit ; je recouvrais un peu de calme dans les prosternations rituelles et la récitation. Dieu était clément, il me consolait un peu.
Читать дальше