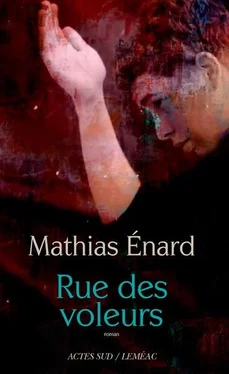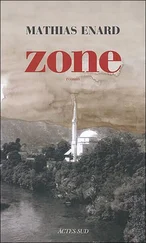Moi mon expérience dans la marine venait de se solder par ce naufrage au fond du port d’Algésiras, pas très glorieux — j’ai demandé à Saadi s’il avait déjà vu un cas semblable, de bateaux coincés au fond d’un port. Il m’a raconté qu’à Barcelone, un cargo ukrainien avait été abandonné par son armateur, incapable de payer la carène et les réparations : tout l’équipage était parti sauf un matelot, qui restait pour toucher le produit de la vente du navire et rapporter l’argent à ses camarades. L’Ukrainien est resté plus de deux ans seul sur son rafiot, disait Saadi, à vivre de la charité et des quelques billets que l’ancien équipage lui envoyait d’Odessa. Tout le monde le connaissait dans le port ; c’était un vrai héros. À ce moment-là nous faisions une ligne Le Pirée — Beyrouth — Larnaca — Alexandrie — Tunis — Gênes — Barcelone, on appelait ça faire l’autobus. Je voyais l’Ukrainien toutes les deux semaines. C’était un sacré bonhomme, avec une volonté incroyable. Chaque jour il allait emmerder les bureaux d’armateurs et les autorités du port pour trouver un acheteur pour son tas de rouille et éviter la vente aux enchères, où il aurait presque tout perdu — et crois-moi Lakhdar, un vieux cargo, même plus ou moins réparé, ça ne se vend pas comme une 205. Je lui donnais un coup de main pour faire tourner ses diesels ; je me souviens, c’étaient de magnifiques modèles soviétiques, de vraies horloges, même avec leurs dizaines de milliers d’heures au compteur, ils auraient pu faire le tour du monde. La barcasse était en mauvais état, c’est sûr, il aurait fallu changer l’axe de l’hélice et refaire une partie du système électrique, mais quelqu’un allait bien finir par la racheter, c’était juste une question de temps. Alors l’Ukrainien attendait. Il avait toute une série de combines pour subsister. Comme il était là à plein temps, il connaissait tous les dockers, tous les types de la capitainerie, il jouait aux cartes avec eux, organisait de petits trafics avec les bateaux de passage, des cigarettes, de l’alcool et même des boîtes de caviar russe qu’il revendait à un épicier de luxe du haut de la ville. Un chouette gars. Il fréquentait toujours le même bordel et a fini par épouser une prostituée colombienne — un jour quand on a accosté comme d’habitude à Barcelone, le bateau n’était plus là. Il avait été vendu à une compagnie grecque. Il navigue encore, d’ailleurs, ce rafiot, je l’ai croisé il n’y a pas si longtemps. Le type a organisé une fiesta de tous les diables pour fêter son départ ; il a invité des dizaines de connaissances dans une boîte pourrie et c’était une bringue extraordinaire, crois-moi, légendaire, les amies de la mariée dansaient à moitié nues, tout le monde a fini ivre mort — à la fin de la soirée, complètement saoul, il nous a annoncé solennellement qu’il partait s’installer avec sa femme à Bogotá, grâce aux quelques millions de pesetas que lui avait rapportées la vente du bateau ; il abandonnait à Odessa fiancée et camarades ; il partait en Amérique, loin dans les terres, avec sa belle mulâtresse.
Les mauvaises langues ajoutaient qu’il avait le projet de se lancer dans la contrebande avec le pognon.
Plus tard on a su qu’il avait été abattu d’une balle dans la tête en pleine rue à Barranquilla, sans que les rumeurs ne précisent si la vengeance des marins d’Odessa l’avait rattrapé, si un trafiquant colombien lui avait réglé son compte ou s’il avait été tout simplement victime de la guigne.
C’est la seule histoire que je connaisse de quelqu’un qui soit resté aussi longtemps dans un port à part nous, fils.
C’était rassurant.
Les histoires de Saadi avaient toujours un côté noir, tragique, sans que je réussisse à savoir si c’était l’aspect le plus sombre de sa personnalité ou si, réellement, la vie des marins comportait cette face obscure — nous, nous étions une centaine de matelots coincés à Algésiras, sur quatre ferries ; je doutais que l’un d’entre nous parvienne à s’enfuir en Colombie ou au Venezuela avec le moindre sou : les nouvelles étaient mauvaises ; la compagnie de navigation avait une dette gigantesque, en Espagne, en France, au Maroc ; nous ne reverrions sans doute jamais nos salaires perdus. Au bout d’un mois d’attente, démoralisés, morts de froid et d’ennui, alors que personne ne paraissait s’intéresser à notre sort de naufragés économiques, nous avons eu l’idée de nous adresser à la presse, pour attirer l’attention de l’opinion publique. Le syndicat des dockers nous a donné un coup de main. Il y eut plusieurs articles dans les journaux:
Comme leurs confrères bloqués à Sète, les marins de la Comanav-Comarit à Algésiras connaissent des moments difficiles. La ligne Tanger-Algésiras n’est plus desservie par la compagnie depuis début janvier. Bloqués à Algésiras, les marins voient se dégrader davantage leur situation au fil des jours. Manque de vivres et de combustible, pas de salaires depuis plusieurs mois, non-versement des cotisations sociales…
Cependant, contrairement aux hommes de mer actuellement au port français, les marins à Algésiras s’adressent aux médias. Ils ont tenu une conférence de presse récemment avec le soutien des Espagnols. Ils en ont assez et veulent rentrer chez eux. Ce sont des hommes qui ont généralement laissé femmes et enfants au Maroc. Ces derniers vivent, parfois, dans des conditions déplorables.
Une centaine de marins sont ainsi au port d’Algésiras où quatre ferries au total sont stationnés : le Banasa , le Boughaz , l’ Al-Mansour et l’ Ibn Batouta , mis sous saisie conservatoire en janvier dernier pour des raisons d’impayés.
Rien n’y a fait. Tout ce que nous avons réussi à obtenir, c’est une visite de plus de Mme le Consul.
Ce qui me désespérait plus que tout, c’était l’absence d’Internet. Mon ordinateur était resté à Tanger, dans ma chambre ; il y avait bien un “parloir” dans le port avec des cabines téléphoniques et deux ordinateurs, mais il fallait payer, et l’argent nous faisait défaut. Je ne pouvais pas retirer de fric à l’étranger depuis mon compte à Tanger. Le crédit de ma carte de téléphone s’était épuisé en SMS à Judit. C’était la misère. Une association caritative espagnole nous avait apporté des vêtements ; j’avais touché deux jeans rapiécés, des chemises trop grandes, un pull à rayures et une vieille parka kaki doublée de laine synthétique.
Judit semblait s’être complètement désintéressée de moi. En y repensant, les six derniers mois avaient distendu nos relations ; nous nous écrivions moins souvent, nous nous parlions moins au téléphone, et maintenant, enfermé dans le port d’Algésiras, je n’avais presque plus de nouvelles d’elle, ce qui me plongeait dans une tristesse mélancolique. Je racontais mes déboires à Saadi, qui compatissait tout en m’encourageant à l’oublier ; tu as vingt ans, il disait, tu en aimeras d’autres. Il me parlait des putains, des bordels du monde entier, où il avait trouvé du plaisir et de la compagnie, une famille immense éparpillée aux quatre coins de la terre. Il se souvenait des prénoms de toutes les filles qu’il fréquentait. Il me disait tu sais, quand on fait la même route, on repasse régulièrement dans les mêmes ports, alors on retrouve les mêmes claques, les mêmes putains, les mêmes clients. On prend des nouvelles d’un tel ou d’un tel qui sont passés la semaine précédente ; on boit des petits verres, on joue aux cartes — ce n’est pas juste tirer un coup. C’est du temps libre.
J’avoue que dans ma solitude miséreuse, j’ai rêvé en l’écoutant d’avoir mes habitudes dans un boxon amical, où des filles m’aimeraient et une mère maquerelle au grand cœur prendrait soin de moi — puis je repensais à Zahra, la petite pute de Tanger que je n’avais pas osé toucher, et ces rêves s’évanouissaient, comme tous les autres. Il ne doit pas y avoir plus d’amour dans les bordels que de poils au con d’une putain marocaine.
Читать дальше