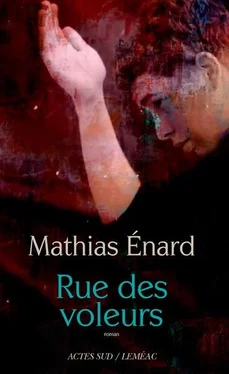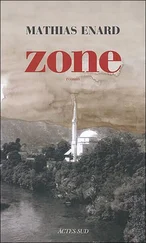Puis je retrouvais l’ Ibn Batouta , il y avait toujours une corvée à effectuer, ménage, lavage de pont, lessive, épluchage de patates ; on ne repeignait pas encore la coque, comme disait le capitaine, mais on s’emmerdait tellement ferme que si une bonne âme nous avait donné de la peinture, je crois qu’on s’y serait mis. Je découvrais la vie à bord — à quai, plutôt.
La plaie de la marine, c’est les cafards. Ce sont les vrais propriétaires du bateau. Il y en a partout, par milliers, à tous les étages ; ils sortent la nuit, à tel point qu’il ne vaut mieux pas se réveiller à trois heures du matin et allumer la lumière : on en découvre toujours trois ou quatre, un ou deux sur sa couverture, un sur le mur et un tranquillement installé sur le front de son voisin, sur la couchette d’en face, et on imagine qu’ils agissent de même avec vous lorsque vous dormez, qu’ils se promènent doucement sur vos paupières closes, ce qui me terrifiait au début, me faisait frémir d’horreur — au bout du compte on s’habitue. Les blattes viennent des ponts inférieurs, de la chaleur des machines ; c’est là qu’elles sont le plus nombreuses, et les diésélistes vivent avec elles. J’ignore de quoi elles peuvent bien se nourrir, je suppose qu’elles se servent dans nos réserves et bouffent dans nos assiettes. Toute tentative d’éradication est paraît-il vouée à l’échec : dès qu’un bateau est contaminé par le cafard, c’est foutu, il n’y a rien à faire. On avait beau lessiver le pont et les coursives à la Javel et poser des pièges dans nos cabines, on en retrouvait toujours. Saadi me racontait qu’on pouvait les apprivoiser, un peu comme des oiseaux. Il avouait qu’autrefois, la nuit, sur son cargo, pendant les longues heures de son quart, il leur parlait.
Saadi m’avait pour ainsi dire adopté : nous partagions une cabine, et dans le long ennui des soirées à bord, sa compagnie était magique. Il était diéséliste ; c’était lui qui bichonnait les deux moteurs Crossley du bord. L’écouter, c’était comme parcourir un livre infini dont on ne se lasserait jamais, car son contenu était vaste et chaque fois légèrement différent. Il me parlait des mers du Sud, des îles Sous-le-Vent, qui sont, que Dieu me pardonne, disait-il, la version terrestre du Paradis — les hommes qui les ont vues gardent toujours dans leur cœur cette blessure et n’ont de cesse d’y retourner. Il connaissait aussi les grands ports de la mer de Chine, Hong Kong, Macao, Manille. Singapour est la cité la plus propre du monde ; Bangkok la plus bruyante, la plus troublante aussi. Il me racontait l’alignement interminable des bordels et des boîtes à strip-tease de Patpong, où vont les Américains par centaines ; beaucoup font le voyage exprès, à croire qu’il n’y a pas de putains aux États-Unis.
Il avait vu Célèbes à la forme d’un chat, Java et Bornéo, la longue Malaisie et le détroit de Malacca, où les bateaux sont si nombreux qu’ils y font la queue comme des voitures dans un embouteillage.
Il me parlait des vaches de Bombay, que n’importe qui peut traire dans la rue pour mettre du lait directement dans sa tasse de thé et du port de Karachi, la ville la plus dangereuse de la planète, disait-il, tu n’y survivrais pas une journée. C’est le royaume de la contrebande, de la drogue, des armes. La douane n’existe pas, là-bas. Tout se paye en bouteilles de whisky. Les putains de Karachi sont si maltraitées qu’elles ont toutes des cicatrices, des bleus, des brûlures de cigarettes.
Saadi avait traversé je ne sais combien de fois le canal de Suez, franchi l’équateur pour se rendre au Brésil, en Argentine, en Afrique du Sud. Il avait vu des tempêtes si violentes qu’un immense cargo pouvait y danser comme une barcasse de pêcheurs et où tout le monde était malade, tout le monde, même le pilote qui barrait avec un seau à portée de bouche pour pouvoir dégobiller sans lâcher les commandes ; il avait vu des marins mourir en mer, tomber à l’eau et disparaître dans l’immensité tourbillonnante ou bien crever d’une fièvre, d’une subite tristesse sans qu’on puisse rejoindre à temps la terre ferme pour les soigner : on balançait alors le corps à la flotte, ou on pliait le cadavre pour le tasser dans un congélateur, selon le bon vouloir du capitaine ; il avait vu des marins ivrognes qui ne pouvaient naviguer que la bouteille à la main, des matelots se battre à coups de couteau pour une fille ou un mot de travers et même des pirates, dans le golfe d’Aden, arraisonner son navire puis l’abandonner après une bataille rangée contre une frégate militaire, alors que tout l’équipage était enfermé à fond de cale. Mais étrangement, les endroits dont il parlait avec le plus d’émotion, c’était Anvers, Rotterdam et Hambourg, il aimait les ports du Nord, immenses, actifs, sérieux, qui jouxtaient de grandes villes où il y avait tout le confort moderne, le métro, des bordels de grand luxe, des vitrines, des supermarchés, des bars de toutes catégories, où la bière était bon marché et où l’on pouvait se promener sans craindre un coup de couteau dans le dos comme à Karachi.
Imagine des dizaines de kilomètres de docks, disait-il, des bassins de plus de vingt mètres de profondeur où les plus grands bateaux du monde peuvent accoster — des bateaux de haute mer, qui ne voient normalement jamais aucun port : avec nos conteneurs, nous on avait l’air d’être des barques, des plaisanciers à côté de ces mastodontes quand on les croisait dans les chenaux. Et les villes, ah fils, malheureusement on ne restait jamais bien longtemps, mais tu n’as jamais vu autant de tours, d’édifices de toutes sortes, de toutes les couleurs comme à Rotterdam, par exemple. Jamais vu autant d’immigrants, de toutes les nationalités possibles. C’est bien simple, je ne suis pas sûr d’avoir croisé plus d’un ou deux Hollandais. Il y avait un bordel rempli uniquement de Thaïlandaises, par exemple. J’ai même appris récemment que le maire de Rotterdam est marocain. C’est pour te dire à quel point ils respectent les étrangers, là-haut. Un peu comme dans le Golfe, j’ai dit. Ça l’a fait marrer. Petit con. Je vois que tu m’écoutes : Rotterdam et Doha, rien à voir, imbécile ! Et Hambourg ! À Hambourg il y a des supermarchés à putes et des lacs au milieu de la ville. À Anvers, dans le centre, tu as l’impression d’être au Moyen Âge. Mais pas un Moyen Âge crasseux comme la Médina de Marrakech ou de Tanger, non, un Moyen Âge élégant, ordonné, avec des places magnifiques et des bâtiments à couper le souffle.
— Alors ce serait plutôt la Renaissance, j’ai dit, pour faire le malin, pour montrer que moi aussi je connaissais des choses.
— Qu’est-ce que ça peut foutre ? Je t’assure que tu n’as jamais vu des ports comme Anvers, Rotterdam et Hambourg. Rotterdam a été complètement détruite pendant la guerre et regarde-la aujourd’hui. Chez nous, il faut deux ans pour reboucher un trou dans une avenue, imagine le nombre de siècles nécessaires pour reconstruire Tanger si jamais elle était bombardée, à Dieu ne plaise.
Saadi avait passé trente années en mer, sur une dizaine de bâtiments différents, et depuis quatre ans, il arpentait le Détroit à bord de l’ Ibn Batouta . Saadi était divorcé et remarié avec une toute jeune femme qui venait de lui donner un fils dont il était très fier.
— C’est pour ça que tu n’es pas resté quelque part en Europe ? À cause de la famille ?
— Non, fils, non. C’est parce que quand tu passes des mois et des mois sur une barcasse d’acier, tu n’aspires qu’à retrouver ton fauteuil, ton chez-toi. L’Europe c’est bien, c’est beau, c’est agréable d’y être en escale. Mais Tanger, ce n’est pas pareil, c’est ma ville.
Читать дальше