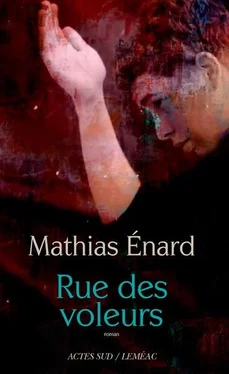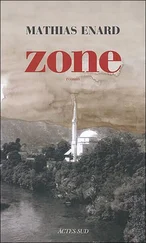Tous les Tangérois connaissaient la Comarit, une compagnie de navigation, parce que son nom était écrit en grand sur les ferries qui entraient au port en provenance de Tarifa ou d’Algésiras. Je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire sur un ferry, je n’avais aucune connaissance de la mer, mais cette conversation m’a redonné espoir. Parler franchement avec M. Bourrelier m’avait fait réaliser qui j’étais : un jeune Marocain de Tanger de vingt ans qui ne désirait que la liberté. J’ai écrit longuement à Judit pour lui raconter cette histoire et les possibilités qui allaient avec, elle m’a répondu presque immédiatement Siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ; j’ai senti mon cœur briller.
Cette nuit-là, j’ai été rattrapé par mes cauchemars. J’ai rêvé que je giflais Judit, très fort, que je la battais parce qu’elle était jalouse de Meryem ; je la frappais de toutes mes forces, et elle criait, elle hurlait en se débattant entre deux coups, mais ne s’enfuyait pas — au bout d’un moment je rejoignais Meryem dans sa chambre, je commençais à la caresser, à la déshabiller, je mettais ma main entre ses jambes, c’était tiède, alors je me retournais vers un vieux Cheikh qui était là à côté du lit, et il me disait c’est normal Lakhdar, la mort réchauffe les cadavres au bout d’un certain temps, c’est comme ça, et je disais à mon tour c’est ennuyeux tout ce sang qui sort de là, et il me répondait mais c’est de toi qu’il provient, ce sang, et j’ai regardé ma verge, un liquide rouge s’écoulait de l’urètre, sans discontinuer : plus je m’excitais au contact du corps brûlant de Meryem, au contact de sa dépouille rendue incandescente par la longue mort, plus le sang jaillissait ; j’ai pénétré Meryem, mon sexe se consumait dans le sien ; elle avait toujours les yeux clos. Judit avait remplacé le Cheikh sur le côté du lit : elle disait oui, oui, comme ça, c’est bien, tu vois, tu la remplis, c’est bon, regarde, et effectivement le sang sortait des lèvres immobiles de Meryem, débordait par ses narines sur ses dents blanches, j’étais effrayé mais je ne pouvais pas m’arrêter, j’allais et venais en elle dans une tiédeur collante.
Je me suis réveillé le bas-ventre poisseux de semence, le cœur à cent à l’heure.
Je me suis dit que j’étais fou, atteint d’une terrible maladie mentale ; je me suis recroquevillé dans la nuit comme un clébard, en gémissant d’angoisse.
Pour toute trace matérielle de mon enfance, il me reste les deux photos que j’ai toujours gardées dans mon portefeuille, une de Meryem petite, en vacances au village, assise contre un arbre, et une autre de ma mère avec ma petite sœur Nour dans ses bras. Rien de plus. Je me suis longtemps demandé ce qui se serait produit si, au lieu de fuir toujours plus loin, au lieu d’essayer d’échapper aux conséquences de mes actes j’étais retourné chez mes parents, si j’avais insisté, si j’avais essayé de m’imposer coûte que coûte, de faire pénitence, d’accepter tous les châtiments, toutes les humiliations, je me suis longtemps demandé s’ils auraient fini par me reprendre, si j’aurais pu retrouver une place auprès d’eux. Très certainement la question ne se pose pas, il faut accepter les voyages, qui sont l’autre nom du Destin. Comme ces soldats de 1914, partis de leurs villages ou de leurs douars sans savoir ce qui les attendait, le 21 septembre 2011 je grimpais sur le ferry Ibn Batouta de la compagnie Comanav-Comarit au port de Tanger Méditerranée pour ma première traversée du Détroit en direction d’Algésiras, en tant que serveur au bar et homme à tout faire, enfin surtout homme à tout faire. Mousse, quoi. Le nom du navire, Ibn Batouta , me semblait un Signe, un bon présage. L’équipage regardait d’un drôle d’œil ce pistonné qui n’avait jamais mis un pied sur l’eau, mais bon, pensais-je, le tout serait de se faire accepter petit à petit. J’essayais d’être serviable et de répondre avec gentillesse aux regards de mépris, ce qui risquait de me faire passer pour un faible ou un imbécile mais qu’à cela ne tienne, j’étais sur la mer, en route pour l’Espagne. Évidemment, je n’avais pas de visa pour sortir du port d’Algésiras ; pour le moment je devais faire des allers-retours, des ronds dans le Détroit, mais qui finiraient bien par me permettre de débarquer un jour ou l’autre.
Je n’avais pas de plan.
L’ami de Jean-François avait accepté de m’embaucher pour un salaire de misère, qui payait tout juste mon loyer à Tanger, mais ne t’inquiète pas, disait-il, il y a les pourboires, les primes, les extras. M. Bourrelier avait été désolé de me laisser partir, il restait encore des kilomètres de crevés auxquels donner une existence informatique et de livres qui attendaient une nouvelle vie électronique, mais au fond il était content pour moi, je crois. Alors, bon vent, il m’a dit en me tendant la main, et surtout n’oublie pas, si tu veux revenir tu seras le bienvenu.
L’ Ibn Batouta n’était pas le Pequod , pas un seul mât, pas d’huile de baleine : c’était un vieux bâtiment britannique de cent trente mètres de long construit en 1981, qui pouvait transporter mille passagers et deux cent cinquante bagnoles à dix-neuf nœuds, malgré le bon mètre d’épaisseur des différentes couches de peinture qui devait bien finir par l’alourdir un peu, à force. Il fallait entre une heure et demie et deux heures pour rejoindre l’Andalousie, nous faisions deux rotations par jour ; soit je commençais à aider à l’embarquement des camions et des voitures à six heures du matin pour rentrer à dix-huit heures, soit à onze heures du matin, auquel cas j’étais à la maison à vingt-trois heures.
Je me souviendrai de ma première traversée. La mer, je l’avais vue tous les jours depuis ma naissance : ces ferries, je les avais observés des heures durant traverser le Détroit, et maintenant j’étais à bord de l’un d’entre eux. On était en septembre, la saison de la migration vers le nord n’était pas encore terminée, le bateau était rempli de Marocains qui rentraient chez eux, en Espagne, en France ou en Allemagne. Des caisses chargées à bloc, des remorques, des familles entières (grand-père — grand-mère — père — mère — fils — fille et même parfois oncle — tante — cousins) s’entassaient souvent dans deux ou même trois voitures, en convoi, et leur désir de rentrer paraissait inversement proportionnel à leur âge : les jeunes étaient aussi impatients que les vieux soupiraient. La traversée était pour tous ces gens une petite récréation avant la longue route qui les attendait, douze, vingt voire trente heures de bagnole.
C’était mon premier jour et je ne savais rien faire ; j’étais censé aider aux manœuvres des véhicules, mais comme je ne savais pas guider les conducteurs pour se garer le responsable du chargement m’a vite viré en me disant d’aller me faire pendre ailleurs, et même plus vulgairement que ça, alors je suis monté sur le pont supérieur, là où se trouve la cafétéria, et j’ai aidé le barman à ranger quelques caisses de Pepsi dans des frigos, jusqu’à ce qu’il me dise à son tour d’aller me faire mettre parce que j’ai cassé une bouteille par maladresse. Je suis allé m’accouder au bastingage en attendant l’appareillage. Le pont sentait un mélange de marée et de gasoil, le métal vibrait doucement sous mes bras, au rythme des diesels ; la file de voitures et de camions diminuait, ils disparaissaient dans le ventre du ferry, c’était merveille que de voir la quantité de matière, inerte et vivante, que pouvait transporter la gigantesque bestiole sur laquelle nous nous trouvions. L’officier qui m’avait accueilli avait une quarantaine d’années, il m’avait souhaité la bienvenue à bord, c’était le second du bâtiment — j’ignorais absolument tout des bateaux, c’en était comique. Surtout les noms des choses. La marine, c’est avant tout du vocabulaire. Proue, poupe, bâbord, tribord. J’ai pris plus de coups de pied au cul, propres et figurés, pendant ces quatre mois que toute ma vie durant. Mais j’ai fini par apprendre, un peu du moins ; j’ai su faire garer les véhicules comme des sardines dans une boîte ; j’ai su m’orienter dans l’immense rafiot, des machines jusqu’à la passerelle, et surtout j’ai su petit à petit me faire, sinon apprécier, du moins accepter par les marins.
Читать дальше