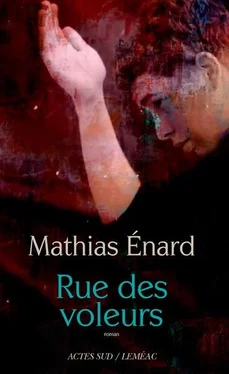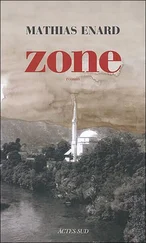Je m’étais donc démené pour trouver deux chambres côte à côte dans un petit hôtel — la loi marocaine, championne des bonnes mœurs, nous interdisant de prendre une seule chambre sans être mariés. Nos balcons communiquaient, et nous n’étions même pas obligés de passer par le couloir pour nous retrouver. C’était assez amusant, ça avait un côté aventuriers. Mais j’avais tout de même un peu honte, lorsque Judit me demandait pourquoi nous ne pouvions pas avoir une chambre double, de lui répondre que c’était parce que j’étais marocain : si j’avais été étranger, personne ne nous aurait emmerdés.
Nous n’étions pas beaucoup sortis de l’hôtel pendant ces trois jours, à part pour quelques excursions, cap Spartel, grottes d’Hercule, musée de la Casbah et au cimetière de Marshan pour voir la tombe de Choukri ; les remarques des garçons de café, des employés de musée ou même des passants, quand ils me voyaient seul avec Judit, ne m’encourageaient pas à sortir : c’était agréable comme un coup de pied au cul, ce mélange de mépris, de jalousie et de vulgarité crasse qui me donnait envie de répondre en levant le majeur avec une phrase bien sentie sur les sœurs ou les mères des intéressés. Me promener avec Judit c’était recevoir, à chaque coin de rue, une sérieuse quantité de mollards symboliques, parce que j’étais jeune, marocain et que je déambulais en compagnie d’une Européenne sans appartenir, apparemment, à la classe sociale qui fréquentait les plages privées ou les bars des palaces et qui, elle, pouvait tout se permettre. Judit elle-même s’en rendait compte, et je sentais qu’elle était désolée pour moi, ce qui m’attristait encore plus. Même sur la tombe de Choukri, un crétin de mon âge est venu nous emmerder ; il m’a demandé en arabe ce qu’on faisait là, ce qui est tout de même une drôle de question à poser dans un cimetière — je lui ai répondu on vient se faire enterrer, bien sûr, alors que j’avais envie de lui dire “On vient à ton enterrement, connard”, mais je n’ai pas osé. Après tout, il était peut-être sincère, il cherchait peut-être à nous aider.
J’étais devenu un peu sauvage, en fait, je crois. Enfermé dans mes livres, dans la solitude, en tête à tête avec Judit, je n’avais plus de contact avec le monde extérieur, à part avec mes trois colocataires, qu’on ne pouvait pas vraiment appeler “monde extérieur”.
Entre-temps, j’avais lu Le Pain nu , et même la suite, Le Temps des erreurs ; j’avais été obligé de m’excuser auprès de Judit : ce Choukri était hors du commun. Son arabe était sec comme les coups de trique qu’il recevait de son père, dur comme la famine. Une langue nouvelle, une façon d’écrire qui me paraissait révolutionnaire. Il n’avait pas peur, il racontait sans rien dissimuler, ni le sexe, ni la violence, ni la misère. Ses errances me rappelaient mes mois de vagabondage, par moments ; la sensation était si forte qu’il me fallait fermer le livre, comme on s’éloigne d’un miroir dont le reflet ne vous convient pas. Judit était contente que je me sois rendu à l’évidence ; elle me racontait l’histoire unique du texte du Pain nu : publié d’abord en traduction, interdit au Maroc en arabe pendant près de vingt ans. Il n’était pas difficile d’imaginer pourquoi : la misère, le sexe et la drogue, voilà qui ne devait pas être du goût des censeurs de l’époque. L’avantage, c’est qu’aujourd’hui les livres ont si peu de poids, sont si peu vendus, si peu lus que ce n’est même plus la peine de les interdire. Et Choukri a été enterré en grande pompe, avec ministres et représentants du Palais, à Tanger il y a une vingtaine d’années — comme si tous ces notables fêtaient sa mort en l’accompagnant dans la tombe.
Le départ de Judit, après nos trois jours et trois nuits, m’avait plongé dans la tristesse et la solitude ; je les combattais comme d’habitude, par le travail, la lecture jusqu’à en avoir les yeux brûlants de fièvre, et la poésie amoureuse. Je pensais aux quarante-cinq jours qui me séparaient de mon voyage. Je regardais des pages et des pages d’information sur la Tunisie, sur la Révolution. Ibn Batouta consacrait seulement quelques lignes à Tunis, où il y avait, disait-il, de nombreux Ulémas d’importance ; il s’y trouvait au moment de la fin du Ramadan, et participa à la fête. J’y serais moi-même juste avant le début du jeûne, ce qui me donnait à peine un mois de décalage sur mon illustre prédécesseur.
Comme un fait exprès, un nouveau coup du sort, j’ai reçu le premier mail de Bassam deux jours avant de prendre l’avion. J’avoue que je pensais un peu moins souvent à lui et au Cheikh Nouredine, que je n’étais pas retourné dans le quartier depuis l’incendie du Groupe pour la Diffusion de la Pensée coranique, que je vivais un peu comme en exil et un matin, en jetant un coup d’œil comme toujours dès le lever à ma boîte aux lettres, pour voir si j’avais déjà la réponse de Judit à ma missive de la veille, j’ai remarqué un message bizarre, que j’ai tout d’abord pris pour un de ces courriers vous proposant d’allonger de cinq centimètres votre virilité sans effort, ou d’acheter à bon prix du Viagra pour la renforcer, dont l’expéditeur avait pour nom “Cheryl Bang” ou un truc du genre. Ce qui m’a intrigué c’est le sujet du courriel : Nouvelles , et je l’ai ouvert — c’était un texte de trois lignes seulement :
Mon très cher frère, comment ça va pour toi ? Ici je suis loin et c’est difficile mais In cha’ Allah on se retrouvera bientôt sur cette terre ou au Paradis. Prends soin de toi khouya , pense à moi et tout ira bien.
Ce n’était pas signé, et je me suis demandé pendant un moment si ce n’était pas un spam, mais je ne sais pas, j’avais l’impression d’entendre Bassam dans ces lignes, j’étais sûr que c’était lui. Pourquoi un message pareil ? Pour me rassurer ? Il était loin, c’était difficile, où est-ce qu’il avait bien pu aller se fourrer ? En Afghanistan ? Au Mali ? Non, il n’y avait sans doute pas Internet, là-bas. Qui sait peut-être les combattants d’AQMI avaient-ils le wifi dans leurs tentes. Ou alors il m’écrivait depuis une prison secrète. Ou peut-être tout simplement que ces quelques mots n’étaient pas de lui, mais générés automatiquement par une machine, et je me trompais complètement.
J’avoue que j’ai hésité à répondre à cette Cheryl ; je ne l’ai pas fait. J’avais peur ; après tout, s’il m’avait écrit depuis cette boîte bizarre et sans signer son message ce n’était sans doute pas pour rien. Je l’ai imaginé dans son Pays de Ténèbres, avec le Khidr qui portait ses messages jusqu’à moi, ce Pays de Ténèbres où il maniait le sabre, le fusil ou la bombe, enhardi par la prière, avec d’autres combattants, comme lui, le front ceint d’un bandeau, tels qu’on les voit dans les vidéos sur Internet. Mais c’était sans doute bien différent, les montagnes désertiques d’Afghanistan ou les coins les plus perdus du Sahara.
Prends soin de toi, khouya , pense à moi et tout ira bien , c’est cette phrase en tête que je suis parti pour Tunis.
Je n’ai rien raconté à Judit.
Je lui avais pourtant tout expliqué, dans la nuit, dans les premières nuits, Meryem, Bassam, le Cheikh Nouredine, mes mois d’errance, les bastonneurs de libraires et elle avait eu pitié de moi, elle m’avait caressé dans le noir comme on pose le baume magique d’un baiser sur les douleurs d’un enfant qui pleure ; je lui avais confié mes craintes pour l’attentat de Marrakech, elle m’avait avoué qu’elle y avait pensé, elle aussi, quand elle s’était retrouvée nez à nez avec Bassam en sortant de son hôtel. Au départ, disait-elle, j’ai cru qu’il était avec toi, que tu m’avais fait cette surprise, de venir jusqu’à Marrakech avec lui. Et puis j’ai eu un peu peur, il m’a fait peur, il avait l’air extraordinairement nerveux, disait-elle, fébrile, comme s’il était malade. Il regardait tout le temps autour de lui. Je me suis longtemps demandé, ajoutait-elle, si nous avions évoqué le nom de cet hôtel lors de nos conversations à Tanger. C’est possible, mais je ne m’en souviens pas. Tout ça est assez effrayant.
Читать дальше