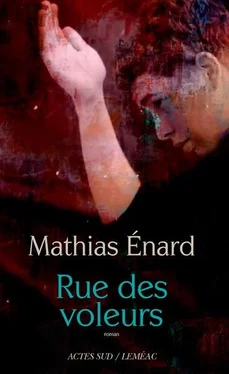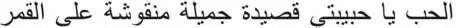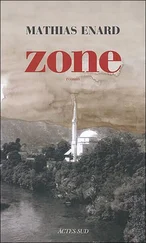M. Bourrelier était plutôt sympathique avec moi ; il me disait souvent ah, désolé, toujours pas de polars à l’horizon, mais si jamais il y en a, je te jure qu’ils seront pour toi. J’étais plutôt un bon élément, je crois, j’essayais d’être sérieux et je n’avais pas grand-chose d’autre à faire.
Un jour, mon zèle m’a valu un cadeau empoisonné : en arrivant un matin, M. Bourrelier m’a convoqué dans son bureau. Il était joyeux, il rigolait comme un enfant, je viens d’avoir une excellente nouvelle, il m’a dit. Une magnifique nouvelle. Une très grosse commande du ministère des Anciens Combattants. Il s’agit de la numérisation des fiches individuelles des combattants de la Première Guerre mondiale. C’est un très gros contrat. Nous avons répondu à l’appel d’offres, et nous avons été retenus. Ce sont des fiches manuscrites, impossibles à traiter automatiquement, il va falloir les saisir à la main. On commence par les morts.
— Ils ne sont pas encore tous morts ? j’ai dit naïvement.
— Si si, bien sûr qu’ils sont tous morts, il n’y a plus de combattant de la Première Guerre mondiale français vivant. Je veux dire qu’on va commencer par les “Morts pour la France”, qui sont un lot de fiches à part.
— Et combien il y en a ?
— Un million trois cent mille fiches, au total. Après il restera les blessés et ceux qui s’en sont tirés, ce sera plus gai.
Un million trois cent mille putain de morts, on ne se rend pas bien compte de ce que ça représente, mais je peux vous assurer que ça fait du boulot pour la saisie au kilomètre. Des gigaoctets et des gigaoctets de fiches scannées, un programme spécial pour rentrer les données, nom, prénom, date et lieu de naissance, matricule, date lieu et genre de mort, tel quel, genre de mort , ils ne s’embarrassaient pas de fioritures, à l’époque, pensez-vous, ils en avaient des centaines de milliers, de fiches à remplir. Le tout manuscrit, d’une belle calligraphie à la plume : Achille Brun, soldat, 138 erégiment d’infanterie, Mort pour la France le 3 décembre 1914 à l’hôpital de Châlons-sur-Marne, Genre de mort : blessure de guerre (raturé) fièvre typhoïde (rajouté), né le 25 janvier 1891 à Montbron en Charente ; Ben Moulloub, Belkacem ben Mohammad ben Oumar, deuxième classe, 2 erégiment de tirailleurs algériens, Mort pour la France le 6 novembre 1914 à Soupir, dans l’Aisne, Genre de mort : tué à l’ennemi, né en 1884 à (illisible), département de Constantine, et ainsi de suite un million trois cent mille fois, même avec le programme spécial il fallait bien une ou deux minutes par fiche, surtout pour déchiffrer les noms de bleds inconnus, les douars algériens, les villages sénégalais, les hameaux français dont j’ignorais tout ; certains des soldats me sont restés en mémoire, comme cet Achille Brun et ce Belkacem ben Moulloub, et il était étrange de penser que ces fantômes de Poilus faisaient un voyage posthume au Maroc, à Tanger, dans mon ordinateur.
Nous nous répartissions le travail, mes collègues (des étudiantes de littérature française ou de jeunes dactylos pour la plupart) et moi : cent cinquante ou deux cents fiches le matin, et soixante pages de livres minimum l’après-midi. Le problème était qu’on ne pouvait pas abandonner un chantier pour l’autre ; tout devait se faire en même temps : recopier les Mémoires de Casanova pour une maison d’édition québécoise était au moins aussi urgent que les Tués à l’ennemi. Les volumes de l’ Histoire de ma vie étaient immenses, interminables. J’avoue avoir pris un grand plaisir, malgré les nuits blanches, à les saisir kilométriquement. Ce Casanova était drôle et sympathique, courtois, roublard ; il passait son temps à se réveiller avec le sexe en feu, et donc à courir soigner ses maladies vénériennes, qui semblaient ne lui procurer aucune honte ; pour lui, le corps, les femmes et la jeunesse n’avaient rien de honteux. Il y avait chez lui une intelligence ironique qui me rappelait Isâ ibn Hishâm et Abû al-Fath al-Iskandarî, les héros de Hamadânî — en plus long, c’est certain. C’est un des rares livres que j’aie vraiment lu en le recopiant : plus de trois mois de travail, sans chômer.
Je me suis toujours demandé combien Jean-François Bourrelier facturait nos services, et donc quel était son bénéfice ; je n’ai jamais osé lui poser la question. Ce qui est sûr, c’est que les Tués à l’ennemi ou M. Casanova ne touchaient pas un centime, et que moi-même, une fois les comptes apurés (retenues pour corrections, etc.), j’arrivais rarement à percevoir plus de cinq cents euros par mois, pour soixante heures de travail minimum, ce qui était un salaire extraordinaire pour un jeune plouc comme moi, mais loin des dizaines de milliers de dirhams promis. Quand venait le jour de la paye, M. Frédéric avait toujours un petit air désolé, il disait ah, il y a eu beaucoup de corrections, ou alors bon, ce mois-ci ce n’est pas terrible, mais tu feras mieux le mois prochain, il faut t’habituer à ces fiches de soldats morts et accélérer la cadence.
Je racontais toutes mes histoires à Judit dans des lettres interminables, c’était ma récréation, chaque soir, alors que j’aurais dû haïr l’ordinateur et surtout son clavier j’écrivais longuement à Judit pour lui expliquer ce que nous avions fait dans la journée, Casanova, les Poilus et moi ; je lui parlais d’Achille Brun le typhoïdeux et de Belkacem ben Moulloub mort à Soupir, de Casanova et Tireta assistant à une exécution capitale place de Grève depuis une fenêtre, en compagnie de deux dames, sans aller jusqu’à oser lui raconter les détails scabreux mais hilarants de l’erreur de tir de Tireta.
J’ai commencé à lui écrire aussi des poèmes, pour la plupart en français et volés à Nizar Kabbani ; la poésie française ou espagnole me paraissait sèche et peu fleurie. Je terminais toujours mes missives par un vers,
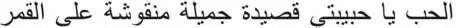
L’amour, mon amour, est un beau poème brodé sur la lune ,
et ainsi de suite. Judit était plus discrète sur ses sentiments mais je sentais, dans ses mails parfois en français, parfois en arabe, qu’elle appréciait notre correspondance ; elle me racontait sa vie à Barcelone, son quotidien, ses énervements contre la nullité de ses cours, son ennui à l’université, où les professeurs eux-mêmes paraissaient mépriser les textes qu’ils enseignaient comme du mauvais latin. À travers elle, je commençais à haïr ces arabisants souffreteux en short colonial qui regrettaient chaque jour que l’Espagne ait quelques siècles été arabe, en soupirant sur des textes andalous dont ils ne percevaient que la difficulté lexicale. Elle me disait tiens, nous étudions tel poème d’Ibn Zaydûn, tel fragment d’Ibn Hazm qu’ils appelaient Abenházam, et je me précipitais dans une librairie pour trouver le livre en question ; la plupart du temps c’était pour moi une merveille, un joyau d’un autre temps dont l’arabe me remplissait la bouche et les tympans d’un plaisir inouï. Malgré les Poilus morts et Casanova, je me sentais très arabe grâce à Judit ; je suivais ses études au jour le jour : elle me posait des questions de grammaire, j’ouvrais les grammairiens et les commentateurs classiques pour lui trouver une réponse ; elle entendait parler d’un auteur et je lui livrais dès le lendemain une fiche documentée avec extraits et exégèses.
Bien évidemment, ces activités étaient incompatibles avec le mode de vie de mes colocataires, dégottés par une espèce de solidarité des entreprises françaises, qui essayaient tant que faire se pouvait de faciliter l’obtention d’un logement à leur personnel ; Adel, Yacine et Walid venaient tous les trois de Casablanca, ils étaient “techniciens supérieurs” et travaillaient dans une usine de pièces détachées automobiles, à la chaîne. Ils me voyaient chaque soir plongé dans mes fiches de soldats morts ou dans mes livres, et me prenaient pour un fou. Parfois ils me criaient Lakhdar khouya , tu vas te rendre sourd et aveugle, c’est pire que la masturbation tout ça, viens faire un tour au grand air, tu verras des filles ! Non non, lui il verra juste la mer, mais ça peut pas lui faire de mal ! Moulay Lakhdar, t’es pâle comme une culotte de prépubère, viens respirer le pot d’échappement de notre bagnole ! Et ils finissaient par partir, l’oreillette à l’oreille, vers Tanger et ses délices, tourner en voiture la musique à fond pendant des heures pour finir par bouffer un hamburger vers minuit, rentrer excités comme des puces et se vautrer devant la télé en fumant joint sur joint avant de retourner à l’usine le lendemain.
Читать дальше