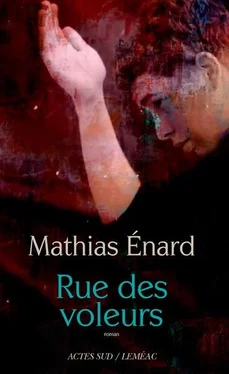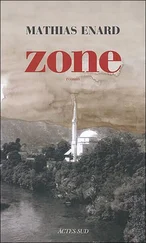Judit aurait préféré que je lui écrive des poèmes en arabe, après tout c’est ta langue, disait-elle, c’est celle que tu connais le mieux, et elle avait raison bien sûr, mais je n’y arrivais pas : la poésie arabe, c’est infiniment plus beau et plus complexe que les vers français ; en arabe, j’avais l’impression d’écrire du sous-Kabbani, du sous-Sayyâb, du sous-sous-Ibn Zaydûn ; alors qu’en français, comme je n’avais rien lu, aucun poète ou presque, à part Maurice Carême et Jacques Prévert à l’école, je me sentais bien plus libre. L’idéal aurait été d’écrire en espagnol, c’est certain : je me voyais bien composer un recueil intitulé El libro de Judit , mais ce n’était pas pour demain.
Pour changer un peu d’air, chaque samedi j’allais en ville, le matin à la bibliothèque du centre Cervantès et l’après-midi à celle de l’Institut français, ou l’inverse, et entre les deux, je traînais dans les cafés, à observer les gens. Je ne me sentais pas seul, j’avais juste l’impression de ne plus appartenir à la ville, que Tanger me quittait, s’en allait. Elle était sur le départ. Judit me donnait de l’espoir. Je pressentais que j’allais quitter le Maroc, que j’allais devenir autre, laisser derrière moi une partie du malheur et de la misère passée, oublier les bombes, les sabres, mes morts ; oublier les fantômes des soldats tués à l’ennemi, les heures et les heures passées à recopier, à l’infini, des noms sans chair et enfin débarquer, pensais-je, dans un pays qui ne soit rongé ni par le ressentiment, ni par la pauvreté, ni par la peur.
Le 2 mai, lendemain de la fête du Travail, Oussama ben Laden a été abattu dans la nuit par des commandos américains et son corps balancé depuis un avion dans l’océan Indien. La nouvelle était dans tous les journaux : l’homme maigre à la longue barbe et au regard envoûtant avait été écrasé comme un nuisible, au milieu de ses femmes et de ses médicaments, pris au piège de sa villa étrange, avec des remparts comme un château fort — c’est du moins ce que laissaient entendre les journalistes. Le terroriste le plus recherché du monde se trouvait à cinquante kilomètres d’Islamabad, et ce depuis des années, disait l’article. On se demandait pourquoi on l’avait buté aujourd’hui, et pas hier ou demain ; pourquoi on ne l’avait pas arrêté, pourquoi avoir jeté ses restes aux poissons. Ça n’avait pas vraiment d’importance, on sentait que Ben Laden avait perdu son corps, sa présence physique depuis longtemps — il était devenu une voix qui parlait de temps en temps depuis une grotte imaginaire, cachée au fin fond des siècles ; la réalité de son existence même paraissait de plus en plus douteuse et son immersion achevait de le transformer en un personnage, un démon ou un saint : celui qui pour moi, dans la confusion de l’enfance, inspirait à la fois horreur et admiration, espoir et effroi, celui qui avait victorieusement défié les États-Unis d’Amérique en semant la destruction devenait maintenant un mythe un peu dérangeant, un symbole boiteux, qui claudiquait entre la grandeur et la misère. Je me suis rappelé qu’à l’école, c’était un des héros de Bassam ; nous jouions dans la cour aux combattants afghans ; aujourd’hui Bassam avait disparu et Ben Laden avait rencontré son Destin sous la forme de Navy Seals capuchonnés de noir, des phoques , d’après leur nom, qui l’avaient entraîné dans les profondeurs de l’abîme. En soi, cela n’avait aucun sens, à part un adieu de plus au monde d’hier.
Lorsque Judit m’a appris qu’elle allait participer à un stage d’arabe à l’institut Bourguiba de Tunis tout le mois de juillet et qu’elle m’a proposé de la rejoindre, je me suis dit que ce serait un premier voyage, comme Ibn Batouta, quittant Tanger pour l’Est, s’arrêtait en Tunisie. J’avais aussi très envie de voir de mes yeux ce qu’était une révolution en cours ; il me semblait que j’avais l’âge de la Révolte et en vérité je me sentais bien plus proche d’un jeune Tunisien de vingt ans que de n’importe qui d’autre — j’imaginais que Tunis devait ressembler un peu à Tanger, que je ne m’y sentirais pas étranger, les Tunisiens étaient maghrébins, arabes et musulmans et de plus toute cette jeunesse, mes frères, mes cousins plutôt, avait réussi à se débarrasser du dictateur — la perspective de voir cela de près me réjouissait. J’ai donc couru négocier des vacances avec M. Bourrelier — j’imaginais naïvement qu’on devait avoir droit à un genre de congés, et effectivement, c’était bien le cas, mais il n’était possible de les prendre (sauf dans des cas précis liés à l’état civil, mariage, naissance, décès auxquels je ne pouvais prétendre) qu’après un an de travail. Jean-François était bien ennuyé. Il me disait qu’il ne pouvait pas faire une exception qui risquait de créer un précédent, mais en revanche, m’a-t-il dit, et juste pour une semaine, on peut s’arranger ; vous vous engagez à faire vos fiches et vos pages, et nous fermons les yeux sur votre obligation de présence pendant cinq jours. Si jamais un de vos collègues pose la question, on dira que vous êtes malade et que vous travaillez de chez vous, et voilà. Mais surtout qu’il ne vous arrive rien là-bas et ne ratez pas l’avion du retour, hein, on serait obligé de vous virer.
Il allait donc me falloir voyager avec des Poilus morts et Casanova, drôle de compagnie, mais bon, Judit avait cours toute la journée, je travaillerais au même rythme qu’elle, voilà tout. Et une semaine, c’était mieux que rien. En plus, pour me rendre à Tunis, fraternité maghrébine oblige, je n’avais pas besoin de visa, juste d’un passeport, et le vendredi 15 juillet 2011, en fin d’après-midi, après avoir fait un trou quasi définitif dans mes économies, je prenais l’avion pour la première fois. L’aéroport Ibn Batouta jouxte la Zone Franche, j’y suis allé à pied en sortant du travail ; je m’étais bien habillé, j’avais mis une veste et une chemise malgré la chaleur ; peigné, les pompes cirées, un peu ému, je devais puer le néophyte aéroportuaire à plein nez. J’essayais de passer pour un habitué, comme si l’aéroport était une boîte de nuit ou un bar dont on pouvait vous refuser l’entrée, affichant un mépris lassé face aux formalités, au déshabillage obligatoire, l’angoisse au cœur — j’avais peur que quelque chose ne se passe mal, que le douanier, en tapant mon nom dans son ordinateur, ne m’apprenne que j’étais recherché par la police, que son écran ne se mette à clignoter, qu’une sirène ne retentisse et qu’une escouade de gros flics à casquettes grises ne me sautent sur le râble, mais non, rien de tout cela, on m’a rendu mon passeport sans presque me regarder et après une attente qui m’a paru très longue face aux baies vitrées qui donnaient sur la piste, je suis monté dans l’avion, pas mort de trouille, n’exagérons rien, mais pas rassuré tout de même ; j’ai vu, par le hublot, un type avec un casque sur les oreilles marcher aux côtés de l’avion qui reculait, comme s’il menait un chien en laisse, c’était tout à fait étrange ; j’ai été très surpris par le bruit des moteurs et la puissance de l’accélération quand l’Airbus a roulé sur la piste, en me disant que ce truc n’arriverait jamais à s’envoler, j’ai eu un léger haut-le-cœur quand il s’est finalement arraché du sol, et ressenti une grande exaltation lorsque, penché sur l’aile, pressé contre le hublot par l’angle du virage, Tanger et le Détroit sont apparus, sous moi, comme je ne les avais jamais vus.
Judit était revenue trois jours au début juin, trois jours de bonheur, d’entente parfaite et de plaisir qui m’avaient laissé triste et plus solitaire que jamais quand ils avaient pris fin et que j’étais rentré retrouver mes colocataires — je n’avais pas souhaité la recevoir chez moi, d’abord parce que je n’avais qu’un lit simple, ensuite parce que j’étais jaloux, je ne voulais pas qu’un autre Marocain l’approche, et surtout pas les trois énergumènes qui partageaient ma vie quotidienne. Rien que de les imaginer voir Judit en pyjama, l’espionner dans la salle de bains peut-être, me donnait des envies de meurtre. L’idée de ne pas être le seul, l’unique Arabe de Judit me rendait fou. Je savais qu’elle avait déjà eu des fiancés , comme elle disait, qu’elle avait des camarades d’université, des amis, bien sûr, mais ces Catalans étaient une catégorie à part dans ma tête. Moi j’étais autre chose. J’étais son Arabe. Je voulais être le seul Arabe dans la vie de Judit. (J’appréhendais donc, il faut le reconnaître, son séjour en Tunisie ; je l’imaginais être la cible des avances incessantes de hordes de jeunes Tunisiens frustrés ; j’étais bien placé pour savoir ce qu’ils pouvaient ressentir.)
Читать дальше