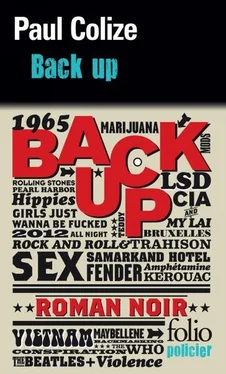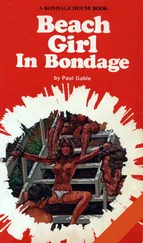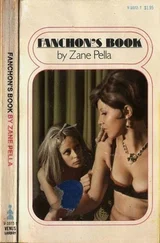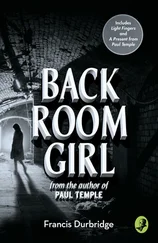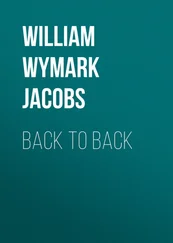La crise a duré deux semaines. Deux semaines durant lesquelles le monde a été au bord de la guerre nucléaire.
Quand Khrouchtchev a abandonné la partie, mon père a semblé plus dépité que rassuré. Bien vite, il a auguré que ce n’était que partie remise, que les Russes ne perdraient pas la face aussi facilement et qu’ils préparaient certainement un nouveau coup tordu.
Côté rock, c’était aussi la crise. Les prévisions de la disquaire étaient en passe de se réaliser.
Mes idoles avaient mal négocié leur entrée dans les années soixante. Buddy Holly et Eddy Cochran avaient rejoint le Paradis en emmenant avec eux Ritchie Valens, ce qui était plutôt une bonne chose, La Bamba était l’une des pires choses que j’aie entendue.
Little Richard était devenu mystique, Chuck Berry purgeait une peine de prison pour avoir eu les mains baladeuses sur une mineure et Jerry Lee Lewis était en disgrâce après qu’il avait épousé une gamine de treize ans.
Même si je l’avais voulu, je n’aurais pu reporter mon affection sur Elvis Presley, lui aussi acoquiné à une toute jeune fille. Il avait arrêté de chanter à la sortie de son service militaire pour se tourner vers Hollywood et se consacrer au cinéma.
Quelques mois auparavant, un ancien plumeur de poulets nommé Chubby Checker avait lancé la mode du twist. Le phénomène n’avait pas duré bien longtemps, mais l’espace d’une saison, tout le monde avait remué son derrière sur Let’s Twist Again.
C’est dans ce climat de déprime, comme un soleil inattendu qui pointe ses rayons après la tempête, que mon frère est rentré à la maison avec un 45 tours. C’était au début du mois de novembre. Il m’a adressé un clin d’œil, m’a montré le disque et m’a dit que ce truc-là allait faire un malheur.
J’étais dubitatif. J’ai d’abord pensé qu’il se moquait de moi. Nous ne partagions pas les mêmes goûts en matière musicale. Il était plutôt orienté chanson française et écoutait des âneries comme le Mexicain basané ou les rengaines pleurnichardes de Richard Anthony.
J’ai jeté un coup d’œil à la pochette. La chanson titre s’intitulait Love Me Do . Le groupe, inconnu, s’appelait The Beatles. Sur la photo, quatre types à l’air songeur posaient tels des quadruplés, deux assis, deux debout. Ils étaient vêtus du même costume gris souris et portaient une coupe de cheveux identique ; un montage capillaire qui ressemblait au balai à franges que ma mère utilisait pour laver le carrelage de la cuisine.
J’ai mis le disque sur le plateau, j’ai posé l’aiguille et les anges sont descendus du ciel.
C’était un rock, c’est sûr, mais pas un rock comme les autres. C’était un rock mélodique, énergique, d’une simplicité qui poussait au génie. Marqué par un harmonica lancinant et une surprenante complicité vocale, le morceau était d’une fraîcheur qui me laissait muet d’admiration. On sentait que les gars s’amusaient, qu’ils aimaient ce qu’ils faisaient et prenaient du plaisir.
La face B était tout aussi convaincante. J’ai écouté le disque de nombreuses fois, en cherchant à saisir la recette de ce tour de magie.
Dans un second temps, j’ai prêté une oreille plus attentive au jeu du batteur. Il s’appelait Ringo Starr. Je trouvais son jeu sobre, sans grande originalité, mais efficace. Pas de fioritures, mais une rythmique implacable et entraînante. Plus tard, je me suis laissé dire que ce n’était pas Ringo Starr, mais Pete Best qui était à la batterie lors de l’enregistrement.
Quand j’ai eu l’occasion de rencontrer Andy White à Londres, il m’a confié que c’était lui qui avait joué dans Love Me Do . Ringo Starr venait de remplacer Pete Best, mais le manager des Beatles ne l’aimait pas. Andy était batteur de session. Pour couper court à la polémique, c’est lui qui avait joué. Il n’a jamais touché un shilling pour son travail et a dû acheter son propre exemplaire du disque.
Mais ce jour-là, je m’en fichais, j’ignorais cette anecdote. Le rock de ma jeunesse venait de prendre un fameux coup de vieux et les Beatles étaient là pour dépoussiérer ma nostalgie. La musique pop était née et je me suis offert l’une des plus belles gueules de bois de ma vie.
Mi-décembre, peu avant les congés de Noël, l’école de filles qui se trouvait près de chez moi organisait sa fête annuelle. L’objectif était de récolter de l’argent de manière détournée en proposant une série de jeux et d’attractions allant du théâtre de marionnettes à la pêche aux canards.
Le samedi soir, ils organisaient une soirée dansante. Pour les jeunes mâles du quartier, c’était une formidable opportunité pour draguer. Un groupe de musiciens animait la soirée. Ils s’étaient baptisés The Drivers et avaient pour vocation de revisiter le répertoire des Shadows.
Comme tout un chacun, j’avais acheté Apache à sa sortie. Je reconnaissais un certain talent aux Shadows, surtout au sein des guitaristes, mais je réfutais l’étiquette de premier groupe européen de rock qu’on leur avait collée. Leurs compositions étaient pour la plupart instrumentales, mécaniques, exécutées sans émotion. Je trouvais leur manière de jouer pédante et académique. Je détestais leur ridicule jeu de scène, avec la façon militaire qu’ils avaient de pivoter le tronc d’un quart de tour en levant un pied de concert. Quand ils ne jouaient pas pour leur enseigne, ils accompagnaient Cliff Richard, un chanteur bien élevé et propre sur lui, trop mou à mon gré.
Les Drivers étaient des amateurs de mon âge qui ne se prenaient pas au sérieux. L’un des guitaristes, le soliste, était doué, mais pas bien secondé. Le bassiste, un grand échalas boutonneux, ne semblait pas à son affaire et le second guitariste, qui s’était affublé d’une grosse paire de lunettes sans verre pour parfaire la ressemblance avec son idole, tournait la plupart du temps le dos au public pour cacher ses hésitations.
Le batteur quant à lui était un fils à papa équipé d’une batterie Ludwig flambant neuve, mais dont il ne savait pas se servir. Ses breaks étaient basiques, ses roulements répétitifs et il abusait de la cymbale, apanage des piètres batteurs. Après une heure de jeu, il a commencé à peiner. Il ne parvenait pas à imprimer un tempo régulier et contrariait le déroulement du récital.
Il a demandé aux autres de faire une pause pour se reposer et se masser les poignets. Un quart d’heure plus tard, il a tenté de redémarrer, mais a rapidement dû déclarer forfait.
Après quelques apartés, un organisateur est venu au micro et a demandé s’il y avait un batteur dans l’assistance. Je trouvais cela amusant. Des doigts se sont levés. Je les cherchais vainement dans la foule. Ensuite, j’ai compris que j’étais la cible des index tendus.
Je suis devenu écarlate. J’ai fait non de la tête, mais les ados en mal d’ambiance ne l’entendaient pas de cette oreille. Ils m’ont conduit manu militari vers l’estrade qui servait de scène.
Le guitariste solo s’appelait Jean-Claude. Il s’est penché à mon oreille, m’a remercié, m’a dit qu’on allait jouer mollo.
On a commencé avec Blue Star , un morceau plutôt lent. Au début, mes mains tremblaient, je parvenais à peine à tenir les bâtons. Je faisais n’importe quoi, des trucs faciles, comme le fils à papa. Je transpirais par tous les pores de la peau. Petit à petit, j’ai trouvé mes marques et un semblant d’assurance. Je suis allé jusqu’au bout du morceau et quelques applaudissements ont salué ma prestation. Jean-Claude m’a dit que je m’en étais bien sorti. Il m’a proposé d’en faire un second, un peu plus rapide.
Читать дальше