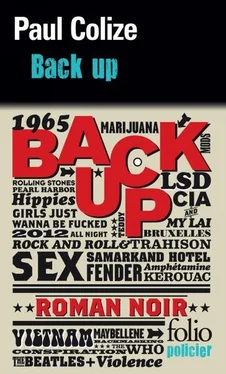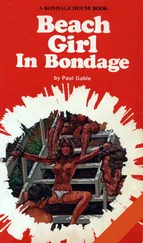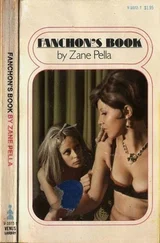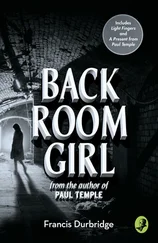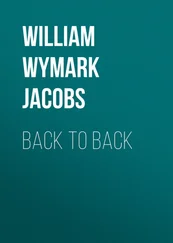Alors qu’il avait dix ans, il avait entendu Baby, Let’s Play House , le hit d’Elvis Presley et avait été marqué par l’énergie qui s’en dégageait. Il était aussitôt rentré chez lui et s’était emparé d’une vieille guitare espagnole qui pourrissait dans le grenier. Le soir même, il jouait quelques accords qu’il avait découverts à force de tâtonnements.
Par la suite il avait suivi des cours privés auprès d’un professeur du quartier. D’après ses dires, il ne lui avait fallu que quatre semaines pour en savoir plus sur la guitare que son instructeur.
Son aisance était à ce point surprenante que ses parents lui offrirent quelques mois plus tard sa première guitare électrique, une Grazzioso d’occasion, vite remplacée par une Fender Stratocaster neuve.
Aux solos agressifs et rageurs de Steve, Jim opposait une guitare mélodique, aux montées planantes et aux riffs dynamiques, à l’instar de Jimmy Page, un gamin du quartier avec qui il avait passé des heures à décortiquer les solos des maîtres tels que Scotty Moore, James Burton ou Cliff Gallup.
Le lendemain de l’enregistrement, au contraire des autres, Jim Ruskin avait pris la décision de rester à Berlin.
Il aimait cette ville, son ambiance cosmopolite, ses larges avenues et sa vie nocturne animée. Il aimait se promener dans les allées du Jardin zoologique, s’asseoir sur un banc public, entamer la conversation avec le premier passant ou regarder les lapins gambader sur la pelouse.
Même si les jeans et les cheveux longs n’étaient pas trop bien vus par la population, les Berlinois qu’il côtoyait l’appréciaient. Il avait appris leur langue, parlait comme eux, mangeait et buvait comme eux, boycottait le S-Bahn, le réseau de train urbain dont la gestion était assurée par la RDA, et se réjouissait du fond du cœur quand des résidents de Berlin-Est déjouaient les pièges des Vopos et réussissaient à franchir le Mur.
Aux petites heures, lorsque Pearl Harbor terminait son office, il se perdait dans la nuit, allait de bar en bar et rentrait fin saoul au petit matin pour s’enfoncer dans un sommeil sans rêves.
Amateur de femmes, il avait fait la connaissance de Birgit, une Berlinoise au corps épanoui et à la sexualité débridée dont il était tombé amoureux en l’espace d’une soirée. Elle travaillait au KaDeWe, le grand magasin de la Wittenberg Platz qui s’enorgueillissait d’offrir des centaines d’articles que l’on ne trouvait nulle part ailleurs.
Jim rejoignait Birgit en fin d’après-midi, lorsqu’elle avait terminé son travail. Ils dînaient ensemble dans un restaurant du quartier puis allaient chez elle.
Là, ils fumaient quelques joints et faisaient l’amour avant qu’il n’aille retrouver les membres de Pearl Harbor pour la soirée.
Le lundi 20 mars 1967, en fin de matinée, Jim fut réveillé par quelqu’un qui tambourinait à la porte de l’appartement qu’il occupait avec les autres musiciens de Pearl Harbor. C’était un minuscule trois pièces, situé au septième étage d’un immeuble vétuste du quartier de Zehlendorf, dans le secteur américain.
Au travers de la paroi, le commerçant du rez-de-chaussée l’informa qu’un appel téléphonique urgent l’attendait.
Jim émergea de son sommeil, le crâne en feu. Encore vaseux, il ne réalisa pas que ses trois compagnons étaient partis et qu’il était seul dans la chambre.
Il répondit que quelqu’un allait descendre et se rendormit.
Lorsqu’il sortit en fin d’après-midi, le commerçant, exaspéré, l’avisa que huit appels urgents étaient arrivés pour lui et qu’il n’avait pas pour vocation de jouer au coursier.
Jim prit la liste des numéros, forma le premier et tomba sur la tante de Larry. Celle-ci lui apprit la mort de ce dernier, survenue la veille à Majorque.
Consterné par la nouvelle, il ne songea pas à former les autres numéros, persuadé qu’il s’agissait de proches de Larry désireux de lui communiquer la même information.
Hébété, incertain, il parcourut l’avenue, entra dans un bar, avala deux cafés, ressortit, erra sur le boulevard et s’engouffra dans la station de métro.
À mesure que ses idées s’éclaircissaient, il prit conscience de la portée de la nouvelle. La mort de Larry annonçait la fin de Pearl Harbor, la fin du contrat à Berlin et la fin de sa relation avec Birgit.
L’espace d’un instant, il envisagea de prendre contact avec les autres pour connaître leurs réactions et retrouver un peu d’espoir, mais il ne savait ni où ni comment les joindre. Steve errait quelque part à Hambourg et Paul était parti en Irlande.
Tel un automate, il sillonna les couloirs du métro et se dirigea vers l’un des quais, sans savoir quelle destination la ligne desservait.
En début de soirée, lorsque la police allemande interrogea le conducteur du train, celui-ci déclara que l’accident s’était produit à l’heure de pointe.
Comme tous les soirs, de nombreuses personnes stationnaient sur le quai au moment où il était entré dans la station. Il avait perçu un mouvement dans la foule et un homme s’était précipité sous la rame. Il avait aussitôt actionné les freins. Malgré la vitesse relativement réduite, il n’avait pas réussi à arrêter la voiture. Le corps de l’homme avait basculé sous le train et avait été entraîné sur plusieurs mètres. Les cris qu’il avait poussés avaient semé un vent de panique et bon nombre de personnes avaient quitté les lieux.
Un passager s’était porté à son secours, mais le bas du corps de l’homme était pris dans les roues et ses jambes étaient en partie broyées dans les engrenages métalliques. L’homme était conscient, mais la douleur l’empêchait de communiquer.
Les secours étaient arrivés quelques minutes plus tard. Devant la gravité de la situation, ils avaient fait appel à une équipe de pompiers spécialisée dans les cas d’extraction.
Une fois sur place, ceux-ci s’étaient déclarés pessimistes au vu du temps nécessaire pour leur intervention. Comme l’homme perdait beaucoup de sang, les médecins avaient tenté de l’opérer sur place, mais avaient dû renoncer.
Malgré la somme d’efforts qu’ils avaient déployés, les secouristes n’avaient pu extraire l’homme du piège d’acier.
L’agonie de Jim Ruskin avait duré quarante-cinq minutes.
En octobre, la crise de Cuba a éclaté. Les Russes avaient installé des rampes de missiles sur l’île de Cuba et les avaient pointées sur le territoire des États-Unis.
Heure par heure, les commentateurs de la télévision et de la radio rapportaient l’escalade de la tension avec des inflexions hystériques dans la voix.
Les activités journalières marquaient le pas. Les magasins étaient dévastés. Les gens se préparaient à la guerre et amassaient des provisions. Il n’était plus possible de trouver du sucre, du riz, de la farine ou la moindre boîte de conserve. Le sujet occultait toute autre préoccupation. Chacun y allait de ses certitudes et de ses pronostics, cataclysmiques pour la plupart. Une chose semblait acquise, nous allions mourir.
Mon père avait annulé ses pérégrinations pour attendre l’apocalypse au sein de sa famille. Ses prédictions se révélaient exactes ; la guerre était à nos portes. Il passait ses soirées effondré dans le fauteuil, à maugréer devant la télévision. Nous ne pouvions lui adresser la parole, parler ou faire le moindre bruit dans la pièce.
Lorsque les programmes étaient terminés, il allumait la radio, collait son oreille contre le récepteur et passait d’une station à l’autre jusque tard dans la nuit.
Читать дальше