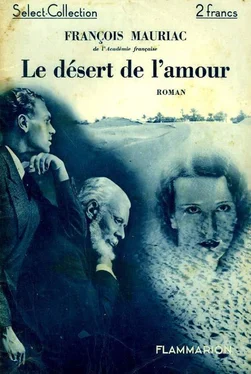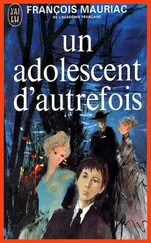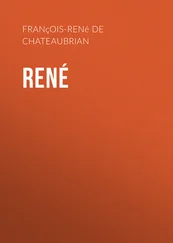Ces vacances après sa rhétorique, bien loin d'avoir été celles de son évasion, furent un temps de lâcheté cachée : perclus de honte, il croyait lire du mépris dans les yeux de la servante qui faisait sa chambre, n'osait soutenir ce regard dont le docteur parfois longuement le couvait. Comme les Basque passaient à Arcachon le mois d'août, il ne lui restait plus même les corps d'enfants souples comme des plantes avec lesquels il aimait à jouer sauvagement.
Depuis le départ des Basque, M meCourrèges répétait volontiers : « C'est tout de même agréable d'être enfin un peu chez soi. » Ainsi se vengeait-elle d'un propos de sa fille : « Gaston et moi nous avions bien besoin d'une petite cure de solitude. » En réalité, la pauvre femme vivait dans l'attente d'une lettre quotidienne et l'orage ne grondait pas sans qu'elle vît les Basque au complet dans une pinasse en perdition. Sa maison n'était plus qu'à demi pleine et les chambres vides lui faisaient mal. Qu'attendre de ce fils toujours à courir les routes, qui rentrait suant et, plein de hargne, se jetait sur la nourriture comme une bête ?
« On me dit : vous avez votre mari… Ah ouiche !
— Vous oubliez, ma pauvre fille, comme Paul est occupé.
— Il n'a plus ses cours, ma mère. Le plus gros de sa clientèle est aux eaux.
— Sa clientèle de pauvres ne se déplace pas. Et puis son laboratoire, l'hôpital, ses articles… »
L'épouse amère secouait le front : à cette activité du docteur, elle savait bien que l'aliment ne ferait jamais défaut ; qu'il n'y aurait jamais, jusqu'à la mort de cet homme, un intervalle de repos pendant lequel, vacant, oisif, il lui eût accordé le don total de quelques instants. Elle ne croyait pas que cela fût possible ; elle ne savait pas que l'amour, dans les vies les plus pleines, sait toujours se creuser sa place ; qu'un homme d'Etat surmené, autour de l'heure où sa maîtresse l'attend, arrête le monde. Cette ignorance l'empêchait de souffrir. Bien qu'elle connût l'espèce d'amour qui est de talonner un être inaccessible et qui ne se retourne jamais, son impuissance même à obtenir de lui un seul regard attentif l'avait empêchée d'imaginer que le docteur pût être différent pour une autre femme. Non, elle n'aurait pas voulu croire qu'il existât une femme capable d'attirer le docteur hors de cet univers incompréhensible où s'établissent des statistiques, des observations, où s'accumulent des taches de sang ou de pus retenues entre deux verres, et elle devait vivre des années sans découvrir que, bien des soirs, le laboratoire était resté désert, des malades avaient attendu en vain celui qui les aurait soulagés, mais qui, dans un salon sombre, étouffé d'étoffes, aimait mieux demeurer immobile, la face tournée vers une femme étendue.
Pour ménager, dans ces jours de labeur, de tels espaces secrets, le docteur devait redoubler d'activité ; il déblayait sa route encombrée, pour atteindre enfin ce temps de contemplation et d'amoureux silence où un long regard contentait son désir. Parfois, tout près de cette heure attendue, il recevait un message de Maria Cross : elle n'était plus libre, l'homme de qui elle dépendait avait arrangé une partie dans un restaurant de la banlieue ; le docteur n'aurait plus eu la force de vivre si, à la fin de la lettre, Maria Cross n'eût proposé un autre jour. Par un miracle instantané, toute son existence s'organisait autour de ce rendez-vous nouveau ; bien qu'il fût pris heure par heure, il voyait d'un coup d'œil, comme un habile joueur d'échecs, les combinaisons possibles et ce qu'il fallait déplacer pour être à la minute fixée, immobile, oisif, dans le salon étouffé d'étoffes, la face tournée vers cette femme étendue. Et, quand était passé l'heure où il aurait dû la joindre, si elle ne s'était excusée, il se réjouissait, songeant : « Maintenant ce serait déjà fini, tandis que j'ai encore devant moi tout ce bonheur… » Les jours qui l'en séparaient, il avait de quoi les combler : le laboratoire surtout lui était un havre ; il y perdait conscience de son amour ; la recherche abolissait le temps, consumait les heures jusqu'à ce que soudain ce fût le moment de pousser le portail de cette propriété où vivait Maria Cross, derrière l'église de Talence.
Mais, ainsi dévoré, il observait moins son fils, cet été-là. Dépositaire de tant de secrets honteux, le docteur répétait souvent : « Nous croyons toujours que le “fait divers” ne nous concerne pas, que l'assassinat, le suicide, la honte, c'est pour les autres, et pourtant… » Et pourtant il ne sut jamais que, dans cet août mortel, son fils avait été tout près d'accomplir un geste irréparable. Raymond voulait fuir, mais, en même temps, se cacher, n'être pas vu. Il n'osait pas entrer dans un café, dans un magasin. Il lui arrivait de passer dix fois devant une porte sans se résoudre à l'ouvrir. Cette phobie rendait impossible toute évasion, mais il étouffait dans cette maison. Bien des soirs, la mort lui apparut ce qui est le plus simple ; il ouvrit le tiroir du bureau où son père cachait un revolver d'un modèle ancien : Dieu ne voulut pas qu'il en trouvât les balles. Un après-midi, il traversa les vignes assoupies, descendit vers le vivier, au bas d'une prairie aride : il espérait que les plantes, les mousses enlaceraient ses jambes, qu'il ne pourrait se dépêtrer de cette eau bourbeuse et qu'enfin sa bouche, ses yeux seraient comblés de vase, que nul ne le verrait plus, et qu'il ne verrait plus les autres le voir. Des moustiques dansaient sur cette eau ; des grenouilles, comme des cailloux, troublaient cette ténèbre mouvante. Prise dans des plantes, une bête crevée était blanche. Ce qui sauva Raymond, ce jour-là, ne fut pas la peur, mais le dégoût.
Par bonheur, il n'était pas souvent seul, le tennis des Courrèges attirant la jeunesse des propriétés voisines. M meCourrèges reprochait aux Basque d'avoir exigé qu'elle fît la dépense de ce tennis, et d'être partis quand ils auraient pu y jouer. Les étrangers seuls en profitaient : une raquette à la main, des garçons vêtus de blanc, et qu'on n'entendait pas venir sur leurs espadrilles muettes, apparaissaient dans le salon à l'heure de la sieste, saluaient ces dames, s'informaient à peine de Raymond, et puis rentraient dans la lumière bientôt retentissante de leurs play, de leurs out et de leurs rires. « Ils ne se donnent pas la peine de refermer la porte », gémissait M meCourrèges mère dont l'idée fixe était de ne pas laisser entrer la chaleur. Raymond eût peut-être consenti à jouer, mais la présence des jeunes filles le chassait — ah ! surtout les demoiselles Cosserouge : Marie-Thérèse, Marie-Louise et Marguerite-Marie, trois blondes épaisses à qui trop de cheveux donnaient des migraines — condamnées à porter sur la tête une architecture énorme de tresses jaunes, mal retenue par les peignes et toujours menacée, Raymond les haïssait : qu'est-ce qu'elles avaient à rire tout le temps ? Elles se « tordaient », trouvaient toujours que les autres étaient « pouffants ». Au vrai, elles ne riaient pas plus de Raymond que de quiconque, mais c'était son mal de se croire le centre de la risée universelle. Il avait d'ailleurs une raison précise de les haïr : la veille du départ des Basque, Raymond n'avait osé refuser à son beau-frère la promesse de monter un immense cheval que le lieutenant laissait à l'écurie. Mais, à cet âge-là, Raymond, à peine en selle, avait toujours été la proie d'un vertige qui faisait de lui le plus ridicule cavalier. Les demoiselles Cosserouge, un matin, l'avaient surpris dans une allée forestière, cramponné au pommeau, puis déposé rudement sur le sable. Il ne pouvait les voir sans se souvenir des grands éclats qu'elle firent alors ; en toute rencontre, elles aimaient rappeler les circonstances de sa chute.
Читать дальше