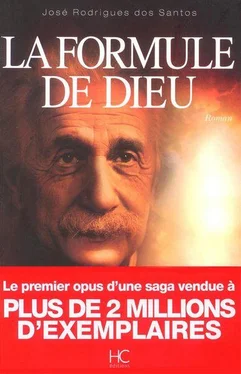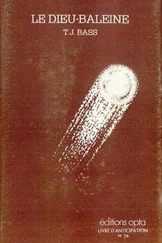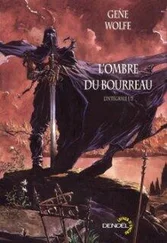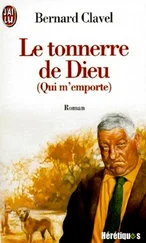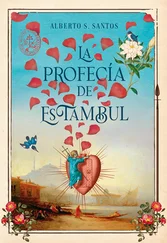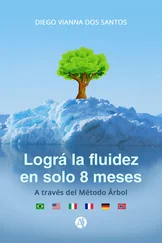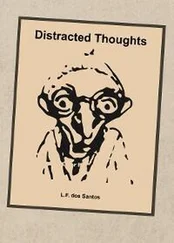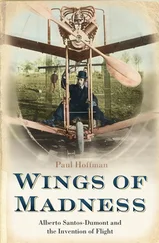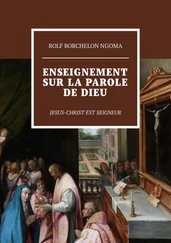— Le télescope ou l’astronome ?
— L’astronome, bien sûr. Dans les années vingt, Edwin Hubble confirma l’existence de galaxies au-delà de la Voie Lactée, et, après avoir mesuré le spectre de la lumière qu’elles émettaient, il s’aperçut que toutes s’éloignaient de nous. Mieux encore, il vérifia que plus une galaxie était loin, plus vite elle s’éloignait. C’est ainsi que l’on a compris la vraie raison pour laquelle, conformément à la loi de la gravité, toute la matière de l’univers ne s’amalgamait pas en une seule et unique masse. C’est parce que l’univers est en expansion. Le professeur s’arrêta au milieu de l’estrade et regarda son auditoire. À présent, je vous pose cette question : quelle est la conséquence de cette découverte sur le problème du point Alpha ?
— C’est simple, répondit l’étudiant à lunettes, en s’agitant sur son siège. Si toute la matière de l’univers se disperse, c’est qu’elle a été rassemblée dans le passé.
— Tout à fait. La découverte de l’univers en expansion implique qu’il y a eu un moment initial où tout était concentré avant d’être projeté dans toutes les directions. Du reste, les scientifiques constatèrent que cela cadrait avec la théorie de la relativité générale, dont découlait le concept d’un univers dynamique. Or, en s’appuyant sur toutes ces découvertes, un prêtre belge, nommé Georges Lemaître, avança une nouvelle idée dans les années vingt. Il se tourna vers le tableau et griffonna deux mots anglais.
Big Bang
Le Big Bang. La grande explosion. Il regarda à nouveau les étudiants. Lemaître a suggéré que l’univers était né d’une brusque explosion initiale. L’idée était extraordinaire et résolvait d’un seul coup tous les problèmes liés au concept d’un univers éternel et statique. Le Big Bang s’accordait avec la deuxième loi de thermodynamique, solutionnait le paradoxe d’Olbers, expliquait l’actuelle configuration de l’univers soumis aux exigences de la loi de la gravité de Newton et cadrait avec les théories de la relativité d’Einstein. L’univers a commencé par une grande explosion soudaine… bien que l’expression la plus appropriée ne soit peut-être pas explosion, mais expansion.
— Et avant cette… cette expansion, qu’y avait-il alors ? demanda une étudiante avisée. Rien que le vide ?
— Il n’y avait pas d’avant. L’univers a commencé avec le Big Bang.
L’étudiante eut l’air troublée.
— Oui, mais… qu’y avait-il avant l’expansion ? Il fallait bien qu’il y ait quelque chose, non ?
— C’est ce que je viens de vous dire, insista Luís Rocha. Il n’y avait pas d’avant. Nous ne parlons pas ici d’un espace vide qui aurait commencé à se remplir. Le Big Bang implique qu’il n’y avait aucun espace antérieur. L’espace est né avec la grande expansion soudaine, vous comprenez ? Or, les théories de la relativité établissent que l’espace et le temps sont les deux faces d’une même médaille. Dès lors, la conclusion est logique. Si l’espace est né avec le Big Bang, le temps est également issu de cet événement primordial. Il n’y avait pas d’avant parce que le temps n’existait pas. Le temps commença avec l’espace, qui débuta avec le Big Bang. Demander ce qu’il y avait avant le temps, c’est comme demander ce qu’il y a au nord du pôle Nord. Ça n’a pas de sens, vous comprenez ? L’étudiante écarquilla les yeux et hocha la tête, mais il était clair que l’idée lui semblait difficile à accepter. Ce problème du moment initial est, du reste, le plus complexe de toute la théorie, ajouta le professeur, conscient de l’étrangeté de ce qu’il venait d’expliquer. On l’appelle une singularité. On pense que tout l’univers était comprimé en un point infime d’énergie et que, soudain, il y a eu une éruption, pendant laquelle a surgi la matière, l’espace, le temps et les lois de l’univers.
— Mais qu’est-ce qui a provoqué cette éruption ? demanda l’étudiant à lunettes, très attentif aux détails.
Un nouveau tic nerveux contracta le visage de Luís Rocha. C’était le point le plus délicat de toute la théorie, le plus difficile à expliquer ; pas seulement parce que les explications étaient contre-intuitives, mais aussi parce que les scientifiques eux-mêmes restaient encore perplexes devant ce problème.
— Disons que le mécanisme causal ne s’applique pas à ce point, argumenta-t-il.
— Il ne s’applique pas ? insista l’étudiant. Insinuez-vous qu’il n’y ait pas eu de cause ?
— Plus ou moins. Écoutez, je sais que tout ça paraît étrange, mais il est important que vous suiviez mon raisonnement. Tous les événements ont des causes et leurs effets deviennent des causes d’événements à venir. D’accord ? Quelques têtes acquiescèrent, c’était une évidence de la physique. Seulement, le processus cause-effet-cause implique une chronologie. D’abord se produit la cause, puis l’effet. Il leva la main, comme pour souligner ce qui allait suivre. Maintenant réfléchissez : puisque le temps n’existait pas encore dans ce point infime, comment un événement aurait pu en générer un autre ? Il n’y avait pas d’avant ni d’après. En conséquence, il n’y avait pas de causes ni d’effets, parce qu’aucun événement ne pouvait en précéder un autre.
— Ne trouvez-vous pas cette explication peu satisfaisante ? demanda l’étudiant à lunettes.
— Je n’ai pas d’avis à vous donner. J’essaie seulement de vous expliquer le Big Bang selon les données dont on dispose aujourd’hui. Le fait est qu’excepté ce problème de la singularité initiale, cette théorie résout les paradoxes posés par l’hypothèse de l’univers éternel. Mais il y a eu des scientifiques qui, comme certains d’entre vous, n’ont pas été satisfaits par le Big Bang et ont cherché une explication alternative. L’hypothèse la plus intéressante qu’on ait proposée est la théorie de l’univers en état permanent, reposant sur l’idée que la matière de faible entropie est en création constante. Au lieu que la matière surgisse en totalité d’une grande expansion initiale, elle apparaîtrait graduellement, par petites éruptions au fil du temps, compensant la part de matière qui meurt à son point maximum d’entropie. Si c’est le cas, l’univers peut être éternel. Cette possibilité a sérieusement été envisagée par la science, à tel point que, pendant longtemps, la théorie de l’univers en état permanent était présentée sur le même pied d’égalité que la théorie du Big Bang.
— Et pourquoi n’est-ce plus le cas ?
— À cause d’une prévision due à la théorie du Big Bang. En considérant cette grande expansion initiale, les scientifiques ont pensé qu’il devait exister une radiation cosmique de fond, une sorte d’écho de cette éruption primordiale de l’univers. L’existence de cet écho a été présentée en 1948 et on lui attribuait une température d’environ cinq degrés Kelvin, autrement dit, cinq degrés au-dessus du zéro absolu. Mais où diable se trouvait cet écho ? Il écarquilla les yeux et écarta les bras, dans une expression interrogative. On avait beau chercher, on ne trouvait rien. Jusqu’à ce qu’en 1965, deux astrophysiciens américains qui achevaient un travail expérimental au moyen d’une grande antenne dans le New Jersey, captent soudain un bruit de fond désagréable, comme un sifflement de cocotte minute. Ce bruit agaçant semblait venir de tous les points du ciel. Les deux chercheurs avaient beau tourner l’antenne d’un côté comme de l’autre, vers une étoile ou une galaxie, vers un espace vide ou une nébuleuse lointaine, le son persistait. Durant un an, ils ont cherché à l’éliminer. Ils ont vérifié les câbles électriques, examiné les moindres possibilités de panne, ils ont tout essayé, mais impossible de localiser la source de ce bruit insupportable. En désespoir de cause, ils ont appelé les scientifiques de l’université de Princeton, pour leur demander s’ils avaient une explication. Ils en avaient une. C’était l’écho du Big Bang.
Читать дальше