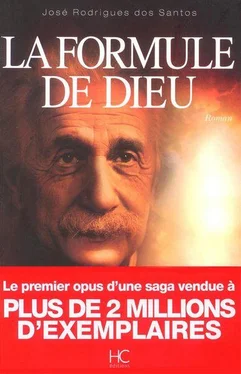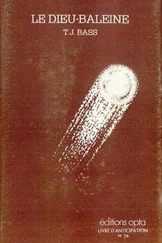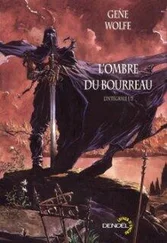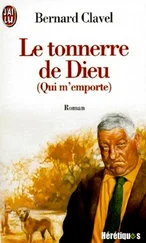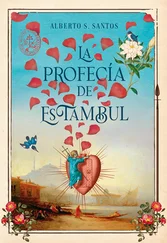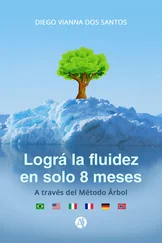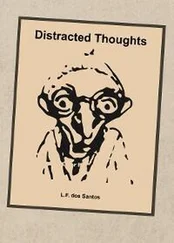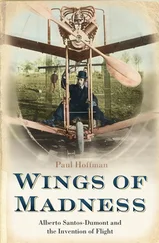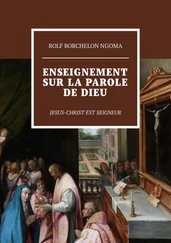Tomás alla chercher dans sa chambre la feuille où figuraient les formules et revint dans la cuisine.
— Voilà, dit-il, en reprenant sa place avec la feuille dépliée dans la main. « Subtil est le Seigneur, mais malicieux Il n’est pas », lut-il à nouveau. « La Nature cache son secret à cause de son essence majestueuse, jamais par malice. » Il regarda son père. Venant d’un scientifique, qu’est-ce que ça peut vouloir dire, selon toi ?
Le mathématicien avala quelques flocons.
— Einstein se réfère ici à une caractéristique inhérente à l’univers, à savoir la manière dont les mystères les plus profonds sont habilement dissimulés. On a beau s’efforcer de percer l’énigme, on se heurte toujours à une subtile barrière qui empêche de l’élucider complètement.
— Je crains de ne pas comprendre…
Son père fit tourner sa cuillère.
— Je vais te donner un exemple, dit-il. Prenons la question du déterminisme et du libre arbitre. Voilà un problème que la philosophie se pose depuis longtemps, et qui a été repris par la physique et les mathématiques.
— Tu veux parler du fait de savoir si nos décisions sont libres ou pas ?
— Oui, acquiesça-t-il. Qu’en penses-tu ?
— Je crois que nous sommes libres, non ? Tomás fit un geste vers la fenêtre. Par exemple, je suis venu à Coimbra parce que je l’ai décidé librement. Il pointa son doigt vers l’assiette posée sur la table. Si tu as mangé ces céréales, c’est parce que tu l’as voulu.
— C’est ton avis ? Tu crois vraiment que nous prenons ces décisions en toute liberté ?
— Eh bien… oui, je crois.
— N’es-tu pas venu à Coimbra parce que tu es conditionné psychologiquement par le fait que je sois malade ? N’ai-je pas mangé ces céréales parce que je suis physiologiquement conditionné ou influencé par une quelconque publicité sans en être conscient ? Il arqua ses sourcils comme pour souligner ce qu’il venait de dire. Jusqu’à quel point sommes-nous vraiment libres ? Si nous examinons leur origine profonde, les décisions que nous croyons prendre librement ne sont-elles pas conditionnées par un nombre incalculable de facteurs, dont l’existence nous échappe le plus souvent ? Le libre arbitre n’est-il qu’une illusion ? Et si tout était déterminé, sans que nous en ayons conscience ?
Tomás remua sur sa chaise.
— Je sens que ces questions sont piégées, observa-t-il, méfiant. Quelle réponse donne la science ? Sommes-nous libres ou pas ?
— Telle est la grande incertitude, dit son père en souriant avec malice. Si je ne m’abuse, le premier grand défenseur du déterminisme fut un Grec nommé Leucippe. Il affirmait que rien n’arrive par hasard et que tout a une cause. Platon et Aristote, en revanche, pensaient autrement et laissaient une place au libre arbitre, un point de vue que l’Église adopta. Ça l’arrangeait tu penses bien ! Puisque l’homme disposait d’un libre arbitre, Dieu n’était plus responsable du mal commis dans le monde. Durant des siècles, l’idée a donc prévalu que les êtres humains étaient dotés d’un libre arbitre. C’est seulement avec Newton et le progrès des sciences que le déterminisme fut remis à l’honneur, au point que l’un des plus grands astronomes du XVII esiècle, le marquis Pierre Simon de Laplace, en élabora une importante théorie. Il observa que l’univers obéissait à des lois fondamentales et en déduisit que si nous connaissions ces lois et savions la position, la vitesse et la direction de chaque objet et de chaque particule existant dans l’univers, nous serions en mesure de connaître tout le passé et tout l’avenir, puisque tout est déjà déterminé. On appelle cette hypothèse le démon de Laplace. Tout est déterminé.
— Hum, murmura Tomás. Et qu’en dit la science moderne ?
— Einstein admettait ce point de vue et les théories de la relativité furent conçues selon le principe que l’univers était déterministe. Mais les choses se compliquèrent quand apparut la théorie quantique, qui instaura une vision indéterministe dans le monde des atomes. La formulation de l’indéterminisme quantique est due à Heisenberg qui, en 1927, constata qu’il était impossible de déterminer en même temps, de manière rigoureuse, la vitesse et la position d’une microparticule. Ainsi naquit le principe d’incertitude, qui vint…
— J’en ai déjà entendu parler, coupa Tomás, se rappelant l’explication qu’Ariana lui avait donnée à Téhéran. Le comportement des grands objets est déterministe, le comportement des petits est indéterministe.
Manuel regarda un instant son fils.
— Fichtre, s’exclama-t-il. Jamais je n’aurais imaginé que tu sois au courant de ces choses.
— On m’en a parlé récemment. N’est-ce pas ce problème qui a orienté la recherche vers une théorie du tout, capable de concilier ces contradictions ?
— Exact, confirma le mathématicien. Aujourd’hui encore, c’est le grand rêve de la physique. Les scientifiques recherchent une théorie qui, entre autres choses, unirait la théorie de la relativité et la théorie quantique et résoudrait le problème du déterminisme ou de l’indéterminisme de l’univers. Il toussa. Mais il est essentiel de noter une chose. Le principe d’incertitude affirme qu’il est impossible de définir avec précision le comportement d’une particule à cause de la présence de l’observateur. Au fil des années, ce problème a nourri mes conversations avec le professeur Siza… Celui qui a disparu, tu sais ?
— Oui.
— Ce qui s’est passé, c’est que le principe d’incertitude, qui est vrai, a suscité ce que Siza et moi avons toujours appelé « un tissu d’absurdités », amenant certains physiciens à dire qu’une particule ne décidait de l’endroit qu’elle occupait qu’au moment où apparaissait un observateur.
— J’en ai aussi entendu parler, dit Tomás. C’est l’histoire de l’électron qui, lorsqu’on le met dans une boîte divisée en deux compartiments, se retrouve dans ces deux compartiments en même temps, et c’est seulement quand quelqu’un soulève le couvercle que l’électron décide de rester dans l’un ou dans l’autre…
— Tout à fait, confirma son père, impressionné par les connaissances de Tomás en matière de physique quantique. Cette hypothèse fut tournée en dérision par Einstein et par d’autres physiciens, bien entendu. Ils imaginèrent divers exemples pour montrer l’absurdité de cette idée, le plus célèbre étant celui du chat de Schrödinger. Donc, Schrödinger démontra que si une particule pouvait être en deux endroits à la fois, alors un chat pouvait être vivant et mort en même temps, ce qui est absurde.
— Oui, approuva Tomás. Pourtant, cette mécanique quantique, bien qu’étrange et contre-intuitive, cadre avec les mathématiques et la réalité, non ?
— Bien sûr qu’elle cadre ! s’exclama Manuel. Mais la question n’est pas de savoir si elle cadre, puisque c’est le cas. La question est de savoir si l’interprétation est correcte.
— Comment ça ? Si elle cadre, c’est parce qu’elle est correcte.
Le vieux mathématicien sourit.
— C’est là qu’entre en jeu la subtilité inhérente à l’univers, dit-il. Heisenberg a établi qu’il était impossible de déterminer avec précision à la fois la position et la vitesse d’un corpuscule à cause de l’influence exercée par l’observateur. C’est ce constat qui a conduit à affirmer que l’univers des microparticules était indéterministe. Autrement dit, on ne peut pas déterminer leur comportement. Mais cela ne signifie pas que ce comportement soit indéterministe, tu comprends ?
Tomás secoua la tête, déconcerté.
— Quel foutoir ! Je n’y comprends rien.
Читать дальше