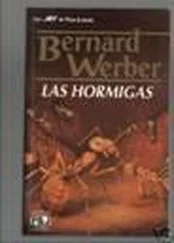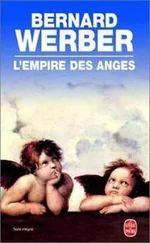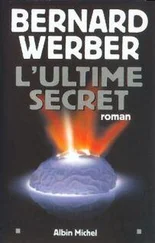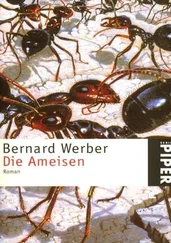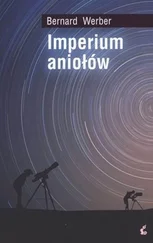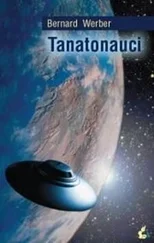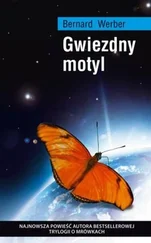Elles sont fourbues. Il y a longtemps que les exploratrices n'ont pas mangé et elles commencent à souffrir des premières affres du manque d'humidité: les antennes se rigidifient, les articulations des pattes se soudent, les sphères oculaires se recouvrent d'une pellicule de poussière et elles n'ont pas de salive à gaspiller pour les laver.
Les treize fourmis se renseignent sur la direction du grand chêne auprès d'un collembole des sables. À peine leur a-t-il répondu qu'elles le mangent. Il y a des moments où dire «merci» est un luxe au-dessus de vos forces. Elles suçotent jusqu'aux articulations des pattes de l'animal pour récupérer la moindre molécule de son humidité.
Si le désert se poursuit encore sur une grande distance, elles périront. 103e commence à éprouver des difficultés à mettre une patte devant l'autre.
Que ne donneraient-elles pas, ne serait-ce que pour une demi-goutte de rosée! Mais depuis quelques années, la température a grimpé en flèche sur la planète. Les printemps sont chauds, les étés caniculaires, les automnes tièdes et il n'y a qu'en hiver que le froid et l'humidité se font un peu sentir.
Elles connaissent par chance une manière de marcher qui épargne l'extrémité de leurs pattes. C'est la technique des fourmis de la ville de Yedi-bei-nakan. Il faut avancer en n'utilisant que quatre de ses six pattes puis alterner avec quatre autres. On dispose ainsi constamment de deux pattes fraîches reposées des brûlures du sol.
103e, toujours intéressée par les espèces étrangères, admire des acariens, ces «insectes des insectes», qui hantent tranquillement ce désert, hors de portée de leurs prédateurs. Ils s'enterrent quand il fait chaud et sortent quand le temps fraîchit. Les fourmis décident de les copier.
Ils sont sans doute aussi minuscules pour nous que nous le sommés pour les Doigts et pourtant, dans cette épreuve, ils nous donnent un exemple de survie.
Voilà qui prouve encore à 103e qu'il ne faut sous-esti-mer ni les dimensions supérieures ni les dimensions inférieures.
Nous sommes en équilibre entre les acariens et les Doigts.
Le temps fraîchissant, les fourmis sortent de leur couverture de sable.
Un coléoptère rouge file devant elles. 15e veut le mettre en joue mais 103e lui dit que cela ne servirait à rien de l'abattre. Si cet insecte est rouge, ce n'est pas par hasard Il faut le savoir, dans la nature, tout ce qui arbore des couleurs tape-à-Pœil est toxique ou dangereux.
Les insectes ne sont pas fous. Ils ne vont pas s'afficher en rouge écarlate aux yeux de tous pour le plaisir d'attirer leurs prédateurs. S'ils le font, c'est bien pour signaler à tout le monde qu'il est inutile de leur chercher noise.
14e prétend que certains insectes se font rouges pour faire croire qu'ils sont toxiques alors qu'ils ne le sont pas.
7e ajoute qu'elle a vu des évolutions parallèles et complémentaires. Deux espèces de papillons ont exactement les mêmes motifs sur leurs ailes. L'un a les ailes toxiques, l'autre pas. Mais l'espèce non toxique est tout autant préservée que l'autre, car les oiseaux reconnaissent le motif des ailes et, croyant qu'ils sont toxiques, les évitent.
103e estime que, dans le doute, mieux vaut ne pas risquer de s'empoisonner.
15e, navrée, laisse partir le coléoptère. 14e, plus tenace, le poursuit et l'abat. Elle le goûte. Toutes pensent qu'elle va mourir, mais non. C'était bien un mimétisme pour faire croire à la toxicité.
On se régale de l'insecte rouge.
Tout en marchant, les fourmis discutent du sens du mimétisme et de la signification des couleurs. Pourquoi certains êtres sont-ils colorés et d'autres non?
Au milieu de la canicule et de la sécheresse, cette discussion sur le mimétisme semble bien incongrue. 103e se dit que ce doit être sa mauvaise influence, son côté dégénéré au contact des Doigts. Mais elle reconnaît que, même si parler est un gaspillage d'humidité, cela présente l'intérêt de ne pas sentir la fatigue et la douleur.
16e raconte qu'elle a vu une chenille prendre la forme d'une tête d'oiseau pour faire peur à un autre oiseau. 9e prétend avoir vu une mouche prendre la forme d'un scorpion pour repousser une araignée.
Était-elle à métamorphose complète ou à métamorphose incomplète? demande 14e.
Chez les insectes, c'est un thème de discussion récurrent. On aime bien parler de la métamorphose. Il y a toujours eu un clivage entre les insectes à métamorphose complète et ceux à métamorphose incomplète. Ceux qui ont la métamorphose complète connaissent quatre phases: œuf, larve, nymphe, adulte. C'est le cas des papillons, des fourmis, des guêpes, des abeilles, mais aussi des puces, des coccinelles. Ceux qui ont la métamorphose incomplète ne connaissent que trois phases: œuf, larve, adulte. Ils naissent à l'état d'adulte miniature et connaissent des transformations graduelles. C'est plutôt le cas des sauterelles, des perce-oreilles, des termites et des blattes.
On l'ignore souvent, mais il existe une certaine forme de mépris chez les «métamorphosés complets» envers les «métamorphosés incomplets». Il y a toujours eu ce sous-entendu: «n'ayant pas eu de nymphose» ils ne sont pas complètement «démoulés», ils ne sont pas complets. Ce sont des bébés qui deviennent de vieux bébés et non des bébés qui deviennent adultes.
C'était une mouche à métamorphose complète , répond 9e, comme s'il s'agissait d'une évidence.
103e marche et regarde le soleil se dérober lentement à l'horizon dans une débauche de jaunes et d'orangés: Des idées étranges, peut-être dues à une insolation, lui vieilnent. Le soleil est-il un animal à métamorphose complète? Les Doigts ont-ils des métamorphoses complètes? Pourquoi la nature l'a-t-elle mise en contact avec ces monstres, et uniquement elle? Pourquoi un seul individu a-t-il une aussi lourde responsabilité?
Pour la première fois, elle éprouve quelques doutes sur sa quête. Désirer un sexe, souhaiter faire évoluer le monde, vouloir créer une alliance entre Doigts et fourmis, cela a-t-il vraiment un sens? Et, si oui, pourquoi la nature passe-t-elle par des chemins si hasardeux pour arriver à ses fins?
CONSCIENCE DU FUTUR : Qu'est-ce qui différencie l'homme des autres espèces animales? Le fait de posséder un pouce opposable aux autres doigts de la main? Le langage? Le cerveau hypertrophié? La position verticale? Peut-être est-ce tout simplement la conscience du futur. Tous les animaux vivent dans le présent et le passé. Ils analysent ce qui survient et le comparent avec ce qu'ils ont déjà expérimenté. Par contre, l'homme, lui, tente de prévoir ce qui se passera. Cette disposition à apprivoiser le futur est sans doute apparue quand l'homme, au néolithique, a commencé à s'intéresser à l'agriculture. Il renonçait dès lors à.la cueillette et à la chasse, sources de nourriture aléatoires, pour prévoir les récoltes futures. Il était désormais logique que la vision du futur devienne subjective, et donc différente pour chaque être humain. Les humains se sont donc mis tout naturellement à élaborer un langage pour décrire ces futurs. Avec la conscience du futur est né le langage qui le décrirait. Les langues anciennes disposaient de peu de mots et d'une grammaire simpliste pour parler du futur, alors que les langues modernes ne cessent d'affiner cette grammaire. Pour confirmer les promesses de futur, il fallait, en toute logique, inventer la technologie. Là a résidé le début de l'engrenage.
Dieu est le nom donné par les humains à ce qui échappe à leur maîtrise du futur. Mais la technologie leur permettant de contrôler de mieux en mieux ce futur, Dieu disparaît progressivement, remplacé par les météorologues, les futurologues et tous ceux qui pensent savoir, grâce à l'usage des machines, de quoi demain sera fait et pourquoi demain sera ainsi et non autrement.
Читать дальше