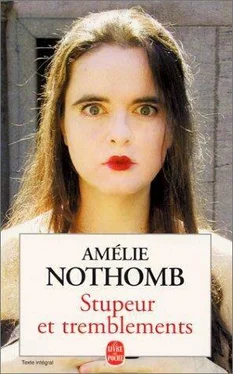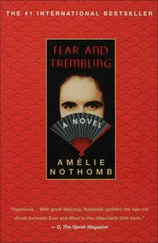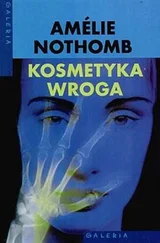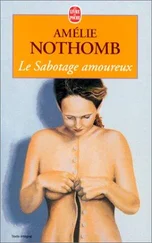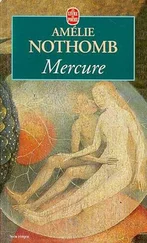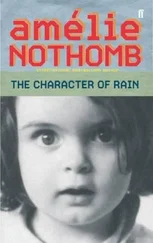Ce constat me rappela le mot d'André Maurois: «Ne dites pas trop de mal de vous-même: on vous croirait.»
L'ogre tira de sa poche un mouchoir, sécha ses larmes de rire et, à ma grande stupeur, se moucha, ce qui est au Japon l'un des combles de la grossièreté. Étais-je donc tombée si bas que l'on pouvait sans vergogne vider son nez devant moi?
Ensuite, il soupira:
– Amélie-san!
Il n'ajouta rien. J'en conclus que, pour lui, l'affaire était close. Je me levai, saluai et partis sans demander mon reste.
Il ne me restait plus que Dieu. Jamais je ne fus aussi nippone qu'en remettant ma démission au président.
Devant lui, ma gêne était sincère et s’exprimait par un sourire crispé entrecoupé de hoquets étouffés.
Monsieur Haneda me reçut avec une extrême gentillesse dans son bureau immense et lumineux.
– Nous approchons du terme de mon contrat et je voulais vous annoncer avec regret que je ne pourrai le reconduire.
– Bien sûr. Je vous comprends.
Il était le premier à commenter ma décision avec humanité.
– La compagnie Yumimoto m'a donné de multiples occasions de faire mes preuves. Je lui en serai éternellement reconnaissante. Hélas, je n'ai pas pu me montrer à la hauteur de l'honneur qui m'était accordé.
Il réagit aussitôt:
– Ce n'est pas vrai, vous le savez bien. Votre collaboration avec monsieur Tenshi a démontré que vous avez d'excellentes capacités dans les domaines qui vous conviennent.
Ah, quand même!
Il ajouta en soupirant:
– Vous n'avez pas eu de chance, vous n'êtes pas arrivée au bon moment. Je vous donne raison de partir mais sachez que, si un jour vous changiez d'avis, vous seriez ici la bienvenue. Je ne suis certainement pas le seul à qui vous manquerez.
Je suis persuadée qu'il se trompait sur ce point. Cela ne m'en émut pas moins. Il parlait avec une bonté si convaincante que je fus presque triste à l'idée de quitter cette entreprise.
Nouvel an: trois jours de repos rituel et obligatoire. Un tel farniente a quelque chose de traumatisant pour les Japonais.
Pendant trois jours et trois nuits, il n'est même pas permis de cuisiner. On mange des mets froids, préparés à l'avance et entreposés dans de superbes boîtes de laque..
Parmi ces nourritures de fêtes, il y a les omochi: des gâteaux de riz dont, auparavant, je raffolais. Cette année-là, pour des raisons onomastiques, je ne pus en avaler.
Quand j'approchais de ma bouche un omochi, j'avais la certitude qu'il allait rugir: «Amélie-san!» et éclater d'un rire gras.
Retour à la compagnie pour seulement trois jours de travail. Le monde entier avait les yeux dardés sur le Koweït et ne pensait qu'au 15 janvier.
Moi, j'avais les yeux dardés sur la baie vitrée des toilettes et je ne pensais qu'au 7 janvier: c'était mon ultimatum.
Le matin du 7 janvier, je ne pouvais pas y croire: j'avais tant attendu cette date. Il me semblait que j'étais chez Yumimoto depuis dix ans.
Je passai ma journée aux commodités du quarante-quatrième étage dans une atmosphère de religiosité: j'effectuais les moindres gestes avec la solennité d'un sacerdoce. Je regrettais presque de ne pouvoir vérifier le mot de la vieille carmélite: «Au Carmel, ce sont les trente premières années qui sont difficiles.»
Vers dix-huit heures, après m'être lavé les mains, j'allai serrer celles de quelques individus qui, à des titres divers, m'avaient laissé entendre qu'ils me considéraient comme un être humain. La main de Fubuki ne fut pas du lot. Je le regrettai, d'autant que je n'éprouvais envers elle aucune rancune: ce fut par amour-propre que je me contraignis à ne pas la saluer. Par la suite, je trouvai cette attitude stupide: préférer son orgueil à la contemplation d'un visage exceptionnel, c'était un mauvais calcul.
A dix-huit heures trente, je retournai une dernière fois au Carmel. Les toilettes pour dames étaient désertes. La laideur de l'éclairage au néon ne m'empêcha pas d'avoir le cœur serré: sept mois – de ma vie? non; de mon temps sur cette planète – s'étaient écoulés ici. Pas de quoi être nostalgique. Et pourtant ma gorge se nouait.
D'instinct, je marchai vers la fenêtre. Je collai mon front à la vitre et je sus que c'était cela qui me manquerait: il n'était pas donné à tout le monde de dominer la ville du haut du quarantequatrième étage.
La fenêtre était la frontière entre la lumière horrible et l'admirable obscurité, entre les cabinets et l'infini, entre l'hygiénique et l'impossible à laver, entre la chasse d'eau et le ciel. Aussi longtemps qu'il existerait des fenêtres, le moindre humain de la terre aurait sa part de liberté.
Une ultime fois, je me jetai dans le vide. Je regardai mon corps tomber.
Quand j'eus contenté ma soif de défenestration, je quittai l'immeuble Yumimoto. On ne m'y revit jamais.
Quelques jours plus tard, je retournai en Europe.
Le 14 janvier 1991, je commençai à écrire un manuscrit dont le titre était Hygiène de l'assassin.
Le 15 janvier était la date de l'ultimatum américain contre l'Irak. Le 17 janvier, ce fut la guerre.
Le 18 janvier, à l'autre bout de la planète, Fubuki Mori eut trente ans.
Le temps, conformément à sa vieille habitude, passa.
En 1992, mon premier roman fut publié.
En 1993, je reçus une lettre de Tokyo. Le texte en était ainsi libellé:
«Amélie-san, Félicitations.
Mori Fubuki.»
Ce mot avait de quoi me faire plaisir. Mais il comportait un détail qui me ravit au plus haut point: il était écrit en japonais.