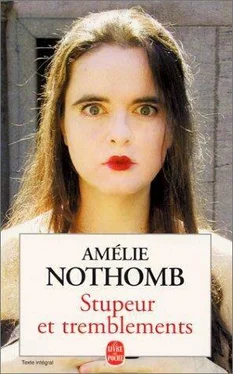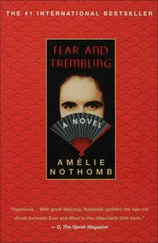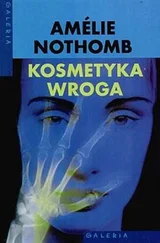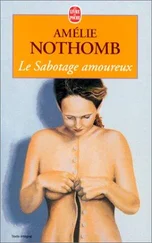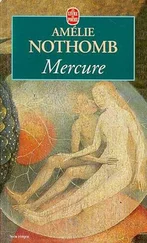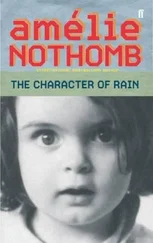– Dites-le-moi.
– Méfiez-vous. Et arrangez-vous pour déserter les toilettes masculines quand il y viendra quelqu'un.
Elle sortit. Je me demandai si sa menacé était réelle ou si elle bluffait.
J'obéis donc à la nouvelle consigne, soulagée de fréquenter moins un lieu où, en deux mois, j'avais eu l'accablant privilège de découvrir que le mâle nippon n'était pas distingué du tout.
Autant la Japonaise vivait dans la terreur du moindre bruit produit par sa personne, autant le Japonais s'en préoccupait peu.
Même en y étant moins souvent, je constatai pourtant que les cadres de la section produits laitiers n'avaient pas repris leurs habitudes au quarante-quatrième étage: sous l'impulsion de leur chef, leur boycott se poursuivait. Grâce éternelle en soit rendue à monsieur Tenshi.
En vérité, depuis ma nomination, aller aux toilettes de l'entreprise était devenu un acte politique.
L'homme qui fréquentait encore les toilettés du quarante-quatrième signifiait: «Ma soumission à l'autorité est absolue et cela m'est égal qu'on humilie les étrangers. D'ailleurs, ces derniers n'ont pas leur place chez Yumimoto.»
Celui qui refusait d'y aller exprimait cette opinion: «Respecter mes supérieurs ne m'empêche pas de conserver mon esprit critique vis-à-vis de certaines de leurs décisions. D'autre part, je pense que Yumimoto aurait avantage à employer des étrangers dans quelques postes à responsabilité où ils pourraient nous être utiles.»
Jamais lieux d'aisances ne furent le théâtre d'un débat idéologique à l'enjeu aussi essentiel.
Toute existence connaît son jour de traumatisme primal, qui divise cette vie en un avant et un après et dont le souvenir même furtif suffit à figer dans une terreur irrationnelle, animale et inguérissable.
Les toilettes pour dames de la compagnie étaient merveilleuses car elles étaient éclairées d'une baie vitrée. Cette dernière avait pris dans mon univers une place colossale: je passais des heures debout, le front collé au verre, à jouer à me jeter dans le vide. Je voyais mon corps tomber, je me pénétrais de cette chute jusqu'au vertige. Pour cette raison, j'affirme que je ne me suis jamais ennuyée une minute à mon poste.
J'étais en plein exercice de défenestration quand un nouveau drame éclata. J'entendis la porte s'ouvrir derrière moi. Ce ne pouvait être que Fubuki; pourtant, ce n'était pas le bruit net et rapide de ma tortionnaire poussant l'huis. C'était comme si la porte avait été renversée. Et les pas qui suivirent n'étaient pas ceux d'escarpins, mais ceux, lourds et déchaînés, du yéti en rut.
Tout cela se déroula très vite et j'eus à peine le temps de me retourner pour voir foncer sur moi la masse du vice-président.
Microseconde de stupeur («Ciel! Un homme – pour autant que ce gros lard fût un homme – chez les dames!») puis éternité de panique.
Il m'attrapa comme King Kong s'empare de la blondinette et m'entraîna à l'extérieur. J'étais un jouet entre ses bras. Ma peur atteignit son comble quand je vis qu'il m'emportait aux toilettes des messieurs.
Me revinrent à l'esprit les menaces de Fubuki: «Vous ne savez pas ce qui pourrait vous arriver.» Elle n'avait pas bluffé. J'allais payer pour mes péchés. Mon cœur cessa de battre. Mon cerveau écrivit son testament.
Je me rappelle avoir pensé: «Il va te violer et t'assassiner. Oui, mais dans quel ordre? Pourvu qu'il te tue avant!»
Un homme était en train de se laver les mains aux lavabos. Hélas, la présence de ce tiers ne sembla rien changer aux desseins de monsieur Omochi. Il ouvrit la porte d'un cabinet et me jeta sur les chiottes.
«Ton heure est venue», me dis-je.
Il se mit à hurler convulsivement trois syllabes. Ma terreur était si grande que je ne comprenais pas: je pensais que ce devait être l'équivalent du «banzaï!» des kamikazes dans le cas très précis de la violence sexuelle.
Au sommet de la fureur, il continuait à crier ces trois sons. Soudain la lumière fut et je pus identifier ses borborygmes:
– No pêpâ! No pêpâ!
C'est-à-dire, en nippo-américain:
– No paper! No paper!
Le vice-président avait donc choisi cette manière délicate pour m'avertir qu'il manquait de papier dans ce lieu.
Je filai sans demander mon reste jusqu'au débarras dont je possédais la clef et revins en courant de mes jambes flageolantes, les bras chargés de rouleaux. Monsieur Omochi me regarda les placer, me hurla quelque chose qui ne devait pas être un compliment, me jeta dehors et s'isola dans le cabinet ainsi pourvu.
L'âme en lambeaux, j'allai me réfugier dans les toilettes des dames. Je m'accroupis dans un coin et me mis à pleurer des larmes analphabètes.
Comme par hasard, ce fut le moment que choisit Fubuki pour venir se brosser les dents. Dans le miroir, je la vis qui, la bouche mousseuse de dentifrice, me regardait sangloter. Ses yeux jubilaient.
L'espace d'un instant, je haïs ma supérieure au point de souhaiter sa mort. Songeant soudain à la coïncidence entre son patronyme et un mot latin qui tombait à point, je faillis lui crier: «Memento mori!»
Six ans plus tôt, j'avais adoré un film japonais qui s'appelait Furyo - le titre anglais était Merry Christmas, mister Lawrence. Cela se passait au cours de la guerre du Pacifique, vers 1944. Une bande de soldats britanniques étaient prisonniers dans un camp militaire nippon. Entre un Anglais (David Bowie) et un chef japonais (Ryuichi Sakamoto) se nouaient ce que certains manuels scolaires appellent des «relations paradoxales».
Peut-être à cause de mon très jeune âge d'alors, j'avais trouvé ce film d'Oshima particulièrement bouleversant, surtout les scènes de confrontation trouble entre les deux héros. Cela se terminait sur une condamnation à mort de l'Anglais par le Nippon.
L'une des scènes les plus délicieuses de ce long métrage était celle où, vers la fin, le Japonais venait contempler sa victime à demi morte. il avait choisi comme supplice d'ensevelir son corps dans la terre en ne laissant émerger que la tête exposée au soleil: cet ingénieux stratagème tuait le prisonnier de trois manières en même temps – la soif, la faim et l'insolation.
C'était d'autant plus approprié que le blond Britannique avait une carnation susceptible de rôtir. Et quand le chef de guerre, raide et digne, venait se recueillir sur l'objet de sa «relation paradoxale», le visage du mourant avait la couleur d'un roast-beef beaucoup trop cuit, un peu noirci. J'avais seize ans et il me semblait que cette façon de mourir était une belle preuve d'amour.
Je ne pouvais m'empêcher de voir une parenté de situation entre cette histoire et mes tribulations dans la compagnie Yumimoto. Certes, le châtiment que je subissais était différent. Mais j'étais quand même prisonnière de guerre dans un camp nippon et ma tortionnaire était d'une beauté au moins équivalente à celle de Ryuichi Sakamoto.
Un jour, comme elle se lavait les mains, je lui demandai si elle avait vu ce film. Elle acquiesça. Je devais être dans un jour d'audace car je poursuivis:
– Avez-vous aimé?
– La musique était bien. Dommage que cela raconte une histoire fausse.
(Sans le savoir, Fubuki pratiquait le révisionnisme soft qui est encore le fait de nombreux jeunes gens au pays du Soleil-Levant: ses compatriotes n'avaient rien à se reprocher quant à la dernière guerre et leurs incursions en Asie avaient pour but de protéger les indigènes contre les nazis. Je n'étais pas en position de discuter avec elle.)
– Je pense qu'il faut y voir une métaphore, me contentai-je de dire.
– Une… métaphore de quoi?
– Du rapport à l'autre. Par exemple, des rapports entre vous et moi.
Читать дальше