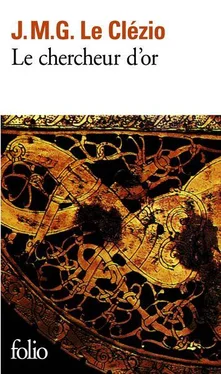Mais l’ennui que je ressens, et mon désir de fuir sont tels que Laure ne peut pas ne pas les voir. Un soir, elle m’attend à l’arrivée du train, à Curepipe, comme autrefois. La pluie fine de Forest Side a mouillé sa robe blanche et ses cheveux, et elle s’abrite sous une large feuille. Je lui dis qu’elle ressemble à Virginie, et cela la fait sourire. Nous marchons ensemble sur la route boueuse, avec les Indiens qui retournent chez eux avant la nuit. Tout à coup, Laure dit :
« Tu vas repartir, n’est-ce pas ? »
Je cherche une réponse qui la rassure, mais elle répète :
« Tu vas partir bientôt, n’est-ce pas ? Dis-moi la vérité. »
Sans attendre ma réponse, ou parce qu’elle la connaît, elle se met en colère :
« Pourquoi ne dis-tu rien ? Pourquoi faut-il que j’apprenne tout par les autres ? »
Elle hésite à dire cela, puis :
« Cette femme, là-bas, avec laquelle tu vis comme un sauvage ! Et ce stupide trésor que tu t’obstines à chercher ! »
Comment sait-elle cela ? Qui lui a parlé d’Ouma ?
« Jamais nous ne pourrons être comme avant, plus jamais il n’y aura de place pour nous ici ! »
Les paroles de Laure me font mal, parce que je sais qu’elles sont vraies. Je lui dis :
« Mais c’est pour cela qu’il faut que je parte. C’est pour cela que je dois réussir. »
Comment lui dire cela ? Déjà elle s’est reprise. Elle essuie les larmes qui coulent sur ses joues du revers de sa main, elle se mouche de façon enfantine. La maison de Forest Side est devant nous, sombre, pareille à un bateau échoué en haut de ces collines, à la suite d’un déluge.
Ce soir, après le dîner avec Mam, Laure est plus gaie. Sous la varangue, nous parlons du voyage, du trésor. L’air enjoué, Laure dit :
« Quand tu auras trouvé le trésor, nous viendrons te rejoindre là-bas. Nous aurons une ferme, nous travaillerons nous-mêmes, comme les pionniers du Transvaal. »
Alors, peu à peu nous rêvons tout haut, comme autrefois dans le grenier du Boucan. Nous parlons de cette ferme, des bêtes que nous aurons, car tout recommencera, loin des banquiers et des avocats. Parmi les livres de mon père, j’ai trouvé le récit de François Leguat, et je lis les passages où il est question de la flore, du climat, de la beauté de Rodrigues.
Attirée par le bruit de nos voix, Mam sort de sa chambre. Elle vient jusque dehors, et son visage éclairé par la lampe tempête de la varangue me semble aussi jeune, aussi beau qu’au temps du Boucan, lorsqu’elle nous expliquait les leçons de grammaire ou qu’elle nous lisait des passages de l’histoire sainte. Elle écoute nos paroles insensées, nos projets, puis elle nous embrasse, elle nous serre contre elle : « Tout cela, ce sont des rêves. »
Cette nuit-là, vraiment, la vieille maison en ruine de Forest Side est un bateau qui traverse la mer, qui va en tanguant et en craquant, dans le bruit doux de la pluie, vers l’île nouvelle.
En retrouvant le Zeta , il me semble que j’ai retrouvé la vie, la liberté, après tant d’années d’exil. Je suis à ma place de toujours, à la poupe, à côté du capitaine Bradmer assis sur son fauteuil vissé au pont. Cela fait deux jours déjà que nous allons vent arrière vers le nord-est, le long du 20 eparallèle. Quand le soleil est haut dans le ciel, Bradmer se lève de son fauteuil, et comme autrefois, il se tourne vers moi : « Voulez-vous essayer, monsieur ? »
Comme si nous n’avions pas cessé de naviguer ensemble tout ce temps-là.
Debout, pieds nus sur le pont, les mains agrippées à la roue, je suis heureux. Il n’y a personne sur le pont, seulement deux marins comoriens, la tête enveloppée dans leur voile blanc. J’aime entendre à nouveau le vent dans les haubans, voir la proue monter contre les vagues. Il me semble que le Zeta monte vers l’horizon, jusqu’à la naissance du ciel.
Je crois que c’est hier, quand j’allais pour la première fois vers Rodrigues, et que debout sur le pont, je sentais le navire bouger comme un animal, le passage sous l’étrave des lourdes vagues, le goût du sel sur mes lèvres, le silence, la mer. Oui, je crois que je n’ai jamais quitté cette place, à la barre du Zeta , poursuivant une croisière dont le but sans cesse recule, et que tout le reste n’a été qu’un rêve. Rêve de l’or du Corsaire inconnu, dans le ravin de l’Anse aux Anglais, rêve de l’amour d’Ouma, son corps couleur de lave, l’eau des lagons, les oiseaux de mer. Rêve de la guerre, les nuits glacées des Flandres, les pluies de l’Ancre, de la Somme, les nuages des gaz et les éclairs des obus.
Quand le soleil redescend derrière nous, et que je vois l’ombre des voiles sur la mer, le capitaine Bradmer reprend la barre. Debout, son visage rouge plissé à cause des reflets sur les vagues, il n’a pas changé. Sans que je le lui demande, il me raconte la mort du timonier.
« C’était en 1916, ou au début de 17, peut-être… On arrivait à Agalega, il est tombé malade. Fièvre, diarrhées, il délirait. Le médecin est venu voir, il a ordonné la quarantaine, parce que c’était le typhus… Ils avaient peur de la contagion. Il ne pouvait déjà plus manger ni boire. Il est mort le lendemain, le médecin n’était même pas revenu… Alors, monsieur, je me suis mis en colère. Puisqu’on ne voulait pas de nous, j’ai fait jeter toute la marchandise à la mer, devant Agalega, et nous sommes repartis vers le sud, jusqu’à Saint Brandon… C’était là qu’il avait dit qu’il voulait finir… Alors, on lui a accroché un poids aux pieds et on l’a jeté à la mer, devant les récifs, là où il y a cent brasses de fond, là ou l’eau est si bleue… Quand il a coulé, nous avons dit des prières, et moi j’ai dit : timonier, mon ami, te voilà chez toi, pour toujours. La paix soit avec toi. Et les autres ont dit : Amen… On est restes deux jours devant l’atoll, il faisait si beau, pas un nuage, et la mer si calme… On est restés à regarder les oiseaux, et les tortues qui nageaient près du bateau… On a péché quelques tortues, pour boucaner, et puis on est repartis. »
Sa voix est hésitante, couverte par le vent. Le vieil homme regarde droit devant lui, au-delà des voiles gonflées. Dans la lumière de la fin du jour, son visage est tout à coup celui d’un homme fatigué, indifférent à l’avenir. Maintenant, je comprends mon illusion : l’histoire est passée, ici comme ailleurs, et le monde n’est plus le même. Il y a eu des guerres, des crimes, des violations, et à cause de cela la vie s’est défaite.
« Maintenant, c’est drôle, je n’ai pas retrouvé de timonier. Lui, il savait tout de la mer, jusqu’à Oman… C’est comme si le bateau ne savait plus très bien où il va… C’est drôle, n’est-ce pas ? C’était lui le maître, il tenait le bateau dans ses mains… »
Alors, en regardant la mer si belle, le sillage éblouissant qui trace une route sur l’eau impénétrable, je ressens à nouveau l’inquiétude. J’ai peur d’arriver à Rodrigues, j’ai peur de ce que je vais y trouver. Où est Ouma ? Les deux lettres que je lui ai envoyées, la première de Londres, avant le départ pour les Flandres, la deuxième de l’hôpital militaire du Sussex, sont restées sans réponse. Sont-elles seulement arrivées ? Est-ce qu’on écrit aux manafs ?
La nuit, je ne descends pas dans la cale pour dormir. À l’abri des ballots arrimés sur le pont, je dors enroulé dans ma couverture, la tête sur mon sac de soldat, en écoutant les coups de la mer et le vent dans les voiles. Puis je me réveille, je vais uriner par-dessus le bastingage, et je retourne m’asseoir pour regarder le ciel plein d’étoiles. Comme il est long, le temps de la mer ! Chaque heure qui passe me lave de ce que je dois oublier, me rapproche de la figure éternelle du timonier. N’est-ce pas lui que je dois retrouver, à la fin de mes voyages ?
Читать дальше