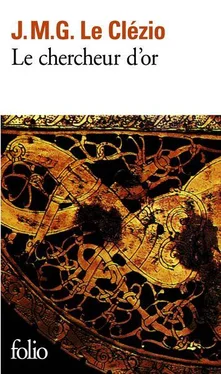Un après-midi, avec Laure, nous roulons au-delà des Quinze Cantons, et nous traversons la rivière du Rempart. Le chemin est si difficile que nous devons abandonner nos bicyclettes, cachées à la hâte au milieu des cannes. Malgré le soleil brûlant, le chemin ressemble par endroits à un torrent de boue, et nous devons nous déchausser. Comme autrefois, nous marchons pieds nus dans la boue tiède, et Laure a retroussé sa robe blanche à la manière d’une culotte indienne.
Le cœur battant, je vais au-devant, dans la direction des pics des Trois Mamelles qui dominent les champs de cannes comme d’étranges termitières. Le ciel, tout à l’heure si clair, s’est rempli de grands nuages. Mais nous n’y prenons pas garde. Mus par le même désir, nous marchons le plus vite que nous le pouvons à travers les feuilles aiguës des cannes, sans nous arrêter. La plantation cesse à la rivière Papayes. Après, ce sont les grands champs d’herbes où se dressent de loin en loin les tas de cailloux noirs, que Laure appelle les tombeaux des martyrs, à cause des gens qui sont morts en travaillant dans les champs de canne. Puis, au bout de cette steppe, entre les pics des Trois Mamelles, on arrive devant l’étendue des terres du bord de mer, de Wolmar jusqu’à Rivière Noire. Quand nous sommes au col, le vent de la mer nous frappe. De grands nuages roulent au-dessus de la mer. Le vent nous enivre après la chaleur des champs de canne. Nous restons un moment sans bouger, devant le paysage qui s’étend devant nous, comme si le temps n’avait pas passé, comme si c’était seulement hier que nous avions quitté le Boucan. Je regarde Laure. Son visage est dur et fermé, mais elle respire difficilement, et quand elle se tourne vers moi, je vois que ses yeux brillent de larmes. C’est la première fois qu’elle revoit la scène de notre enfance. Elle s’assoit dans l’herbe, et je m’installe à côté d’elle. Nous regardons sans parler ces collines, les ombres des ruisseaux, les dénivellations du terrain. En vain je cherche notre maison, près des bords de la rivière Boucan, derrière la Tourelle du Tamarin. Toute trace d’habitation a disparu, et, à la place des fourrés, il y a de grandes friches brûlées. C’est Laure qui parle la première, comme pour répondre aux questions que je me pose.
« Notre maison n’est plus là, l’oncle Ludovic a tout fait raser depuis longtemps, pendant que tu étais à Rodrigues, je crois. Il n’a même pas attendu que le jugement soit rendu. »
La colère étrangle ma voix :
« Mais pourquoi, comment a-t-il osé ? »
« Il a dit qu’il voulait utiliser les terres pour la canne, qu’il n’avait pas besoin de la maison. »
« Quelle lâcheté ! Si j’avais su cela, si j’avais été là… »
« Qu’est-ce que tu aurais fait ? On ne pouvait rien faire. J’ai tout caché à Mam, pour ne pas la bouleverser davantage. Elle n’aurait pas supporté tant d’acharnement à faire disparaître notre maison. »
Les yeux brouillés, je regarde l’étendue magnifique devant moi, la mer qui étincelle sous le soleil qui s’approche, et l’ombre de la Tourelle du Tamarin qui s’allonge. À force de scruter les rives du Boucan, il me semble que je vois quelque chose, comme une cicatrice parmi les broussailles, là où étaient la maison et le jardin, et la tache sombre du ravin où nous allions rêver, perchés sur le vieil arbre. Laure parle encore, pour me consoler. Sa voix est calme, son émotion est maintenant passée.
« Tu sais, cela n’a plus d’importance que la maison ait disparu. C’est si loin maintenant, c’est une autre vie. Ce qui compte c’est que tu sois revenu, et puis Mam est bien vieille, elle n’a que nous. Qu’est-ce que c’est, une maison ? Une vieille baraque percée où il pleuvait, rongée par les carias ? Il ne faut pas regretter ce qui n’existe plus. »
Mais moi, la voix assourdie, pleine de rage :
« Non, je ne peux pas l’oublier, je ne l’oublierai jamais ! »
Interminablement, je regarde le paysage figé sous le ciel mobile. Je scrute chaque détail, chaque point d’eau, chaque bosquet, depuis les gorges de la Rivière Noire jusqu’au Tamarin. Sur le rivage, il y a des fumées, du côté de Grande Rivière Noire, de Gaulette. Peut-être que Denis est là, comme autrefois dans la case du vieux Cook, et il me semble qu’à force de regarder, avec cette lumière dorée qui illumine le rivage et la mer, je vais deviner les ombres des enfants que nous étions, en train de courir à travers les hautes herbes, pieds nus, visages griffés, habits déchirés, dans ce monde sans limites, guettant dans le crépuscule le vol des deux pailles-en-queue au-dessus du mystère de Mananava.
L’ivresse du retour est bien vite passée. D’abord il y a eu cette place dans les bureaux de W. W. West, cette place que j’avais occupée il y a longtemps, et que l’on feignait de croire que j’avais quittée pour aller à la guerre. L’odeur de la poussière à nouveau, la chaleur moite qui filtrait à travers les volets avec le brouhaha de Rempart Street. Les employés, indifférents, les clients, les marchands, les comptables… Pour tous ces gens, il ne s’était rien passé. Le monde n’avait pas bougé. Pourtant, un jour, en 1913, me racontait Laure, du temps que j’étais à Rodrigues, le peuple affamé, réduit à la misère par les cyclones, s’était massé devant la gare : une foule d’Indiens, de Noirs, venus des plantations, des femmes en gunny avec leurs enfants dans les bras, tous, sans crier, sans faire de bruit, ils s’étaient réunis devant la gare, et ils avaient attendu l’arrivée du train des hauts, celui qui amène chaque jour de Vacoas et de Curepipe les Blancs, propriétaires des banques, des magasins, des plantations. Ils les avaient attendus longtemps, patiemment d’abord, puis au fur et à mesure que le temps passait, avec plus de rancœur, plus de désespoir. Que se serait-il passé si les Blancs étaient venus ce jour-là ? Mais, prévenus du danger, les Blancs n’avaient pas pris le train pour Port Louis. Ils étaient restés chez eux, en attendant que la police règle l’affaire. Alors la foule avait été dispersée. Il y avait peut-être eu quelques magasins chinois pillés, des pierres dans les vitres du Crédit Foncier ou même de W. W. West. Et tout avait été réglé.
Dans les bureaux règne mon cousin Ferdinand, le fils de l’oncle Ludovic. Il affecte de ne pas me connaître, de me traiter comme son serviteur. La colère monte en moi, et si je résiste à l’envie de le bousculer, c’est à cause de Laure, qui aimerait tant que je reste. Comme autrefois, chaque instant libre, je le consacre à marcher sur les quais du port, au milieu des marins et des dockers, près du marché au poisson. Ce que je voudrais par dessus tout, c’est revoir le Zeta , le capitaine Bradmer et le timonier comorien. Longtemps j’ai attendu, à l’ombre des arbres de l’Intendance, espérant voir arriver le schooner, avec son fauteuil rivé sur le pont C’est en moi déjà, je sais que je repartirai.
Dans ma chambre, à Forest Side, le soir, j’ouvre la vieille cantine rouillée par les séjours à l’Anse aux Anglais, et je regarde les papiers du trésor, les plans, les croquis et les notes que j’ai accumulés, et que j’ai renvoyés de Rodrigues avant de partir pour l’Europe. Quand je les regarde, c’est Ouma que je vois, son corps plongeant d’un trait dans la mer, nageant libre, son long harpon à la pointe d’ébène à la main.
Chaque jour grandit en moi le désir de retourner à Rodrigues, de retrouver le silence et la paix de cette vallée, le ciel, les nuages, la mer qui n’appartiennent à personne. Je veux fuir les gens du « grand monde », la méchanceté, l’hypocrisie. Depuis que le Cernéen a fait paraître un article sur « Nos héros de la guerre mondiale », dans lequel mon nom est cité, et où l’on m’attribue des actes de bravoure purement imaginaires, nous voilà tout à coup, Laure et moi, sur toutes les listes d’invités aux fêtes, à Port Louis, à Curepipe, à Floréal. Laure m’accompagne, vêtue de sa même robe blanche usée, nous causons et nous dansons. Nous allons au Champ-de-Mars, ou bien prendre le thé à la Flore. Je pense sans cesse à Ouma, aux cris des oiseaux qui passent chaque matin au-dessus de l’Anse. Ce sont les gens d’ici qui me semblent imaginaires, irréels. Je suis las de ces faux honneurs. Un jour, sans prévenir Laure, je laisse à Forest Side mon complet gris d’employé de bureau, et je m’habille avec la vieille veste kaki et le pantalon que j’ai ramenés de la guerre, salis et déchirés par les séjours dans les tranchées, ainsi que mes insignes d’officier et mes décorations, la M.M. et la D.C.M., et l’après-midi, à la fermeture des bureaux de W, W. West, toujours avec ce déguisement, je vais m’asseoir dans le salon de thé de la Flore, après avoir bu quelques verres d’arak. C’est à partir de ce jour-là que les invitations du beau monde ont cessé comme par enchantement.
Читать дальше