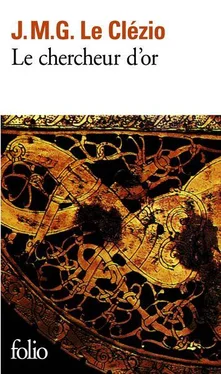Cette nuit-là, personne n’a dormi vraiment. Sur le pont, les hommes ont parlé et fumé toute la nuit, et le timonier est resté assis à la poupe, à regarder les reflets des étoiles sur les eaux de l’atoll. Même le capitaine est resté à veiller, assis dans son fauteuil. De ma place, près du mât de misaine, je vois la braise de sa cigarette briller de temps en temps. Le vent de la mer emporte les paroles des marins, les mêle à la rumeur des vagues sur les brisants. Ici le ciel est immense et pur, comme s’il n’y avait pas d’autre terre au monde, que tout allait commencer.
Je dors un peu, la tête appuyée sur mon bras, et quand je me réveille, c’est l’aurore. La lumière est transparente, pareille à l’eau du lagon, couleur d’azur et de nacre, depuis le Boucan je n’ai pas vu de matin aussi beau. La rumeur de la mer a augmenté, elle semble le bruit de la lumière du jour. Regardant autour de moi, je vois que la plupart des marins dorment encore, comme le sommeil les a pris, couchés sur le pont, ou assis contre le bastingage. Bradmer n’est plus dans son fauteuil. Peut-être est-il en train d’écrire dans son alcôve. Seul le timonier noir est debout à la même place, à la poupe. Il regarde le lever du jour. Je m’approche de lui pour lui parler, mais c’est lui qui dit :
« Est-ce qu’il y a un endroit plus beau dans le monde ? »
Sa voix est enrouée, celle d’un homme troublé par l’émotion.
« Quand je suis venu ici pour la première fois, j’étais encore un enfant. Maintenant, je suis un vieil homme, mais ici rien n’a changé. Je pourrais croire que c’était hier. »
« Pourquoi le capitaine est-il venu ici ? »
Il me regarde comme si ma question n’avait pas de sens.
« Mais c’est pour vous ! Il voulait que vous voyiez Saint Brandon, c’est une faveur qu’il vous a faite. »
Il hausse les épaules et n’en dit pas plus. Il sait sans doute que je n’ai pas accepté de rester à bord du Zeta , et pour cela je ne l’intéresse plus. Il se replonge dans la contemplation du soleil qui se lève sur l’immense atoll, de la lumière qui semble jaillir de l’eau et monter vers le ciel sans nuages. Les oiseaux sillonnent le ciel, cormorans rasant l’eau où glissent leurs ombres, pétrels haut dans le vent, minuscules points d’argent tourbillonnant. Ils tournent, se croisent, crient et caquettent si fort qu’ils réveillent les hommes sur le pont, qui se mettent à parler à leur tour.
Plus tard, j’ai compris pourquoi Bradmer a fait escale à Saint Brandon. La pirogue est mise à la mer, avec six hommes de l’équipage. Le capitaine est à la barre, et le timonier debout à l’avant, un harpon à la main. La pirogue glisse sans bruit sur l’eau du lagon, vers Perle. Penché à l’avant de la pirogue, près du timonier, j’aperçois bientôt les taches sombres des tortues, près de la plage. Nous approchons d’elles en silence. Quand la pirogue arrive sur elles, elles nous aperçoivent, mais il est trop tard. D’un geste vif, le timonier lance le harpon qui traverse en crissant la carapace, et le sang jaillit. Aussitôt, avec un cri sauvage, les hommes souquent et la pirogue file vers le rivage de l’île, entraînant la tortue. Quand la pirogue est près de la plage, deux marins sautent à l’eau, décrochent la tortue et la renversent sur la plage.
Déjà, nous repartons vers le lagon, où les autres tortues attendent sans crainte. Plusieurs fois, le harpon du timonier transperce les carapaces des tortues. Sur la plage de sable blanc, le sang coule en ruisseaux, trouble la mer. Il faut faire vite avant que l’odeur du sang n’attire les requins, qui chasseront les tortues vers les hauts fonds. Sur la plage blanche, les tortues achèvent de mourir. Il y en a dix. À coups de sabre d’abattage, les marins les dépècent, alignent sur le sable les quartiers de viande. Les morceaux sont embarqués dans la pirogue pour être fumés à bord du navire, parce qu’il n’y a pas de bois dans les îles. Ici la terre est stérile, un lieu où viennent mourir les créatures de la mer.
Quand la boucherie est terminée, tout le monde embarque dans la pirogue, les mains ruisselantes de sang. J’entends les cris aigus des oiseaux qui se disputent les carapaces des tortues. La lumière est aveuglante, je ressens un vertige. J’ai hâte de fuir cette île, ce lagon souillé de sang. Le reste du jour, sur le pont du Zeta , les hommes s’affairent autour du brasero où grillent les quartiers de viande. Mais je ne peux oublier ce qui s’est passé, et ce soir-là, je refuse de manger. Demain matin, à l’aube, le Zeta quittera l’atoll, et il ne restera rien de notre passage, que ces carapaces brisées et déjà nettoyées par les oiseaux de mer.
Dimanche, en mer
Il y a si longtemps que je suis parti ! Un mois, peut-être plus ? Jamais je ne suis resté si longtemps sans voir Laure, sans Mam. Quand j’ai dit adieu à Laure, quand je lui ai parlé pour la première fois de mon voyage vers Rodrigues, elle m’a donné l’argent de ses économies pour m’aider à payer mon passage. Mais j’ai lu dans ses yeux cet éclair sombre, cette lumière de colère, qui disaient : nous ne nous reverrons peut-être jamais. Elle m’a dit adieu, et non pas au revoir, et elle n’a pas voulu m’accompagner jusqu’au port. Il a fallu tous ces jours en mer, cette lumière, cette brûlure du soleil et du vent, ces nuits, pour que je comprenne. Maintenant je sais que le Zeta m’emporte vers une aventure sans retour. Qui peut connaître sa destinée ? Il est écrit ici, le secret qui m’attend, que nul autre que moi ne doit découvrir. Il est marqué dans la mer, sur l’écume des vagues, dans le ciel du jour, dans le dessin immuable des constellations. Comment le comprendre ? Je pense encore au navire Argo , comme il allait sur la mer inconnue, guidé par le serpent d’étoiles. C’était lui qui accomplissait sa propre destinée, et non les hommes qui le montaient. Qu’importaient les trésors, les terres ? N’était-ce pas le destin qu’ils devaient reconnaître, certains dans les combats, ou la gloire de l’amour, d’autres dans la mort ? Je pense à Argo , et le pont du Zeta est autre, se transfigure. Et ces marins comoriens, indiens, à la peau sombre, le timonier toujours debout devant sa roue, son visage de lave où les yeux ne cillent pas, et même Bradmer, avec ses yeux plissés et sa face d’ivrogne, est-ce qu’ils n’errent pas depuis toujours, d’île en île, à la recherche de leur destinée ?
Est-ce la réverbération du soleil sur les miroirs mouvants des vagues qui m’a troublé la raison ? II me semble être hors du temps, dans un autre monde, si différent, si loin de tout ce que j’ai connu, que jamais plus je ne pourrai retrouver ce que j’ai laissé. C’est pour cela que je sens ce vertige, cette nausée : j’ai peur d’abandonner ce que j’ai été, sans espoir de retour. Chaque heure, chaque jour qui passe est semblable aux vagues de la mer qui courent contre l’étrave, soulèvent brièvement la coque, puis disparaissent dans le sillage. Chacune m’éloigne du temps que j’aime, de la voix de Mam, de la présence de Laure.
Le capitaine Bradmer est venu vers moi ce matin, à la poupe du navire :
« Demain ou après-demain, nous serons à Rodrigues. »
Je répète :
« Demain ou après-demain ? »
« Demain, si le vent se maintient. »
Ainsi le voyage s’achève. Pour cela sans doute tout me semble différent.
Les hommes ont fini la provision de viande. Pour moi, je me suis contenté du riz épicé, cette chair me faisant horreur. Chaque soir, depuis quelques jours, je sens venir la fièvre. Enroulé dans ma couverture, je grelotte à fond de cale, malgré la chaleur torride. Que faire, si mon corps m’abandonne ? Dans la malle, j’ai trouvé le flacon de quinine acheté avant de partir, et j’avale un cachet avec ma salive.
Читать дальше