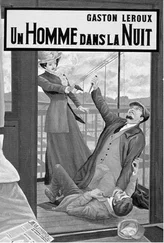— Un vieux camarade du parti a été retrouvé assassiné dans son appartement d’une villa de Dahlem. Un de ceux dont le numéro d’adhérent est à quatre chiffres, vous comprenez ce que je veux dire.
Langenstras durcit son regard.
— Eh oui, Kälterer, malgré tous nos efforts, nous autres anciens de la police criminelle n’arriverons jamais à être aussi infects que lui !
Il lui sourit d’un air complice, mais se reprit vite :
— De toute manière, c’est scandaleux : un combattant de la première heure est supprimé sans plus de façons, et dans la capitale du Reich qui plus est. Vous pouvez vous imaginer l’indignation chez les faisans dorés du parti.
Il hocha la tête en signe d’approbation. Langenstras resservit du cognac. Ils levèrent leur verre.
— Il faut absolument que nous trouvions les coupables. Où irions-nous si n’importe quels conjurés pouvaient assassiner, et en plein jour encore, d’importantes personnalités ! Nous n’avons pas balayé dans tous les coins en 33–34, et voilà le résultat ! Je vous l’avoue bien sincèrement : nous avons mené une enquête, mais n’avons trouvé aucun mobile politique à ce meurtre. La police criminelle pense qu’il s’agit d’une affaire privée, mais en haut lieu personne ne se contente de cette explication, on nous demande donc de poursuivre les investigations. Ils me mettent sous pression. Mes hommes sont bons quand il s’agit d’organiser des poursuites ou de mener à bien des interrogatoires poussés, mais ils n’entendent pas grand chose au vrai travail de détective. Bref, Sturmbannführer, les discours les plus courts étant les meilleurs, je voudrais que vous vous occupiez de cette affaire.
Élucider un meurtre, un vrai travail de flic, un travail de police classique, comme par le passé, tout cela avait l’air trop beau pour être vrai. Il ne serait plus obligé de vivre dans la poussière et la boue. C’était l’occasion ou jamais d’abandonner enfin le sale boulot. Arrêter un meurtrier, imposer l’ordre et la loi, comme à ses débuts dans la police berlinoise. Il reprit prudemment une gorgée de cognac.
— Vous êtes l’homme qu’il nous faut, Sturmbannführer. Votre dossier plaide pour vous, reprit Langenstras.
— Gruppenführer, je me sens flatté, oui, flatté. J’accepte avec plaisir les tâches qui me sont confiées, où qu’on m’envoie, partout où je peux servir notre Führer et l’Allemagne dans ces heures diff…
— Affaire conclue donc. (Langenstras se leva.) Emportez le dossier, plongez-vous dedans et, avant tout, je veux des résultats.
— Une question, Gruppenführer.
Langenstras haussa le sourcil gauche.
— Comment dois-je m’y prendre ?
— Que voulez-vous dire ? Vous êtes un professionnel et vous savez comment on enquête.
Il devint plus direct.
— Je veux dire, si mes investigations rejoignaient celles de la police criminelle et qu’on ne découvre aucun mobile politique ?
— Amenez-moi un coupable et nous verrons bien !
Langenstras se tourna vers la porte.
— Je suis très occupé. Je vous prie de m’excuser, Sturmbannführer, mais il faut que je mette fin à cet entretien. On a déjà emménagé vos affaires dans un petit hôtel. Nous n’avons malheureusement pas trouvé de meilleur cantonnement. Il faut que nous nous serrions tous un peu les coudes. Vous travaillerez seul, mais vous aurez une voiture de fonction avec chauffeur, elle vous attend d’ailleurs en bas. Nous avons aussi trouvé un bureau pour vous ; comme le logement, il n’est pas tout à fait à la hauteur de votre grade, et je m’en excuse par avance. Vous avez aussi une secrétaire. Bideaux vous informera de tout le reste.
Langenstras ouvrit la porte et le prit par l’épaule.
— Au revoir, Sturmbannführer, et avec des résultats appropriés. Faites-vous d’abord conduire à l’hôtel. Reprenez des forces avec une bouteille de riesling. Elle vous attend déjà.
Kälterer fit un salut réglementaire.
— Ah ! j’y pense : saluez votre épouse de ma part.
Et Langenstras disparut derrière la porte du bureau qui claqua. Kälterer regarda autour de lui. Nulle trace de Bideaux. Il descendit lentement le large escalier, posant prudemment le pied de la jambe blessée, s’efforçant de peser dessus le moins possible. Dans son dossier personnel, il y avait donc aussi des renseignements sur sa vie privée. Peu importait après tout. Dans un premier temps, il pouvait rester à Berlin, se consacrer à une chasse à l’homme dans la grande ville, retrouver son premier métier. Le travail honnête, propre et socialement utile d’un fonctionnaire de police.
Ce fut seulement après avoir examiné plus attentivement l’appareil qu’il comprit : il fallait fixer au dos le petit câble que le vendeur lui avait donné et qui servait d’antenne. Il venait de troquer cette espèce de petite caisse en bois brun dans une centrale d’échanges, contre six bocaux de compote de pommes que Lotti avait préparés à l’automne 1940, comme en faisaient foi les étiquettes. De retour dans son refuge, il avait tenu à immédiatement écouter la radio. Il voulait se tenir au courant, connaître tous les jours la situation du front, savoir comment la guerre évoluait, combien de temps il lui restait encore. Mais la réception avait été si mauvaise qu’il crut avoir été berné.
Il fixa le câble au mur de la cabane avec une punaise et le crachotement cessa. Il reconnut distinctement une voix à l’accent brandebourgeois qui émanait du récepteur populaire patriotique.
« Le commandement suprême de la Wehrmacht annonce… En Hollande, dans la région d’Arnheim, les troupes aéroportées ennemies ont été assiégées de toutes parts par des mouvements concentriques. Bien soutenues par des escadrilles d’avions de chasse, nos troupes ont infligé de lourdes pertes à l’ennemi, en hommes et en matériel. Nous avons fait à ce jour mille sept cents prisonniers… »
Arnheim ? Il n’avait aucune idée de l’endroit où cela pouvait être. Il essaya vainement de se représenter une carte de la Hollande. Le dessin des côtes, les fleuves et les villes, tout cela restait trop vague. Mais il comprit néanmoins une chose : l’ennemi serait bientôt sur le sol allemand, la guerre ne durerait plus très longtemps. Il n’avait plus de temps à perdre. Seule la guerre lui donnait la garantie nécessaire à la réalisation complète de ses plans. Il ne se souciait pas de savoir jusqu’à quel point elle menaçait aussi sa propre vie : il n’avait plus rien à perdre. Quand il en aurait fini, ils pouvaient bien le coller contre un mur ou le pendre à un crochet de boucher, il prendrait ça avec le sourire. Une seule chose lui serait inacceptable : qu’ils le jettent de nouveau en prison ou le déportent dans un camp. Ça, jamais — absolument plus jamais.
« Au nord-ouest de La Chapelle, l’ennemi a réussi à poursuivre son avance, soutenu par de nombreux panzers. Au nord-est, toutes les attaques ont été vigoureusement repoussées, en partie au prix de lourdes pertes pour l’ennemi. Notre contre-offensive gagne lentement du terrain… »
La Chapelle, la ville préférée de Charlemagne, le palais, la cathédrale avec son chœur et son immense lustre, le trône de marbre du fondateur de l’empire, la salle du couronnement dans le vieil hôtel de ville, les fontaines élyséennes. Peu de temps avant leur mariage, il avait visité la ville avec Lotti quand ils étaient allés passer le week-end à Eschweiler où il avait demandé sa main. Ses futurs beaux-parents étaient bien disposés envers lui, se demandant toutefois si Lotti, et ses dix-huit ans, n’était pas trop jeune pour se marier. Il leur exposa qu’une année auparavant, au décès de son père, il avait repris le magasin, pouvait donc se vanter d’économies substantielles et de revenus au-dessus de la moyenne. Ils furent convaincus. Et après que sa mère eut déménagé à Guben pour aider sa sœur célibataire à la ferme de ses grands-parents, il avait repris le grand appartement familial de la Sophienstrasse.
Читать дальше