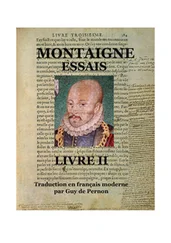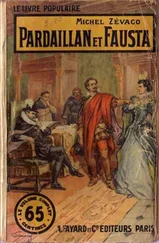– Prenez donc cette lettre, continua l’abbesse; celle à qui vous allez la porter vous récompensera mieux que je ne pourrais le faire; car je ne vous apprends rien, ma sœur, en vous disant que je suis bien pauvre, hélas! Votre récompense consistera donc à devenir aujourd’hui ma messagère… Seulement prenez garde que si vous perdiez cette missive ou si quelqu’un vous l’enlevait, ce serait un grand malheur pour moi, donc pour l’abbaye, donc pour vous-même.
Mariange prit la lettre, la cacha dans son sein et dit:
– Ici on ne viendra pas la prendre!
– En effet! murmura Claudine avec un sourire.
Et elle se hâta de donner à Mariange les instructions nécessaires pour que la lettre pût parvenir à destination. Sœur Mariange se mit en route aussitôt et, entrant dans Paris, se dirigea par les chemins que l’abbesse lui avait expressément désignés. Nous avons dit qu’elle ne savait pas lire. Mais si elle avait été lettrée au point de pouvoir épeler la suscription de la lettre, voici ce qu’elle aurait lu:
– À Madame la princesse Fausta, en son palais.
Cependant, comme Mariange l’avait ou ne l’avait pas remarqué, Paris s’agitait, et cette agitation demeurée sourde les jours précédents, menaçait d’éclater. Voici ce qui se passait:
La noblesse, étonnée de l’inertie de Guise, commençait à prendre peur. De sinistres rumeurs circulaient de bouche en bouche. On se répétait sous le manteau que le chef suprême de la Ligue trahissait. La journée des Barricades, assuraient les plus audacieux, n’avait été qu’un jeu pour effrayer Henri III: jeu terrible, où beaucoup de gentilshommes risquaient leurs têtes!… Henri de Guise ayant ainsi démontré sa puissance à Valois, songeait à le ramener dans Paris, sûr alors d’obtenir quelque chose comme une vice-royauté qui lui assurerait les brillants avantages du pouvoir exercé sous le nom d’un autre. Voilà quels bruits couraient parmi les plus compromis de la noblesse. Il était trop évident que si la paix se faisait entre les deux Henri, elle se ferait à leurs dépens.
Les bourgeois, de leur côté, recommençaient les patrouilles armées et faisaient entendre ces murmures précurseurs de l’émeute. L’affaire du moulin de la butte Saint-Roch avait, par surcroît, envenimé les esprits. Les Parisiens, en effet, étaient persuadés qu’une troupe nombreuse de parpaillots était cachée dans le moulin et étudiait la possibilité de surprendre la ville; on disait que le roi de Navarre s’approchait avec une armée. Or, le moulin ayant été pris d’assaut, on n’avait trouvé personne: qu’étaient devenus les huguenots, cette troupe cachée qui était comme une avant-garde du Béarnais? Ils avaient fui… Mais comment?…
À coup sûr les bourgeois, plus fanatiques de Guise que la noblesse, n’accusaient pas leur duc; mais ils jugèrent prudent de veiller, c’est-à-dire qu’ils se répandirent dans les rues ce qui accrut l’agitation, en sorte que le lendemain même du jour où Charles d’Angoulême et Pardaillan s’étaient rendus à l’abbaye de Montmartre, le lendemain de ce jour où sœur Mariange fut chargée par Claudine de porter une lettre à Fausta, l’agitation était à son comble.
Ce jour-là, donc, vers quatre heures de l’après-midi, le duc de Guise était enfermé dans son cabinet avec Maurevert. Le duc se préoccupait fort peu de l’émotion des Parisiens; il savait qu’il n’avait qu’à parler pour être acclamé, et à parler pour être cru comme le Messie. Du moins, jusqu’à ce moment, il ne s’était pas inquiété de ces rumeurs qui, passant par-dessus les têtes des six cents gardes qui emplissaient les murs, arrivaient parfois jusqu’à lui.
Guise était sombre. Pour lui, comme pour Charles d’Angoulême, Violetta était perdue. Il n’avait plus à s’inquiéter des trahisons de sa femme Catherine de Clèves; Catherine ne pouvant le tromper qu’au fond de sa lointaine province et non sous les yeux de la cour, la trahison ne comptait plus pour Guise. Dès lors, cette passion qui s’était abattue sur lui, pareille à une irrésistible tempête, était seule à le bouleverser à la fois dans son esprit, ses sens et son cœur.
Il allait et venait dans le vaste et somptueux salon qui lui servait de cabinet. La tête penchée sur la poitrine, les mains croisées au dos, un rude soupir lui échappait parfois, et il n’écoutait Maurevert que d’une oreille distraite. En effet, Maurevert lui rendait compte de l’état de Paris, de la colère qui commençait à gronder, de l’impatience des bourgeois, des soupçons de plusieurs gentilshommes qu’il nommait… Maurevert lui parlait de tout ce qui eût dû l’intéresser, mais dont il se souciait peu à ce moment, et Maurevert ne parlait pas du seul être qui occupât la pensée de Guise… Violetta ni de la seule chose qui l’intéressât réellement… son amour!
Pourtant Guise dressa tout à coup les oreilles et s’arrêta devant Maurevert, lorsque celui-ci en vint à prononcer un nom. Ce nom, c’était celui du chevalier de Pardaillan.
– Eh bien? dit-il, l’as-tu retrouvé? Sais-tu où il se cache?
– Hélas! non, monseigneur.
– Et le bâtard d’Angoulême? reprit Guise.
– Monseigneur, si nous retrouvons le Pardaillan, nous mettrons du même coup la main sur Charles.
– Ils auront quitté Paris…
Maurevert secoua la tête.
– Ah! continua amèrement le duc, si tu haïssais cet homme, ce misérable Pardaillan comme je le hais…
L’œil de Maurevert étincela.
– Tu ne l’aurais pas perdu de vue ni laissé sortir de Paris!
– Monseigneur, j’ai la conviction que Pardaillan n’a pas quitté Paris.
– Qui te le fait croire?
Maurevert frissonna, jeta un regard d’angoisse autour de lui, comme s’il se fût attendu à voir soudain paraître celui qu’il redoutait, et il murmura:
– Tant que je serai à Paris, il y sera…
– Je ne te comprends pas, dit Guise d’un air narquois; mais je ne veux me souvenir que d’une chose: c’est que sur notre prise de la butte Saint-Roch, tu devais toucher deux cent mille livres, et que ces deux cent mille livres, tu les abandonnais pour avoir la joie de voir Pardaillan mort une bonne fois…
Ces paroles ramenèrent brusquement le duc au souvenir cuisant de la déception que Pardaillan lui avait ménagée. Il eut un geste de rage.
– Puisque cet homme est à Paris, puisque tu le hais, que ne le cherches-tu?… Aurais-tu peur… toi!
Maurevert pâlissant cherchait une réponse, lorsque le valet familier de Guise ouvrit la porte et annonça que Bussi-Leclerc, le gouverneur de la Bastille, venait d’arriver.
– Qu’il entre! qu’il entre!… Lui aussi doit avoir une dent féroce contre le Pardaillan, et il nous aidera…
– Monseigneur, fit en entrant Bussi-Leclerc qui avait entendu, pour ce qui est de la dent que vous dites, je vous la garantis, longue, aiguë et solide.
– Te voilà, mon pauvre crucifié, ricana le duc qui était sans pitié pour les mésaventures des autres, comment vas-tu? Par la barbe du pape, sais-tu que tu faisais une plaisante figure sur ton aile de moulin! Et Maineville! En poussait-il des cris! J’en ris encore lorsque j’y pense…
– Le spectacle devait être assurément fort galant, dit Bussi glacial.
– Ne te fâche pas, dit le duc en riant plus fort. Je te revois encore les pieds au ciel, la tête en bas, roulant des yeux terribles… allons, ne grince pas des dents, c’est moi qui t’ai détaché… il était temps, hein? tu t’es évanoui dans mes bras, toi le fort des forts!
– Hé, monseigneur, j’aurais voulu vous voir à ma place! Ficelé sur l’aile de l’infernal moulin… Le monde tournoyait, le ciel et la terre se confondaient dans un tourbillon… Je vous jure que c’était atroce.
Читать дальше