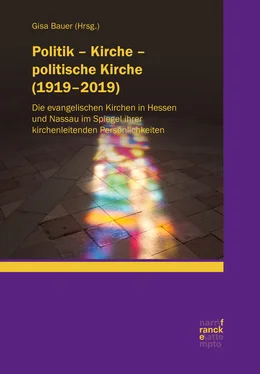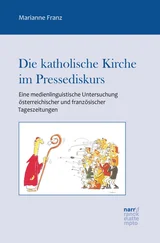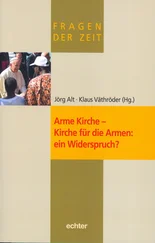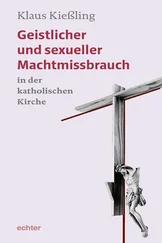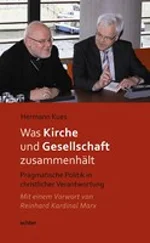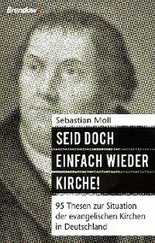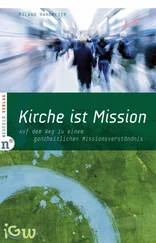Au niveau de la connaissance par intentionnalité l’acte cognitif minimal est l’acte de représentation qui représente son objet sans recourir à des concepts (perception, imagination, etc.). Un tel acte est la condition de possibilité d’une connaissance plus élaborée, la connaissance propositionnelle, qui elle se sert de concepts. J’appelle maintenant connaissance positive une connaissance propositionnelle qui décrit des actes de représentation non-propositionnels. La connaissance négative est elle aussi propositionnelle, mais dans le cadre qui nous intéresse, nous allons le voir, elle décrit des aspects de la conscience qui échappent à la représentation. La connaissance négative porte sur l’irreprésentable.
Essayons maintenant d’appliquer l’idée de connaissance positive au cas de la conscience de soi. Toute conscience de soi implique une certaine connaissance de soi. D’ordinaire, on entend par là une connaissance propositionnelle du genre : « Je sais que… », la proposition qui suit ces mots introductifs décrivant un acte que j’accomplis (je sais que je l’insulte), un état (je sais que je suis déprimé) ou bien le fait que je me saisis comme une entité restant identique à travers une multitude d’actes ou d’états. Dans tous ces cas, la structure de la conscience de soi est ce « je sais que » auquel s’ajoute une proposition. Il y a le flux des vécus de premier ordre, le fait d’accomplir un acte, de se sentir dans tel ou tel état, de penser ceci ou cela, et il y a un acte de second ordre qui consiste à se pencher sur le flux de premier ordre, à se recourber sur lui en quelque sorte. C’est ce que j’entends par acte de réflexion. Par un acte de réflexion, la conscience se fait elle-même objet de façon à se représenter ses propres actes, actes qui eux-mêmes contiennent des représentations, de façon donc à se représenter ses propres représentations. Une telle conscience de soi, nous pouvons l’appeler connaissance positive de soi.
2.2. Connaissance négative de soi
Cependant un problème se pose si l’on veut restreindre la conscience de soi à un acte de réflexion débouchant sur une connaissance propositionnelle positive, autrement dit, si l’on essaie de l’expliquer entièrement par ce qu’on peut appeler le « modèle de réflexion » (c’est l’école de Heidelberg qui utilise le terme de Reflexionsmodell ou de Reflexionstheorie ). Ce problème a déjà été thématisé par Fichte qui figure d’ailleurs comme auteur de référence pour l’école de Heidelberg1. Mais laissons ici Fichte de côté. Le problème qui se pose est le suivant. En réfléchissant sur lui-même, un sujet se représente lui-même. Mais d’où sait-il que l’objet intentionnel qu’il se représente est bien lui-même ? D’où sait-il que celui qui se sent déprimé, c’est lui-même, que celui qui vient d’insulter son voisin, c’est lui-même, que le moi qui reste identique à travers une multitude d’actes et d’états, c’est son moi à lui ? Si la conscience de soi, selon le modèle de réflexion, n’est autre chose que la production de représentations de soi, comment le sujet peut-il alors savoir que l’objet représenté est vraiment lui-même et non pas quelqu’un d’autre, à moins qu’il ne sache déjà, indépendamment de l’acte de représentation, que ce qui est représenté, c’est lui-même ?
Ce problème se pose, peu importe le rapport temporel entre le flux vécu de premier ordre, ou disons un acte intentionnel particulier parmi ce flux, et l’acte de réflexion comme acte de second ordre. Si – première possibilité – on part de l’idée qu’on se dirige d’abord vers un objet intentionnel, pour ensuite, donc avec un décalage temporel, prendre conscience de cet acte de premier ordre, il est incompréhensible que l’on puisse réfléchir sur un tel acte qui, pendant qu’il est accompli, échappe totalement à notre attention. On ne peut pas, par après, se rendre conscient de quelque chose dont on n’était pas déjà conscient pendant qu’on l’accomplissait. Dans L’Être et le Néant , Jean-Paul Sartre a bien vu le problème en écrivant : « On ne peut pas supprimer d’abord la dimension ‘conscience’, fût-ce pour la rétablir ensuite2. » Manfred Frank l’exprime ainsi :
Par la conscience de soi intentionnelle […] je me rapporte à quelque chose de déjà conscient, quelque chose qui n’acquiert pas l’état de conscience seulement au moment où je l’introduis dans le faisceau lumineux de mon savoir propositionnel. La réflexion ne peut découvrir que ce qui est déjà3.
La réflexion ne peut pas générer la conscience de soi.
Si par contre – deuxième possibilité – on conçoit l’acte intentionnel de premier ordre et l’acte de réflexion de second ordre comme étant simultanés, le problème est le suivant : l’acte de réflexion qui sert à rendre conscient un acte de premier ordre ne peut pas lui-même être considéré comme conscient tant qu’il n’a pas à son tour été rendu conscient par un acte de réflexion, donc un troisième acte de réflexion rendant conscient le second acte de réflexion … Mais cela irait alors jusqu’à l’infini. Sartre décrit le dilemme de la manière suivante :
[…] si nous acceptons la loi du couple connaissant-connu, un troisième terme sera nécessaire pour que le connaissant devienne connu à son tour et nous serons placés devant ce dilemme : ou nous arrêter à un terme quelconque de la série : connu – connaissant connu – connaissant connu du connaissant, etc. Alors c’est la totalité du phénomène qui tombe sous l’inconnu c’est-à-dire que nous butons toujours contre une réflexion non-consciente de soi et terme dernier – ou bien nous affirmons la nécessité d’une régression à l’infini […], ce qui est absurde4.
La seule possibilité d’échapper au cercle d’une conscience de soi se présupposant elle-même, ou à une régression à l’infini, me semble être – et en cela je partage la position de l’école de Heidelberg – d’admettre l’existence d’une forme particulière de présence à soi, une présence à soi qui n’est pas obtenue par un acte de réflexion, qui n’est pas le résultat d’une auto-représentation, et qui n’est pas un acte intentionnel. Il s’agit d’une présence à soi préréflexive, pré-représentative, pré-intentionnelle. Celui qui se promène et voit un ami venant à sa rencontre n’a pas besoin de se rendre conscient par un acte de réflexion le fait qu’il vienne à sa rencontre. Le fait de voir l’ami venir est plutôt accompagné d’une présence préréflexive garantissant la connaissance de ce fait, peu importe s’il porte en plus un acte de réflexion sur ce qui se passe. Plus généralement encore : nos actes intentionnels nous sont connus sans que nous nous penchions intentionnellement sur eux. Et si le fait que l’ami vient à ma rencontre ne m’était pas déjà conscient de manière préréflexive au moment même où il vient à ma rencontre, je ne pourrais jamais par après me le rendre conscient par un acte réflexif. Sartre justement met le « de » entre parenthèses pour désigner cette préréflexivité qui est constitutive de toute conscience5.
Or, au niveau de la connaissance propositionnelle, cette conscience préréflexive, à mon avis, ne peut être décrite autrement que par connaissance négative. Est positive, je le rappelle, une connaissance propositionnelle décrivant des actes de représentation. Or aucun acte de représentation, aucune intentionnalité, aucune distinction entre sujet et objet ou acte et objet n’est impliqué dans la conscience préréflexive de soi. Cela fait que même le mot « connaissance » ne semble pas convenir pour décrire la nature de la conscience préréflexive de soi. En tout cas, il y une sorte de consensus de parler de connaissance uniquement à propos d’une connaissance intentionnelle et propositionnelle. C’est ce qui a amené Dieter Henrich à appeler la conscience préréflexive Bekanntschaft mit sich selbst au lieu de Selbsterkenntnis 6. Le français ne connaît pas deux mots différents pour exprimer d’une part le rapport à une personne que l’on connaît ( Bekanntschaft ) et d’autre part la connaissance d’un objet ( Erkenntnis ), distinction dont Henrich se sert justement pour distinguer la conscience préréflexive de la conscience réflexive. Il se sert aussi du terme de familiarité ( Vertrautheit 7) pour désigner la conscience préréflexive. Cependant il me semble qu’il faut bien quelque part appeler la conscience préréflexive une connaissance de soi, car même si aucun acte de réflexion n’est impliqué, cette familiarité avec moi-même fait que je sais que je fais ceci ou cela et me permet en plus de m’en souvenir par après. Il s’agit d’une connaissance, mais non d’une connaissance sur la base d’un acte intentionnel par lequel je représente un objet.
Читать дальше