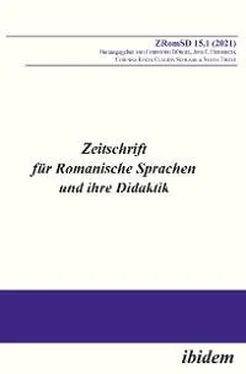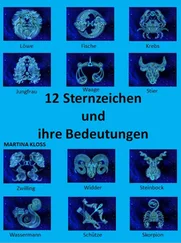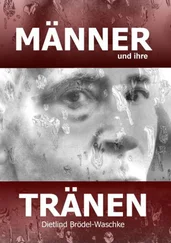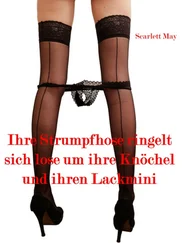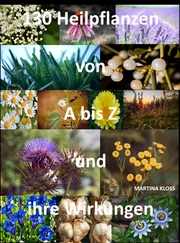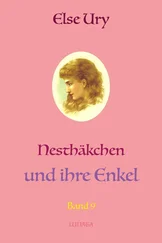6. Expressions préformées réservées à la compétence passive de l’AP-LE
Comme démontré (cf. pt. 3.), nombre de linguistes et de didacticiens prônent la nécessité d’enseigner des phrasèmes de tous genres dès les stades initiaux de l’apprentissage d’une LE sans différencier compétence réceptive et productive. 36En renvoyant à nos réflexions antérieures (cf. Schmale 2012b et 2014 en particulier), nous résumons ci-après les points essentiels guidés par notre conviction que les proverbes, lieux communs, expressions même partiellement idiomatiques, mais aussi certaines formules de routine ne sont pas destinés à la compétence active de l’AP-LE, peu importe le niveau de maîtrise de la langue en question. Voici un rappel des trois arguments principaux :
Il n’existe pas à ce jour de preuve empirique démontrant que les locuteurs natifs d’un âge correspondant à celui des apprenants, aient massivement ou même régulièrement recours aux types de phrasèmes « incriminés » dans les types discursifs pertinents pour l’AP-LE. Bien au contraire, leur emploi des proverbes, idiotismes et autres lieux communs dans la conversation « de tous les jours » est statistiquement négligeable (cf. pt. 4). Pourquoi enseigner à des LNN ce que les LN n’utilisent pas et, très souvent, ne connaissent même plus ?
La maîtrise des conditions d’utilisation et des nombreuses connotations des expressions idiomatiques en particulier, absolument indispensable pour un emploi adéquat des phrasèmes, 37ne peut être acquise dans un environnement institutionnel artificiel face aux nombreuses modalités d’emploi à respecter. De surcroit, ces conditions et connotations semblent aujourd’hui insuffisamment recherchées sur la base de manifestations langagières en contexte naturel au sein de grands corpus. Mis à part le fait que l’on ne dispose pas d’acquis empiriques quant à la fréquence d’utilisation en différenciant le type de locuteur, de situation, de thème, la description linguistique des modes d’emploi prenant en compte systématiquement tous les facteurs (morpho)syntaxique, prosodique, sémantique, pragmatique, discursif, co- et contextuel, etc., fait défaut.
Afin d’étayer notre jugement, prenons un exemple tiré de l’ouvrage de Bardosi & Ettinger & Stölting (2003, 88), où l’on trouve dans la rubrique « conversation » les expressions idiomatiques imagées : « parler dans sa barbe » (no. 12) accompagnée de l’explication « ~ à voix très basse et de manière indistincte » ; ou encore « tailler une bavette (fam.) » définie en tant que « bavarder » (id., 89). Dans les deux cas, on ne mentionne ni le niveau stylistique, ni les connotations, ce qui peut être surtout préjudiciable dans le deuxième cas, ni le type de situation accueillant un tel énoncé. Un AP-LE qui emploierait tailler une bavette à la place de bavarder serait certainement induit en erreur. Rares sont les cas où une explication dictionnairique suffirait pour garantir un usage adéquat d’un idiotisme par un AP-LE, même si la définition fournie permettrait la compréhension en contexte.
Or même si des descriptions exhaustives, fondées sur des études de grands corpus, existaient, une sérieuse réserve devrait être opposée à l’emploi des phrasèmes « incriminés » par des AP-LE peu importe leur niveau langagier, à moins qu’ils ne soient véritablement bilingues, statut difficilement atteignable par le biais d’un apprentissage en contexte scolaire. La raison réside dans l’existence de « culturèmes » (cf. Poyatos 1976 et Oksaar 1988), des types de comportement spécifiques au sein d’une culture. Alors qu’il semble exister des activités fortement attendues – les formules de routine, la correction grammaticale, les manières à table, les activités non verbales (distance, embrasser, serrer la main), etc. –, d’autres seraient réservées aux locuteurs natifs et rejetées voire même sanctionnées si produites par le non-natif. Les proverbes, lieux communs et idiotismes métaphoriques font partie de ces culturèmes réservés aux LN. Ces expressions fortement imagées et marquées pourraient en effet appartenir au domaine des culturèmes dont l’emploi par un LNN, peu importe son niveau de maîtrise, susciterait la prise d’une « position haute » sous forme de commentaires ou, au pire, de réactions négatives. Aussi Dobrovol’skij & Lubimova (1993) constatent :
En tant que locuteur non-natif on doit jouer un double jeu selon le principe : Je me sens chez moi dans cette culture tout en acceptant qu’il s’agit pour moi d’une culture étrangère (id., 156 ; notre traduction).
Bref, le LNN ne doit à aucun moment prétendre faire partie de la culture de son pays d’accueil, recourir à des phrasèmes idiomatiques prétendrait à une assimilation culturelle qu’un LN, peu importe son propre niveau langagier, qui pourrait même être inférieur à celui du LNN, pourrait rejeter et même sanctionner. Dans l’impossibilité d’étayer ce jugement de manière empirique, nous revendiquons sa véracité à travers les observations de multiples ressortissants étrangers après plus de trente-cinq ans passés en France.
7. Principes didactiques pour la sélection et transmission des EP
L’exclusion de l’apprentissage actif des proverbes, lieux communs et expressions idiomatiques n’implique en aucune manière l’impératif d’épurer tous les supports de cours employés de ce genre de phrasèmes. Il s’agit tout simplement de ne pas sélectionner les supports en fonction de leur richesse idiomatique et sémantique, et encore moins de proposer des listes d’idiotismes, etc., à mémoriser. Or si les supports choisis en comprennent « naturellement », il convient bien entendu de les traiter et les expliquer tout en mettant l’apprenant en garde contre leur utilisation active pour les raisons évoquées. Le même principe que celui gouvernant l’emploi d’expressions vulgaires devrait gouverner celui des EP métaphoriques : Les comprendre sans les utiliser ! Par ailleurs, toutes les formules de routine ne sont probablement pas destinées à l’utilisation par un LNN, notamment celles qui pourraient être interprétées comme une prise de « position haute », p. ex. la formule je termine pour défendre son droit de parole.
Sans que cette contribution soit le lieu de présentation d’une unité pédagogique détaillée, nous présentons ci-après l’esquisse des principes linguistiques et (phraséo)didactiques devant guider tout enseignement des phrasèmes et EP dans un sens plus large :
L’enseignement se concentre sur les formules de routine, les collocations et les constructions lexicogrammaticales, notamment, tout au moins jusqu’au niveau B1/2, celles relevant de l’oralité des conversations « au quotidien ».
Leur description doit être fondée sans exception sur de grands corpus tenant compte d’un maximum de caractéristiques structurales aussi bien que de conditions d’utilisation afin d’élaborer des situations d’apprentissages réalistes, non pas naturalistes.
Toutes les EP sont présentées systématiquement en contextes inspirés de situations retrouvées dans les corpus de manifestations communicatives naturelles (cf. Lüger 2019, 69) en respectant leurs cotextes et leur séquentialité.
Les EP sont à différencier sans exception en fonction du futur usage, en distinguant compétence passive (compréhension) et active (production) de l’apprenant.
Le niveau d’apprentissage de l’AP-LE et surtout son âge sont à prendre en compte. Un élève de 11 ans en 6ème n’a pas vocation à employer les mêmes pragmatèmes ou collocations qu’un élève de terminale de 17/18 ans ayant bénéficié de 7 ans d’apprentissage d’une LE en LV1.
Les EP sont à choisir en fonction des besoins communicatifs de l’AP-LE, principe qui prévaut du reste pour tout choix de supports de cours.
Читать дальше