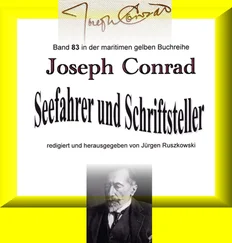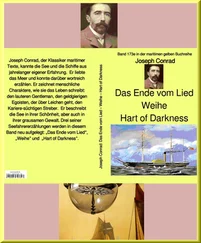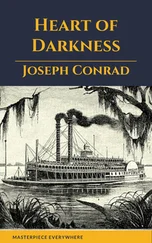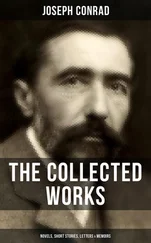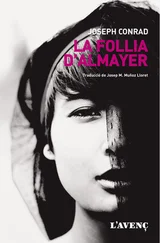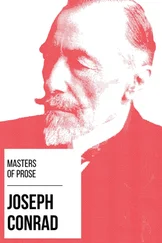Joseph Conrad - Le Frère-De-La-Côte
Здесь есть возможность читать онлайн «Joseph Conrad - Le Frère-De-La-Côte» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Прочие приключения, на французском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Le Frère-De-La-Côte
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Le Frère-De-La-Côte: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Le Frère-De-La-Côte»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Le Frère-De-La-Côte — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Le Frère-De-La-Côte», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– Qu’est-ce que vous racontez? Qu’est-ce que vous savez de mon crâne? Où voulez-vous en venir? Je ne vous connais pas, canaille à cheveux blancs, qui vous promenez la nuit pour aller frapper par-derrière sur la tête des gens. Avez-vous aussi réglé le compte de notre officier?
– Ah, oui! Ton officier. Qu’est-ce qu’il est venu faire? Quels ennuis veniez-vous causer ici d’ailleurs, vous autres?
– Est-ce que vous pensez qu’on le dit à l’équipage d’un canot? Allez le demander à notre officier. Il venait de monter là-haut par le ravin quand voilà notre patron qui a la frousse: «Tu as le pied léger, Sam, qu’il me dit, eh bien, va en douce faire le tour de la crique pour voir si, de l’autre côté, on peut apercevoir notre canot.» Eh bien, je ne distinguais rien du tout. Ça allait. Mais j’ai eu l’idée de grimper un peu plus haut dans les rochers…»
Il s’arrêta d’un air assoupi. «C’était stupide de ta part», remarqua Peyrol sur un ton d’encouragement.
«Je me serais attendu à voir un éléphant dans l’intérieur des terres, plutôt qu’un bâtiment dans un bassin qui n’avait pas l’air plus grand que ma main. Je ne pouvais pas comprendre comment il s’était introduit là. J’ai pas pu me retenir de descendre pour me rendre compte – et tout ce que je sais, c’est qu’ensuite je me suis retrouvé étendu sur le dos, la tête bandée, sur une couchette, dans cette niche qui tient lieu de cabine ici. Vous ne pouviez pas me héler et engager le combat dans les règles, vergue à vergue? Vous m’auriez eu tout de même, car, en fait d’arme, je n’avais rien d’autre que le couteau que vous m’avez volé.
– Il est là sur la planchette», dit Peyrol en se détournant. «Non, mon vieux, je ne voulais pas risquer de te voir ouvrir les ailes pour t’envoler.
– Vous n’aviez rien à craindre pour votre tartane. Notre canot ne cherchait pas de tartane. On n’aurait pas accepté votre tartane en cadeau. On en voit des douzaines chaque jour, de ces tartanes.»
Peyrol remplit de nouveau les deux gobelets. «Ah, oui, vous voyez peut-être beaucoup de tartanes mais celle-ci n’est pas comme les autres. Comment, toi qui es marin, tu n’as pas vu qu’elle avait quelque chose d’extraordinaire.
– Tonnerre de Dieu! cria l’autre. Comment voulez-vous que j’aie pu voir quoi que ce soit? Je venais juste de remarquer que ses voiles étaient enverguées [77]quand votre massue est venue me taper sur la tête.» Il porta les mains à sa tête et se prit à gémir. «Seigneur! on dirait que je n’ai pas dessoûlé depuis un mois.»
Le prisonnier de Peyrol avait en effet un peu l’air de s’être fait ouvrir le crâne dans une rixe d’ivrognes. Mais Peyrol ne lui trouvait pas un aspect répugnant. Le flibustier gardait un tendre souvenir de la vie de pirate qu’il avait menée, avec son esprit anarchique et son vaste théâtre d’opérations, jusqu’au moment où le bouleversement des choses dans l’océan Indien et d’étonnantes rumeurs venues de l’autre bout du monde l’eurent fait réfléchir sur la nature précaire de cette existence. C’était vrai qu’il avait déserté le pavillon français quand il était tout jeune, mais alors, ce drapeau était blanc, maintenant c’était un drapeau tricolore. Il avait connu la pratique de la liberté, de l’égalité et de la fraternité telles qu’on les entendait dans les repaires avoués ou secrets de la confrérie des Frères-de-la-Côte. Si bien que pour lui le changement, à en croire ce qu’en disaient les gens, ne devait pas être bien grand. Le flibustier avait aussi ses idées personnelles et positives sur la valeur de ces trois mots. La Liberté: tenir sa place dans le monde si on le peut; l’Égalité, oui! Mais jamais un groupe d’hommes n’a mené à bien quoi que ce soit sans un chef. Tout cela valait ce que cela valait. Quant à la Fraternité, il la considérait un peu différemment. Des frères pouvaient bien naturellement se quereller entre eux. C’était dans une compagnie de Frères-de-la-Côte, au cours d’une violente querelle soudain devenue enflammée qu’il avait reçu la plus dangereuse blessure de sa vie. Mais Peyrol n’en avait conservé de rancune contre personne. À son avis, tout membre de la confrérie avait droit à l’aide de tous les autres contre le reste du monde. Et il se retrouvait là assis en face d’un Frère dont il avait cogné la tête pour des raisons acceptables. Il était là, de l’autre côté de la table, l’air échevelé, ahuri, perplexe, furieux: et sa tête avait été aussi solide que lorsque, bien des années auparavant, un Frère, d’origine italienne, lui avait donné le surnom de «Testa Dura [78]», en une circonstance quelconque, une partie de lutte à coups de tête, sans doute; de même que lui, Peyrol, pendant un certain temps, avait été connu, des deux côtés du détroit de Mozambique sous le nom de Poigne-de-Fer après avoir joué à bout de bras un jour, en présence des Frères-de-la-Côte, avec la trachée artère d’un turbulent sorcier nègre qui avait un tour de poitrine prodigieux. Les gens du village s’étaient empressés d’apporter les victuailles qu’on réclamait d’eux, et le sorcier n’avait plus jamais été le même. Ç’avait été une belle démonstration.
Oui, c’était Testa Dura, à n’en pas douter; ce jeune néophyte de leur ordre (Peyrol n’avait jamais su ni où ni comment on l’avait recruté), étranger au campement, naïf et très impressionné par la compagnie de bravaches cosmopolites dans laquelle il se trouvait. Il s’était attaché à Peyrol de préférence à quelques-uns de ses compatriotes – il y en avait plusieurs dans cette bande – et il lui courait après comme un petit chien: assurément il avait agi en bon camarade lors de cette blessure qui n’avait ni tué ni dompté Peyrol, mais qui lui avait seulement donné le loisir de réfléchir sur la conduite de sa propre vie.
Peyrol avait eu le premier soupçon de cette stupéfiante réalité, pendant qu’il bandait la tête de l’homme à la lueur de la lampe fumeuse. Du moment que l’homme vivait encore, Peyrol n’avait pas le pouvoir de l’achever ni de le laisser sans secours comme un chien. Et puis c’était un marin. Qu’il fût anglais n’empêchait pas Peyrol d’éprouver à son égard des sentiments mélangés, parmi lesquels la haine n’avait certainement aucune place. Parmi les Frères-de-la-Côte, c’était les Anglais qu’il préférait. Il avait aussi rencontré chez eux cette appréciation particulière et loyale qu’un Français doué de caractère et de capacités obtiendra plutôt des Anglais que de toute autre nation. Peyrol avait été parfois chef, sans avoir jamais guère cherché à l’être, car il n’était pas ambitieux. La place de chef lui revenait, la plupart du temps, dans des moments plus ou moins critiques et, quand elle lui était échue, c’était sur les Anglais qu’il s’était généralement surtout reposé.
Ce jeune garçon était donc devenu ce marin de la marine de guerre anglaise! Il n’y avait rien d’impossible dans le fait même. On trouvait des Frères-de-la-Côte sur toutes sortes de navires et dans toutes sortes d’endroits. Peyrol en avait bien rencontré un une fois sous l’aspect d’un très vieil et misérable infirme qui exerçait la profession de mendiant sur les marches de la cathédrale de Manille [79]; et il l’avait laissé plus riche de deux grosses pièces d’or à ajouter à son magot insoupçonné. On parlait d’un Frère-de-la-Côte qui était devenu mandarin en Chine et Peyrol croyait cela. On ne savait jamais où et dans quelle situation on allait retrouver un Frère-de-la-Côte. L’étonnant, c’était que celui-ci fût venu le chercher, pour se mettre sous son gourdin. La plus grande préoccupation de Peyrol avait été, durant cette matinée de dimanche, de cacher toute cette aventure au lieutenant Réal. Car contre un porteur d’épaulettes, la protection mutuelle était le premier des devoirs entre Frères-de-la-Côte. Le caractère inattendu de cette obligation, qui se présentait à lui vingt ans après, lui donnait une force extraordinaire. Ce qu’il allait faire de cet homme, il n’en savait rien, mais, depuis le matin, la situation avait changé. Peyrol avait reçu la confidence du lieutenant et avait conclu une entente avec lui de manière particulière. Il se plongea dans une profonde méditation.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Le Frère-De-La-Côte»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Le Frère-De-La-Côte» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Le Frère-De-La-Côte» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.