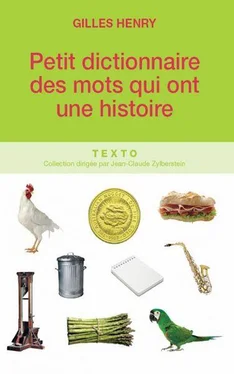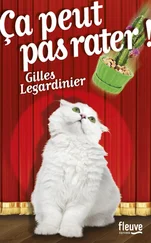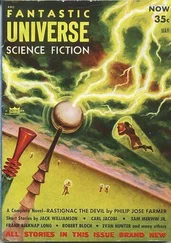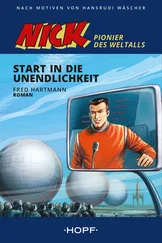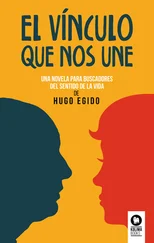Sa renommée lui permit de devenir surintendant des jardins royaux de Kensington et de Saint-James.
Peu de temps après sa mort, voulant lui rendre hommage, l’auteur M. Vahl, dans son ouvrage Enumeratio Plantarum décrivit le forsythia, cet arbuste ornemental à fleurs jaunes analogues au lilas et dont l’origine se trouve en Chine.
Une « plante dorée qui fleurit en hiver ; pour remplacer le soleil », comme l’écrit Georges Duhamel dans l’un de ses romans. Un bel hommage au sieur Forsyth.
FUCHSIA
Léonard Fuchs est né en 1501 à Wembdingen, en Bavière. Bien qu’orphelin de père, il put poursuivre ses études, devenant bachelier avant ses 14 ans, puis maître ès-arts et en médecine.
Il se consacra alors à la recherche, au professorat et aux soins auprès des malades. Son savoir étant immense, la gamme de ses travaux porta particulièrement sur la médecine et la botanique.
Il a élaboré les règles essentielles sur les purgatifs, l’usage des bilans et observé le traitement de la lèpre et de la syphilis.
Il décrivit les utilisations thérapeutiques des végétaux, de plantes médicinales (aloès, rhubarbe, etc.), s’arrêtant à la digitale pourprée. Sa botanographie a connu d’innombrables rééditions et traductions, de même que ses Opéra didactica, parus en 1566, juste avant sa mort, survenue en mai de cette année-là.
Le botaniste Charles Plumier, voulant lui rendre hommage, choisit son nom pour baptiser un arbrisseau originaire d’Amérique, plante ornementale à fleurs en forme de clochettes, qui devint le fuchsia.
La première mention fut donnée par Plumier en 1693 dans sa Description des plantes de l’Amérique. Les belles fleurs rouges avaient désormais un nom.
GARDÉNIA
Alexander Garden, né en Écosse en 1728, commença par étudier la philosophie à Aberdeen, puis continua avec la médecine.
Les États-Unis d’Amérique l’attirant il décida d’aller s’y établir et devint ainsi médecin en Caroline du Sud.
Mais il avait un « violon d’Ingres » qui se nommait botanique, pour laquelle il se passionna jusqu’à sa mort, survenue en 1791-C’est Charles de Linné qui donna le nom de Garden, pour l’honorer, à cette belle plante de la famille des rubiacées, originaire de Chine.
Dès 1777, les jolies fleurs blanches et parfumées du gardénia figuraient dans le Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers .
GOETHÉE
Qui ne connaît l’existence de Johann Wolfgang Goethe ? Né à Francfort-sur-le-Main en 1749, il vécut une enfance heureuse, apprenant en compagnie de son père sept langues, la musique, le dessin, l’histoire naturelle…
Étudiant à Leipzig, puis à Strasbourg, malgré une grave maladie, il revient à Francfort en 1771 pour être avocat, mais s’occupa surtout de poésie. Il publia, en 1773, Goetz von Berlichingen , qui eut un immense succès, suivi de Werther , qui le plaça au premier rang des écrivains allemands.
Devenu conseiller du duc Charles-Auguste à Weimar, pendant dix ans, il passa ensuite en Italie (1786) avant de participer à la campagne de France, puis de reprendre ses travaux. Il devint l’ami de Schiller et publia son célèbre Faust en 1808. Il devait mourir en 1832.
Durant toute sa vie, Goethe s’intéressa à la botanique et c’est précisément pour lui rendre hommage que fut baptisée du nom de goethée, un arbuste du Brésil à grosses fleurs.
À noter que l’on a baptisé du nom de goethite un minéral qui se trouve souvent dans les cavités de la limonite ; également pour rendre hommage — c’était en 1806 — au célèbre écrivain, qui également s’intéressa aux minéraux.
HORTENSIA
Antoine Laurent de Jussieu fit adopter une classification rationnelle des plantes, remplaçant celle de Linné. C’est lui qui raconte, dans son dictionnaire, comment fut baptisé l’hortensia.
Philibert Commerson (1727–1773), naturaliste lui aussi, rapporta un beau jour d’Extrême-Orient, plus exactement de Chine, un arbuste dont les fleurs bleues, roses ou blanches, étaient regroupées en grosses touffes en ombrelle, non odorantes.
Voulant honorer une femme célèbre, Commerson lui dédia la fleur, mais il faut avouer qu’il existe deux hypothèses.
Dans le premier cas, Commerson aurait donné à la plante le nom de peautia caelestina , en mémoire de Nicole Reine Lepeaute, célèbre mathématicienne, qui devait décéder en 1788. Dans le second, il aurait voulu honorer Hortense Lepaute, femme d’un horloger parisien, très en vogue à cette époque.
Quoi qu’il en soit, se ravisant, semble-t-il, Commerson dit qu’il appela la plante du nom de hortensia à partir de flos hortorum (« fleur des jardins »), parce que cultivée dans tous les jardins de Chine.
Jussieu, dans son Genera Plantarum , a conservé hortensia, qu’il faut alors prendre comme le féminin de hortensius « de jardin ».
MAGNOLIA
Pierre Magnol est né en 1638 à Montpellier et, après avoir suivi des études de médecine, se spécialisa en botanique, il devint professeur de cette spécialité dans sa ville natale en 1664.
Il essaya, en 1676, de dresser un répertoire des plantes du Languedoc, en les examinant sous l’angle de leur pouvoir médicinal, puis des plantes particulières à Montpellier.
En 1689, il établit une analogie entre les règnes animal et végétal, distinguant familles, espèces et variétés hybrides. Mais sa classification fut peut-être incomplète ou partiale, en tout cas elle pécha par inexactitude, ce qui entraîna des critiques.
Magnol, de lui-même, retira certaines hypothèses, ce qui n’enlevait rien à l’énorme travail accompli par ailleurs, avant sa mort, survenue en 1715. C’est pourquoi le botaniste Charles Plumier — qui avait déjà « baptisé » d’autres espèces ou d’autres plantes — donna à une nouvelle espèce de plante aux larges feuilles luisantes et à belles fleurs crème, venant d’Asie et d’Amérique, le nom de magnolia.
C’était en 1737. Un peu plus tard, en 1752, Linné « confirma » ce nom qui est parfois remplacé par celui de laurier-tulipier, mais qui est fort décoratif.
PAULOWNIA
Anna Paulownia, fille du tsar Paul I erde Russie, s’adonnait à la passion des plantes, l’une d’elles avait sa préférence, un bel arbre d’ornement de la famille des scrofulariacées. En l’honneur de la grande duchesse, cette plante reçut le nom de paulownia.
PÉTUNIA
Le tabac a été connu en France dès 1556, grâce au père Thévet et surtout à Jean Nicot, en 1560, qui en rapporta un échantillon à Catherine de Médicis. C’est pourquoi, au début, on l’appela nicotiane ou l’herbe à la reine.
On lui donna aussi d’autres noms, correspondant à celui de divers utilisateurs : herbe du Grand Prieur, de Tournabon ou de Sainte-Croix, enfin pétun, nom que lui donnaient les Indiens du Brésil et de la Floride.
Il s’agit d’une plante dicotylédone de la famille des solanacées ; on en trouve d’autres qui ont « fait leur vie » ; c’est le cas d’une variété herbacée, vivace, très appréciée comme plante ornementale en raison de ses fleurs violettes, roses, bleues ou blanches, fleurissant de mai à novembre.
On lui attribua au début, vers 1828, le nom de pétunie, directement dérivé de pétun, qui ensuite se transforma en pétunia.
ROBINIER
Jean Robin est né en 1550. Après ses études, il s’installa comme apothicaire tout en s’occupant activement de son jardin, situé à la pointe de l’île Notre-Dame, à l’emplacement de l’actuelle place Dauphine.
Читать дальше