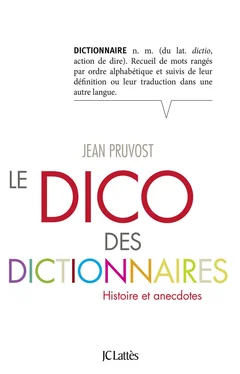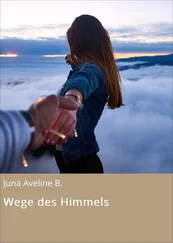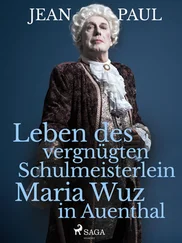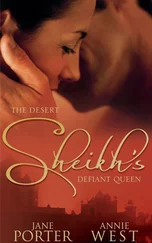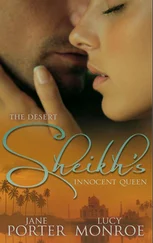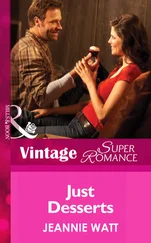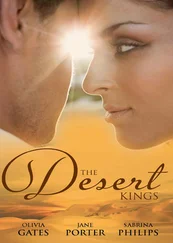Les railleries les plus venimeuses venaient parfois des Académiciens eux-mêmes. C’est en l’occurrence à l’un des premiers membres de l’Académie française, en vérité celui-là même qui avait été l’informateur privilégié de Richelieu, François Le Métel de Boisrobert, au moment de créer l’Académie en 1635, que l’on doit une épigramme — attention, un épigramme, c’est le haut de côtelette d’un agneau… — particulièrement caustique mais si drôle qu’elle fit mouche et traversa les siècles, au point d’être systématiquement avancée dès lors qu’on veut sourire de cette lenteur :
Tous ensemble, ils ne font rien qui vaille.
Depuis dix ans dessus l’F on travaille,
Et le destin m’auroit fort obligé
S’il m’avoit dit : Tu vivras jusqu’au G.
Voilà qui fait assurément sourire, aucun Immortel au demeurant ne pouvant être assuré de parcourir tout l’alphabet… Et qui exigeait une riposte. Elle vint dans la préface du Dictionnaire , en mettant en scène Colbert, se rendant impromptu à l’Académie française et participant ainsi, au débotté, à un débat sur un article bien choisi par le destin : Amy … Comment alors rendre le ministre de Louis XIV et par ailleurs fondateur de l’Académie des sciences, en 1866, à la fois complice de cette lenteur et propre à disculper l’Académie française ?
Rien de mieux tout d’abord que d’en faire le témoin innocent du travail académique. Dans l’orthographe et la ponctuation du XVII esiècle — on notera à cet égard une belle évolution —, le voici donc innocemment introduit au cœur du travail lexicographique des Quarante. « Monsieur Colbert qui estoit de l’Académie, et qui desiroit fort de voir le Dictionnaire achevé, estant persuadé comme l’ont esté les plus sages Politiques, que ce qui sert à former l’Eloquence contribue beaucoup à la gloire d’une Nation ; Peu de temps après qu’il eut esté receu dans cette Compagnie, il y vint sans qu’on l’y atendist, pour estre tesmoin de la maniere dont on travailloit. »
Sans épiloguer sur une assiduité très en défaut, le hasard fit si bien qu’« il y arriva lors qu’on revoyoit le mot Amy, et comme il falloit avant toutes choses regler la définition de ce mot, il vit combien il s’esleva de difficultez avant que d’en convenir ».
En réalité, ce qui suit est à bien méditer parce que, de fait, ce dictionnaire volontiers décrié, eut pour amis au XVIII esiècle, et donc au Siècle des lumières et de la raison, les philosophes, qu’il s’agisse de Diderot, de Voltaire ou de D’Alembert, ce dernier dirigeant d’ailleurs la cinquième édition du Dictionnaire de l’Académie . La raison en était simple : les philosophes appréciaient hautement la qualité logique des définitions. Or, au cours de la visite de Colbert, inconsciemment, les Académiciens offraient un assez bel exemple du travail définitoire difficile qui est le leur, dès lors qu’on souhaite répondre à l’exigeante logique : « On demanda si le mot d’Amy supposoit une Amitié reciproque ; c’est-à-dire, si un homme pouvoit estre appelé l’AMY d’un autre qui n’auroit pas les mesmes sentimens pour luy. » En somme, je suis votre ami, et pour vous, suis-je votre ami ?
Un peu plus haut dans cette préface, sans faire référence à l’« ami » Colbert, l’Académie à son insu révèle une des raisons de la méprise dont elle a été et reste toujours l’objet : le fait qu’elle s’intéresse prioritairement à la définition des mots en usage, sans privilégier les mots rares, les vieux mots, les mots techniques. D’abord la langue de tous, qu’on croit bien connaître. À tort évidemment.
« C’est dans cet Estat où la Langue Françoise se trouve aujourd’huy qu’a esté composé ce Dictionnaire ; et pour la representer dans ce mesme estat, l’Académie a jugé qu’elle ne devoit pas y mettre les vieux mots qui sont entierement hors d’usage, ni les termes des Arts et des Sciences qui entrent rarement dans le Discours ; Elle s’est retranchée à la Langue commune, telle qu’elle est dans le commerce ordinaire des honnestes gens, et telle que les Orateurs et les Poëtes l’employent ; Ce qui comprend tout ce qui peut servir à la noblesse et à l’Elegance du discours. »
Pas d’exotisme… La langue, celle de tout le monde. Le Dictionnaire de l’usage, « simplement et suprêmement », précisait Maurice Druon en 1986. En définitive, pour qui souhaite des citations fleuries et des faits encyclopédiques, c’est nécessairement la déception. Et au XVII esiècle, le public lettré fut déçu, il souhaitait des citations, des anecdotes, et l’Académie offrait des définitions, logiques, précises, très travaillées, qui passèrent presque inaperçues, des exemples forgés par les Académiciens eux-mêmes, à l’époque, ne l’oublions pas, ces Académiciens avaient pour noms Corneille, Racine, Boileau, La Fontaine, Bossuet… N’est-ce pas émouvant d’imaginer que tel ou tel exemple a été proposé par l’un d’entre eux ? Mais ils n’ont pas signé… le « moi haïssable » l’emporta : les Académiciens avaient, après avoir hésité, décidé de ne pas se citer.
Quel était alors l’objectif de l’Académie : « Elle a donné la Définition de tous les mots communs de la Langue dont les Idées sont fort simples ; et cela est beaucoup plus mal-aisé que de definir les mots des Arts et des Sciences dont les Idées sont fort composées. » Les mots simples seraient-ils plus compliqués que les mots difficiles ? La réponse est limpide :
« Il est bien plus aisé, par exemple, de definir le mot de Telescope , qui est une Lunette à voir de loin , que de definir le mot de voir . » Ami et amour sont indéniablement plus difficiles à définir que abat-vent et aborigène .
Pour qui lit la première préface du Dictionnaire de l’Académie paru dans la dernière décennie du Grand Siècle, en 1694, longue préface de plus de dix pages drues à propos des problèmes posés par la description de la langue française, le sourire condescendant n’est plus de mise. Ce sera la même chose dans la préface de l’édition de 1835 ou encore de 1878. Et de la dernière, la neuvième.
Mais qui lit avec attention les définitions des mots de l’usage courant ? Pourtant, en 1694, après avoir précisé que le mot télescope est plus facile à définir que le verbe voir , le paradoxe est soulevé : « L’on esprouve mesme en definissant ces termes des Arts et des Sciences, que la Definition est toujours plus claire que la chose definie ; au lieu qu’en definissant les termes communs, la chose definie est toujours plus claire que la Definition. »
C’est très simple : si votre métier vous oblige à suivre de près l’histoire de la langue française, à consulter les dictionnaires et leur préface, à lire les réflexions ayant porté sur la langue française, alors il ne vous viendra pas à l’idée de sourire de l’Académie. Au reste, tous les linguistes, historiens de la langue française, prennent le Dictionnaire de l’Académie française à travers ses neuf éditions successives comme un précieux témoin de la réflexion linguistique. C’est un Dictionnaire amy !
Andouille
Voir Postface
Antonine, La Semeuse…
Semeur, semeuse : Personne qui sème, qui sait semer. […] Un semeur doit être un homme intelligent . (Bosc.) […] Fig. Personne qui sème, qui propage, qui divulgue. Une semeuse de discorde .
Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIX esiècle, 1865–1876.
Le Petit Chaperon rouge…
Il était une fois Antonine Jury, aussi jolie que Le Petit Chaperon rouge , une histoire délicieuse et cruelle que tout le monde connaît. Mais Pierre Larousse aime tant le personnage légendaire du Petit Chaperon que dans son Grand Dictionnaire universel du XIX esiècle , il offre sans hésiter à son lecteur la totalité du conte de Perrault, à la faveur d’un article qui lui est entièrement dévolu.
Читать дальше