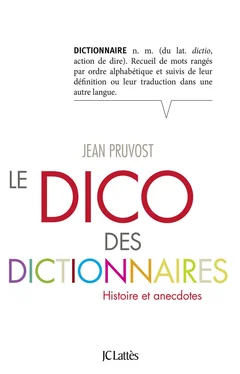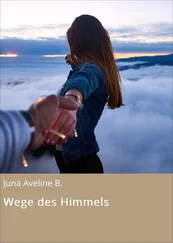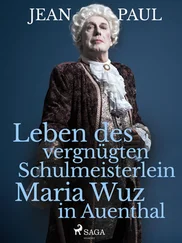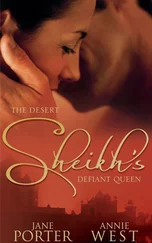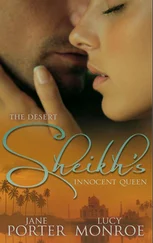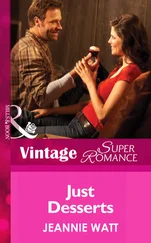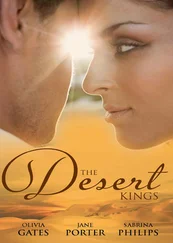Une famille de mots peut aussi être brisée par un indésirable qui s’insère entre deux mots qu’il sépare à la manière de faconde entre façon et façonnage . Tout aussi bien que de fausses familles se forgent en profitant de l’alphabet : derrière l’ ABC d’une discipline, il serait dangereux d’ abcéder , autrement dit de « dégénérer en abcès », attendre conduirait indûment à attendrir , et le céleri n’a évidemment que faire de la célérité .
L’ordre alphabétique peut même devenir une philosophie de l’absurde pour qui est indécis dans ses choix quotidiens. Pierre Larousse rappelle par exemple que Joseph Berchoux, qui s’était illustré au tout début du XIX esiècle pour ses vers sur la gastronomie, avait plaisamment versifié à propos de l’appétit méthodique de Géta : « Je ne puis oublier l’appétit méthodique de Géta, qui mangeait par ordre alphabétique. » Pour Noël, voici donc quel pourrait être le menu alphabétique : d’abord B , la bûche de Noël, puis C , le champagne , avant D , la dinde , suivie de F , le fromage à glisser avant M , les marrons . Quant au digestif, D , il sera bien entendu pris après le champagne .
Enfin, l’ordre alphabétique, du côté des noms propres, a aussi ses facéties. Il n’est d’ailleurs pas toujours du goût des nouveaux admis. Ainsi, en 2000, lorsque Pierre Perret fait son entrée dans le Petit Larousse illustré , il en est ravi, mais avec son humour pétillant, il rappelle qu’il serait bon d’ajouter quelques lignes à son article pour que Pétain, qui gêne son environnement typographique immédiat, passe un peu plus loin.
Quant au sympathique spécialiste de l’horreur, Hitchcock, il précède immédiatement un autre spécialiste de l’horreur mais qui n’a plus rien de sympathique, Hitler. Dira-t-on qu’entre Robespierre et Robin des Bois il y a connivence dans la droiture ou opposition dans les méthodes ? Et pour la succession Pinocchio-Pinochet, les journalistes ne nous en ont pas fait grâce le moment venu.
Enfin, il y a des associations très personnelles, il me plaît par exemple que Saussure qui nous a tant apporté en linguistique soit suivi du Sauternes, une autre jouissance.
Du confortable arbitraire et des volcans
Alors au-delà des effets inattendus d’alliance, pourquoi l’ordre alphabétique a-t-il tant de succès ? Le fait qu’il détermine sans difficulté la place de chaque mot, nom commun ou nom propre, qu’il soit extensible à l’infini, qu’il soit justement arbitraire et sans arrière-plan idéologique notable, est particulièrement confortable. Ne pas avoir à réfléchir, c’est tout de même reposant parfois, surtout pour un classement de mots qui, s’il devait être intelligent, nous pousserait nécessairement vers de hautes philosophies spéculatives.
Aussi ne faut-il pas s’étonner que les classements sémantiques, ceux fondés sur le sens des mots, par exemple les dictionnaires analogiques, par thèmes, ne se soient jamais vraiment imposés dans les dictionnaires papier. C’est le dictionnaire électronique qui nous sauve des griffes de l’alphabet arbitraire, grâce aux requêtes transversales conduites au gré de notre fantaisie : on peut enfin procéder à une recherche thématique personnelle sans passer par une grille pré-imposée.
On sait bien que, de toute façon, en matière de savoir les classifications sont rapidement horripilantes pour les esprits libres parce qu’elles cloisonnent la pensée, encore plus que ne le fait l’ordre alphabétique sans prétention, et qu’elles vieillissent plus vite que les savoirs qu’elles sont censées structurer.
En vérité, l’ordre alphabétique, qui fait partie de ce que les linguistes appellent un classement formel — fondé sur la forme du mot, leur orthographe —, justement parce qu’il échappe presque à toute raison, nous fascine. Le rationnel Anatole France de s’écrier dans La Vie littéraire que, sans conteste, « un dictionnaire, c’est l’univers par ordre alphabétique : c’est le livre par excellence. Tous les autres sont dedans : il ne s’agit plus que de les tirer ». Une réflexion aussi naïve n’est en réalité guère plus profonde que la réaction recueillie à propos du mot volcan par le grand collectionneur, devant Bacchus, de brèves de comptoir, Jean-Marie Gourio : « Dans le mot volcan, y a can, ça veut dire qu’on ne sait jamais can ça vol ? Quand ça va voler ? — Ah… c’est bien foutu les mots… »
Socrate revu par Platon ne procédait pas autrement lorsqu’il s’essayait à l’étymologie ! Qu’importe la forme, pourvu qu’on ait l’ivresse des mots.
Justement je débutais par la préposition à, qui est le mot le plus difficile, je crois, de tout le dictionnaire.
Émile Littré, Comment j’ai fait mon dictionnaire, Didier, 1880.
Les lexicographes [auteurs de dictionnaires] auraient-ils pressenti la multiplicité et la complexité des acceptions de la préposition « à », ils eussent renoncé à faire des dictionnaires.
Georges Elgozy, Le Fictionnaire, 1973.
Cauchemar assuré du lecteur ordinaire ou régal du grammairien, la consultation de l’article consacré à ladite préposition s’étale sur 28 pages, grand format, in quarto comme il est dit pour nos gros Larousse, à l’aube du premier volume du Trésor de la langue française (1971). Gageons cependant que cet article, vaste plage d’informations qui équivaut pour ainsi dire aux 128 pages d’un Que sais-je ? reste très peu consulté. Plus d’un mois à rédiger l’article à , et personne pour le visiter : il y a du masochisme dans l’art d’écrire un dictionnaire.
Jean-Baptiste Harang, dans un article de Libération du 15 novembre 2001, p. 11 (quand ils le peuvent, les auteurs de dictionnaires, les lexicographes , sont précis dans leurs références !), confirme le calvaire imposé aux lexicographes de langue française.
« Alain Rey nous disait naguère : “Vous savez, le problème avec les dictionnaires de français, c’est qu’il faut commencer par la lettre A et le premier mot c’est à , un des mots les plus compliqués de la langue puisqu’il hérite à lui seul de trois prépositions latines ( ad, ab et apud ), ça en a découragé plus d’un.” » Paul Robert néanmoins ne se découragea pas, il rédigera vaillamment l’article infernal.
Les auteurs du Petit Larousse vont droit au but. « À 1. Exprime un rapport de lieu, de temps, de destination, de possession, de moyen, de manière, de prix. » Cela commence mal, un peu décourageant. Puis : « 2. Introduit un complément d’objet indirect ou un complément d’attribution, un complément d’un nom ou de l’adjectif. » On n’insistera pas, seul le grammairien peut ici rêver.
En revanche, du côté des exemples, de nouveau, l’inconscient parle, et le lecteur bien disposé peut faire vagabonder l’imagination, la folle du dictionnaire. Premier exemple pour le rapport de lieu en l’occurrence : « Être à Paris. » Et pas à n’importe quelle heure : « Paris, à sept heures. » À deux heures près, on s’éveillait avec Jacques Dutronc. Pourquoi Paris ? Autosatisfaction des rédacteurs, rue Montparnasse, au siège de Larousse ? Rêve ou enfer partagé ? Encore qu’à sept heures le trafic RER et routier échappent au gril de Lucifer.
Paris n’est pas un mauvais choix pour une raison que le lecteur ignore : l’espace typographique est particulièrement cher dans un dictionnaire, à la lettre près parfois, pour ne pas perdre une ligne. Faire entrer près de 60 000 mots, qu’il s’agisse du Petit Robert ou du Petit Larousse , dans un nombre de pages fixé pour que l’ouvrage soit vendu à un prix raisonnable implique une vigilance permanente quant au nombre de signes utilisés. Paris avec cinq lettres, cinq signes, ce n’est pas trop long. Lyon serait mieux, Strasbourg ou Marseille n’ont aucune chance. Quant à Apt ou Pau, ce serait peut-être curieux. Rome, pourquoi pas ? Mais on y parle l’italien.
Читать дальше